|
|
« Une histoire sans
mots » : le monde d’aujourd’hui selon Xu Bing
par
Brigitte Duzan, 22 août 2017
|
« Une histoire
sans mots »
est un roman effectivement sans un mot : l’histoire est
contée en pictogrammes, smileys, logos et symboles
divers recréés ou inventés par l’auteur, plus des signes
de ponctuation. Mais, comme il est chinois, le livre a
quand même été publié, chez Grasset, dans la collection
Littérature étrangère.
Un spécialiste des caractères imaginaires
L’art de l’illisible |
|
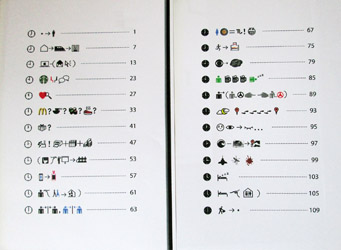
Une histoire sans mots, table des
matières |
Xu Bing (徐冰)
est un artiste célèbre en Chine pour ses installations qui, pour
la plupart, sous une forme ou une autre, sont un reflet des
ambiguïtés du langage, et du langage écrit en particulier,
débouchant sur une plus vaste réflexion sur les illusions du
réel, sous l’apparence des choses.
|

Extrait |
|
Xu Bing dit avoir été inspiré par ses souvenirs d’enfant
impressionné par les pages de caractères que son père
lui demandait de recopier tout en réfléchissant sur leur
sens, sens difficile à appréhender en raison du
polysémantisme
du caractère chinois isolé, riche de sens potentiels
multiples
.
Influencé, aussi, par l’expérience vécue pendant la
Révolution culturelle, Xu Bing a passé des années à
inventer des caractères très semblables |
à
des caractères chinois, mais en fait parfaitement
inintelligibles
.
D’une grande beauté formelle, les œuvres de Xu Bing alignent des
faux caractères chinois, mais qui peuvent aussi bien être des
lettres de l’alphabet réinventées pour leur donner l’apparence
de caractères chinois. La beauté fait oublier que cela n’a aucun
sens.
Le livre du ciel
|
Exemple type : l’une de ses premières installations, qui
reste l’une de ses plus célèbres, « Book from the Sky »,
en chinois Tianshu (《天书》).
Ce sont quatre mille caractères inventés pour
l’occasion, gravés sur des blocs de bois utilisés comme
caractères mobiles pour imprimer des livres et des
rouleaux. Livres tombant littéralement du ciel, en se
déversant du plafond : on pense à ces ouvrages anciens
dépositaires d’une sagesse millénaire. A tort : c’est
inintelligible. Tianshu
veut bien |
|

Book from the Sky |
dire ‘livre céleste’, mais aussi, dans un sens dérivé,‘livre
illisible’, ramassis de bêtises.
Le problème, c’est que Xu Bing a voulu utiliser cette méthode,
en jouant sur les signes, pour écrire un roman, donc une
histoire qui devrait avoir un sens.
Le livre de la terre
« L’histoire sans mots » fait d’ailleurs directement référence à
l’installation « Book from the Sky » ou Tianshu (《天书》),
car le titre chinois est « Book from the Ground » ou Dishu
(《地书》).
Sans doute parce que c’est une histoire des plus banales,
down-to-earth comme on dit. Mais surtout le message est inversé,
explique Xu Bing : dans le premier cas, le texte est
inintelligible, pour tout le monde ; dans le second, tout le
monde est sensé pouvoir le lire, analphabètes comme
intellectuels.
Une histoire pour tout le monde ?
|
L’histoire banale d’un employé ordinaire
Le roman raconte, sans mots donc, une histoire banale,
heure par heure, d’employé de bureau ordinaire, avec ses
soucis et ses rêves, et son ennui.
Page 1 : il est sept heures, l’homme dort, son réveil
sonne, le réveille, le chat aussi… Il part travailler,
prend le métro, s’ennuie au bureau, regarde ses mails,
surfe sur internet, … |
|
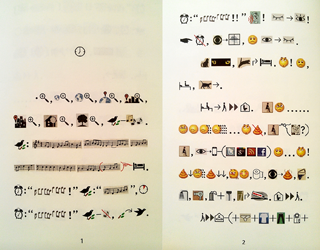
Métro-boulot-dodo |
|

Déboires amoureux |
|
Il a une conférence à préparer, cet homme, va déjeuner
avec ses collègues, bavarde avec eux, le téléphone
sonne, mais il ne prend pas le coup de fil, ce sont ses
parents qui veulent le marier. Mais, la journée finie,
il va s’offrir un peu de divertissement : il invite une
fille rencontrée sur internet à prendre un verre…
On ne pourrait imaginer plus banal, plus terre à terre.
On est en Chine, avec les |
problèmes lambda du citadin lambda. On est aussi en plein monde
globalisé, mondialisé, monde du bonheur à portée de supermarché
et de publicité, et de l’ennui uniforme qui va avec.
Les signes de tout le monde…
Quant au langage utilisé, c’est celui des rébus, des signes et
codes de tous les jours, du métro-boulot-dodo, justement, ceux
qu’on trouve dans les gares, les centres commerciaux, dans les
rues, et sur internet, langage du quotidien, certes, mais du
virtuel aussi. Comme une langue étrangère qui n’aurait pas
besoin d’être traduite pour être compréhensible, immédiatement.
Après avoir recréé les caractères chinois dans ses
installations, Xu Bing réinvente les hiéroglyphes. Il réinvente
aussi la bande dessinée, ses parenthèses faisant office de
bulles.
… et les signes de personne
Ce n’est pas pour autant toujours facile à comprendre. Comme
dans son œuvre graphique et ses installations, Xu Bing joue sur
les ambiguïtés du langage, devenu non-langage, ou du langage
codé qui envahit notre quotidien sous prétexte de favoriser son
intelligibilité.
Alors c’est original et divertissant, mais le lecteur s’y perd
un peu, au fil des pages, car il y en a quand même une centaine.
Mais c’est parce que Xu Bing a réussi à nous faire sentir le
message derrière ses petites inventions : satire du monde dans
lequel nous vivons, qui, à force d’images codées, tend
finalement vers l’abstraction.
Une histoire sans mots, de Xu Bing, Éditions Grasset,
coll. « Littérature étrangère », nov. 2013, 128 p.
|
|

