|
|
Ba Jin – Romans et
nouvelles
par Brigitte Duzan, 26 octobre 2015
Famille
《家》
|
Achevé en 1931,
« Famille » avait d’abord été intitulé « Torrent » (《激流》),
puis
Ba Jin a changé le
titre quand il a eu écrit les deux romans qui lui font
suite, « Printemps » (《春》)
et « Automne » (《秋》).
Le titre initial – et toute la symbolique qui lui est
attachée - a été conservé pour l’ensemble de ces trois
romans, connus comme la « Trilogie du torrent » (《激流三部曲》).
« Famille » est considéré comme l’un des grands
classiques de la littérature chinoise du vingtième
siècle, traduisant les frustrations et les aspirations
des jeunes intellectuels chinois au lendemain du
mouvement du 4 mai ;
il reflète tout particulièrement le triste sort qui
continuait d’être celui des femmes dans une Chine où les
structures familiales « féodales » n’avaient pas
disparu.
Un récit construit autour de trois frères, et du destin
de quatre femmes |
|

Ba Jin à 26 ans au moment où
il termine Jia (4 décembre 1931) |
Le récit se passe en 1921, à Chengdu, et commence alors que deux
jeunes garçons rentrent chez eux un soir d’hiver, sous une
tempête de neige longuement décrite. Ils portent le même
uniforme, sont étudiants dans le même collège, et frères : les
deuxième et troisième frères d’une fratrie de trois, dans une
grande famille à l’ancienne menée de main de fer par un
patriarche vieillissant habitué à décider du sort de chacun.
Mais la force dramatique du roman tient dans les quatre
personnages féminins qui leur sont liés, et dont l’histoire
tragique est au centre du récit, la mort de chacune d’entre
elles étant causée par l’emprise de la structure patriarcale
traditionnelle sur leur destin, et la faiblesse des hommes qui
auraient dû les protéger.
Trois frères
Gao Juexin (高觉新)
est l’aîné. Il a été forcé par son grand-père d’arrêter ses
études à la fin du lycée, et d’épouser la femme que celui-ci lui
a choisie, Li Ruijue (李瑞珏),
alors qu’il aime sa cousine Mei (梅).
Le second, Gao Juemin (高觉民),
poursuit ses études avec son plus jeune frère ; il est amoureux
d’une jeune fille, Qin (琴),
qui est aussi une cousine, mais cherche à s’émanciper en
étudiant ; tous les deux rêvent qu’elle puisse être admise à
l’Ecole des langues étrangères, et qu’ils puissent y étudier
ensemble.
Quant au troisième, Gao Juehui (高觉慧),
c’est un jeune étudiant bouillant d’enthousiasme pour les idées
du 4 mai, amoureux de la jeune et jolie servante Mingfeng
(鸣凤).
Chacun est soumis au despotisme du grand-père qui gouverne la
maisonnée comme un autocrate à l’ancienne, dans un réseau
relationnel où chacun a la place qu’il lui a attribuée, et où
les femmes n’accèdent à un statut que par le mariage.
Le drame se noue quand la jeune génération regimbe en tentant de
faire ses propres choix dans la vie, et en particulier ses choix
matrimoniaux, qui constituent le nœud du système. Si les frères
sont frustrés dans leurs aspirations, les femmes paient un
tribut bien plus élevé.
Trois destins de femmes
Un double drame se noue autour deJuexin et de son caractère
soumis et velléitaire. La cousine qu’il aimait, Mei, se
marie et devient veuve. Menant une vie d’enfer avec une
belle-mère qui la maltraite, elle rentre chez elle vivre avec sa
mère. Mais elle tombe malade et meurt.
|
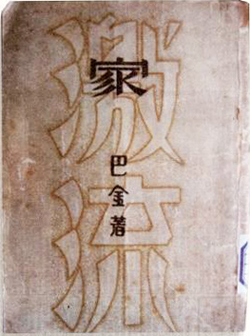
Première édition en livre, 开明书店 1933
(avec en filigrane les caractères de Torrent 激流) |
|
Quant à Ruijue, son mariage lui a donné une
position sociale, surtout après avoir donné un fils à
son époux, mais son sort n’est guère plus enviable car
elle aime Juexin tout en se rendant compte que lui aime
toujours sa cousine. Elle finit par être victime, elle
aussi, de la tradition, et dans son cas des
superstitions familiales. Quand meurt le patriarche,
elle est près d’accoucher de son second enfant ; or une
ancienne croyance veut que l’on éloigne les femmes près
d’accoucher du cercueil d’un défunt. Sur les injonctions
de ses oncles et tantes, Juexin accepte d’envoyer
Ruijue accoucher ailleurs ; elle meurt en couches
quelques jours plus tard, sans qu’il ait pu la revoir ni
l’aider, sa chambre lui étant interdite pendant la
période de deuil.
Juemin a plus de caractère que son frère et refuse de se
plier à la volonté de son grand-père qui veut lui faire
épouser la riche nièce d’un potentat local. Il s’enfuit
pour éviter d’être |
contraint à ce mariage. Le vieux patriarche tente alors de
persuader le plus jeune de retrouver son frère et d’être son
garçon d’honneur au mariage… sur quoi tombe la nouvelle de la
mort de Mei…
Ce n’est qu’après son soixante-sixième anniversaire, alors qu’il
voit sa santé décliner, que le vieil homme promet d’abandonner
ses projets de mariage pour Juemin, et l’autorise à épouser
Qin. Celle-ci n’en doit pas moins abandonner ses projets
d’études, l’université étant toujours fermée aux étudiantes. Ce
n’est qu’une demi-victoire.
Le sort le plus cruel, cependant, est celui de la petite
servante Mingfeng. Elle a dix-sept ans, et maître Gao,
pour remplir une promesse, la donne comme concubine à un vieux
voisin lubrique du même âge que lui. Mingfeng va implorer les
membres de la famille qui n’osent pas intervenir en sa faveur.
Et quand elle va demander son aide à Juehui, il est tellement
occupé par ses activités révolutionnaires qu’il ne l’écoute pas.
Il ne lui reste pour toute option qu’à suicider en se jetant à
l’eau. Sur quoi Juehui se rend compte de sa responsabilité et se
morfond en regrets, mais trop tard… Quant à maître Gao, pour ne
pas manquer à sa promesse, il donne une autre servante à son
vieil ami…
|
Le roman est très bien construit, car les histoires se
recoupent, la mort de l’une répondant à celle des
autres. Ce n’est pas celle de Mingfeng qui est
déterminante, mais celle de Ruijue, qui intervient après
les deux autres, comme épitome des drames précédents :
c’est sa mort qui finit de dresser Juehui contre
l’obscurantisme familial et le pousse à quitter la
maison pour fuir à Shanghai… c’est la chute annoncée de
la famille Gao.
Un roman en grande partie autobiographique
Ecrit par un Ba Jin de vingt-six ans, dans un style aux
dialogues vifs et avec une belle maîtrise de la
construction narrative, « Famille » est un roman
d’autant plus vibrant qu’il reflète la vie et les
sentiments de l’auteur, comme il s’en est expliqué dans
de nombreux commentaires le concernant.
Les divers commentaires |
|
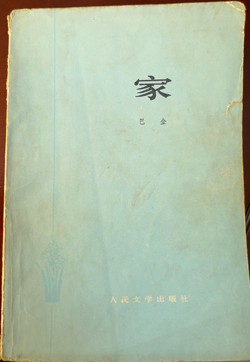
Edition de juin 1953 aux éditions
Littérature du peuple |
« Famille » a fait l’objet de nombreuses publications après
1931, et Ba Jin n’a cessé d’ajouter des commentaires sous forme
d’annexes à ses quarante chapitres. Dans l’édition de 1977 qui
sert généralement de référence, le texte est accompagné d’une
préface de 1937, d’une postface datée de mars 1953 et de trois
annexes
(附录).
La première annexe est la préface écrite pour la première
édition ; datée d’avril 1932, elle est adressée à son frère,
dont il a appris le suicide alors qu’il venait d’achever le
sixième chapitre, et auquel il crie son désarroi, du fond du
cœur : « 你毕竟死了,做了一个完全不必要的牺牲品而死了。 »
(Tu
es mort, en te sacrifiant, mais ce sacrifice est totalement
inutile).
Son livre était en partie écrit pour lui, explique-t-il, mais il
a été terminé trop tard et n’a pas pu le sauver. Il est l’une
des victimes qui hantent le roman ; c’est sur lui qu’est calqué
le personnage de Juexin.
La deuxième annexe est un commentaire sur le
roman adressé à l’un de ses cousins, écrit en février 1937 :
<<关于《家》(十版代序)>>{——给我的一个表哥}
La troisième annexe est un commentaire adressé au
lecteur, daté de juin 1957, qui reprend beaucoup des éléments du
second commentaire, dont la postface est elle-même un condensé :
{和读者谈《家》}.
Ba Jin y explique que les personnages sont inspirés de personnes
de son entourage qui ont vécu des drames semblables, dont il a
été témoin. Il écrivait, dit-il, avec l’impression, à chaque
mot, « d’exhumer d’une tombe des souvenirs enfouis ».
Des personnages féminins authentiques, mais dramatisés
|

Edition complète de 1977 |
|
Le monde qu’il décrit dans « Famille » est le sien,
celui d’une grande famille patriarcale de Chengdu dans
les années 1920-21. Il le déclare dans son commentaire
de 1957 :
“书中人物都是我所爱过和我所恨过的。许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。”
« Les personnages de mon roman sont des êtres que
j’ai aimés et d’autres que j’ai haïs. Beaucoup des
situations que je décris, j’en ai moi-même été le
témoin, et parfois je les ai moi-même vécues. »
“我要向这个垂死的制度叫出我的
J’accuse !《我控诉》。”
« C’est contre ce système moribond que je lance mon
propre J’accuse ! »
C’est l’indignation qui pousse Ba Jin à écrire, comme
Zola en son temps, indignation et tristesse devant tant
de victimes inutiles, comme son frère, mais aussi tant
de femmes autour de lui. Car, si les hommes ont leur
part de tragédie dans cet |
univers clos – tel ce cinquième oncle mort ruiné, vagabond sans
abri brisé dans ses aspirations, qui lui a inspiré « Le jardin
du repos » (《憩园》)
- ce sont les femmes qui sont les premières sacrifiées, dans un
système patriarcal où elles n’avaient tout au plus que valeur
d’échange. Mais il a dramatisé les situations.
1. La première des femmes de sa famille qui l’ont inspiré est sa
belle-sœur, elle aussi obligée d’aller accoucher, comme
Ruijue, en dehors de la maison familiale après la mort du
grand-père de Ba Jin. La différence est qu’elle n’en est pas
morte.
2. Ba Jin avait aussi une cousine du même âge que Mei,
qui aimait son frère aîné et venait souvent les voir. Tout le
monde dans la famille l’aimait bien, mais sa mère ne voulut pas
de ce mariage, car les deux familles étaient déjà unies par
ailleurs ; les deux jeunes gens furent donc séparés. Quelques
années plus tard, la jeune cousine fut donnée en secondes noces
à un riche veuf ; Ba Jin raconte l’avoir revue en 1942 à son
retour à Chengdu, transformée en riche dondon, grosse et cupide…
pas de tragédie non plus, mais une fin terriblement triste.
3. Quant à Mingfeng, elle lui a été inspirée par une
servante qui s’appelait Cuifeng (翠凤),
un autre phénix. Elle aussi dut lutter pour ne pas être donnée
comme concubine à un parent, mais là encore, elle n’a pas eu à
se suicider : elle avait un statut de servante « extérieure »,
qui travaillait dans la maison pour être logée et nourrie, (“寄饭”的丫头),
personne ne la maltraitait. Elle finit par épouser un homme
pauvre qu’elle avait choisi.
4. Reste Qin. Son personnage est calqué sur une autre
cousine de Ba Jin qui, elle aussi, montrait beaucoup d’intérêt à
l’étude des livres et revues diffusant les idées du 4 mai et
passait de longues heures en discussion avec son troisième
frère. Mais sa mère s’est fâchée avec celle de Ba Jin, et elles
ont quitté la maison. Après la mort de sa mère, elle a fini ses
jours enfermée avec son père qui, par pure cupidité, n’avait pas
voulu lui donner de dot. Quand Ba Jin l’a revue en 1942, elle
était devenue « une petite vieille frêle aux os fragiles » (她已经成了一个“弱骨支离”的“老太婆”了).
Et pourtant elle n’avait qu’un an de moins que lui.
|
On peut se demander pourquoi Ba Jin a ressenti le besoin
de dramatiser ces tragédies personnelles en les
concluant trois fois par une mort. C’était certainement
pour mieux frapper ses lecteurs, dans la grande
tradition du mélodrame chinois. Surtout, il était
influencé par ses souvenirs de lectures.
Toujours dans le troisième commentaire de 1957, Ba Jin
raconte avoir été frappé, dans son enfance, par un livre
illustré des « Biographies de femmes illustres » (《烈女传》),
grand classique confucéen qui était la lecture obligée
des jeunes filles de bonnes familles, donc de ses sœurs.
Il n’arrivait pas à comprendre le sort cruel réservé à
toutes ces femmes : une veuve qui se tranche la main
après avoir touché un étranger, une princesse qui brûle
vive dans son palais en feu pour ne pas s’exposer à la
vue des passants, une autre qui périt à la recherche du
corps de son père noyé, autant de femmes sacrifiées par
des rites absurdes, et offertes comme modèles. |
|

Edition 2003 de la trilogie, 1er volume |
Or ces rites gouvernaient toujours la vie des femmes, encore au
début de la République. Une de ses cousines épousa la tablette
de son fiancé défunt et termina son existence en veuve chaste
espérant son arche. En 1923 encore, sa troisième sœur, mariée en
secondes noces, fut emmenée en palanquin dans une maison où elle
fut tellement maltraitée par ses beaux-parents qu’elle mourut à
l’hôpital au bout d’un an.
Ce sont ces existences sans lustre, où affleure régulièrement le
drame, qui sont en arrière-plan du roman, et le rendent si
terriblement touchant. L’indignation de Ba Jin est dirigée
contre le système qui empêche les individus de s’épanouir, et
enferme les femmes dans un réseau de rites antédiluviens. S’il
dramatise, c’est parce qu’il ressent la réalité ainsi. C’est
tout un contexte familial et social dont il a souffert qu’il
exprime de la sorte.
Mais les trois jeunes frères qu’il dépeint sont, eux, pétris de
contradictions, et ont leur part de responsabilité. L’emprise de
la tradition sur les esprits était encore très forte. Ba Jin
lui-même a dit, citant Danton après Zola, qu’il lui avait fallu
beaucoup d’audace pour réussir à s’en affranchir.
Des personnages masculins pétris de contradictions
|
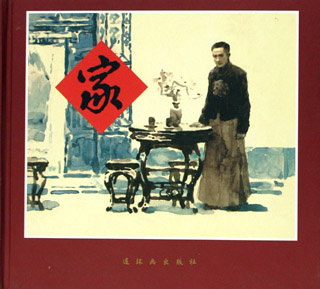
Lianhuanhua de novembre 1982,
réédité en 2004 |
|
C’est justement l’ambivalence des caractères masculins
qui donne une grande partie de sa valeur au roman.
Derrière le patriarche Gao, d’abord, se profile le
grand-père de Ba Jin, dont il reconnaît la clairvoyance
instinctive dans l’un de ses commentaires :
我的祖父虽然顽固,但并非不聪明,他死前已经感到幻灭,他是怀着寂寞、空虚之感死去的。
Malgré son caractère obstiné, mon grand-père ne manquait
pas de clairvoyance, et il avait senti que tout partait
en fumée bien avant de mourir ; il est mort avec au cœur
un sentiment de solitude, de vide. |
Juexin appartient encore à la génération qui souffre du système
sans oser s’y opposer. Les deux autres frères sont plus
audacieux, et rebelles chacun à sa façon. Mais, si Juemin arrive
à imposer le choix de son épouse, il reste lié par les
obligations familiales, Qin apparaissant comme son double
féminin. Le plus ambigu est Juehui, le plus rebelle, certes,
comme si l’âge opérait par lui-même une gradation dans le degré
de rébellion, mais tout en gardant un esprit encore profondément
empreint des idées traditionnelles : il ne lui viendrait pas à
l’idée d’épouser Mingfeng comme Juemin insiste pour épouser
Qin ; elle n’est après tout qu’une servante. Et son départ pour
Shanghai ressemble plus à un coup de tête qu’à une décision
réfléchie.
|
C’est l’un grand reproches que les critiques communistes
feront au roman : les personnages refusent l’ordre
ancien, mais sans trop savoir que mettre à la place, et
Juehui, en particulier, part à Shanghai sans savoir ce
qu’il va y faire. Le roman est empreint d’idéalisme
romantique et juvénile, mais c’est cela, justement, qui
l’a rendu si populaire auprès des jeunes lecteurs
chinois qui ont pu s’identifier aux personnages.
Un roman révisé à plusieurs reprises
Ba Jin a été critiqué après l’avènement du régime
maoïste, et aucune des rééditions de « Famille » n’a eu
lieu sans qu’il ait été obligé d’y apporter des
révisions. La première édition après 1949 est celle de
juin 1953, aux éditons Littérature du peuple.
C’est pour cette édition qu’il a écrit une postface, où
il indique qu’il a fait quelques corrections et éliminé
des redites. |
|

Livre illustré par Liu Danzhai 刘旦宅 |
Une autre édition a été établie en 1958 par les Editions
des langues étrangères de Pékin, dont ont été supprimées
certaines parties du texte (surtout celles qui pouvaient évoquer
son passé anarchiste). En même temps ont aussi été supprimées
les préfaces, et a été ajoutée une « note de l’éditeur » qui
explique pourquoi le texte nécessitait d’être révisé :
« Le roman expose l’hypocrisie et les maux de la société féodale
et révèle les côtés sordides des relations familiales dans cette
société. Parce qu’il a poussé les jeunes intellectuels à lutter
contre ce système pourri, ce roman a joué un rôle positif.
Mais il a ses défauts,
le principal étant que l’auteur loue la résistance spontanée et
individuelle des intellectuels petits-bourgeois sans souligner
leurs faiblesses ni insister sur la nécessité de se joindre aux
travailleurs et paysans. Il ne montre donc pas à ses lecteurs le
chemin vers la lumière. »
L’éditeur terminait sa note en reconnaissant cependant que Ba
Jin était capable d’écrire de façon très colorée et émouvante
quand il évoquait son expérience personnelle. C’est ce que la
postérité en a retenu. « Famille », en ce sens, est l’une de ses
œuvres les plus représentatives.
Nuit glacée
《寒夜》
Voir l’analyse comparative du roman et du film de Que Wen (阙文)
qui en est adapté :
http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Que_Wen.htm
Le roman a commencé à être sérialisé pendant l’année
1931 dans le quotidien Le temps (《时报》),
à raison d’environ mille caractères par jour. Mais, à
cause des combats, le journal a cessé de paraître
pendant quelques temps, avant de reprendre. Ba Jin a
alors reçu une lettre du rédacteur en colère accusant
son texte d’être beaucoup trop long et l’informant
qu’ils ne pourraient pas continuer à le publier. Ba Jin
a alors envoyé la totalité de ce qui restait du
manuscrit, en ajoutant que, si le journal voulait bien
terminer de le publier, il renonçait à sa rémunération.
C’est ainsi seulement que le roman a pu finir de
paraître dans le journal.
|
|

