|
|
Zheng Yi
郑义
Présentation
par Brigitte Duzan, 04 décembre
2013
|
Zheng Yi s’est
fait connaître par les recherches qu’il a effectuées
dans le Guangxi à partir de 1986, sur les actes de
cannibalisme commis dans cette région frontalière
pendant la Révolution culturelle. Son livre sur le sujet
a éclipsé les nouvelles qu’il avait écrites auparavant,
dont « Le vieux puits » (《老井》),
adapté au cinéma par Wu Tianming (吴天明) en 1986. Il faut y revenir.
Huit ans
de galère, et une bouffée d’espoir
De son vrai nom
Zheng Guangzhao (郑光召),
Zheng
Yi est né en 1947 à Chongqing, dans le Sichuan, où son
père était un cadre de la Mingsheng Shipping Company (民生轮船公司).
Garde rouge,
jeune instruit au Shanxi |
|
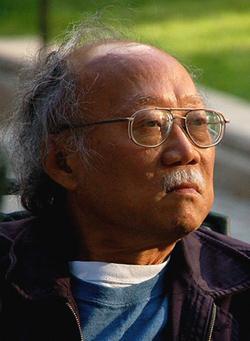
Zheng Yi en 2007 |
Arrivé à Pékin à l’âge
de dix ans, en 1957, il fait ses études secondaires au lycée
attenant à l'université Qinghua (清华附中).
Quand est lancée la Révolution culturelle, l'université est un
foyer d’agitation, et un bastion des Gardes rouges ; elle
restera fermée jusqu’en 1978. La violence est particulièrement
dure au lycée. Zheng Yi est dénoncé pour ses origines de classe,
et sévèrement battu, comme nombre de ses camarades.
Il devient lui-même
Garde rouge, et, en 1968, fait partie des "jeunes instruits" qui
partent à la campagne, en réponse à l’appel du président Mao. Il
se retrouve avec neuf camarades à vivre dans des conditions
rudimentaires dans un petit village de neuf foyers du district
de Taigu (太谷县),
dans les monts Taihang (太行山), dans le Shanxi.
Il a expliqué (1) qu’il
était parti plein d’enthousiasme, convaincu qu’ils allaient
réformer le pays, lui insuffler un vent de liberté, et lutter
contre le favoritisme et les déviances du Parti. Son
enthousiasme a duré trois ans. Peu à peu, il s’est rendu compte
que leurs efforts étaient vains, qu’ils devaient appliquer des
programmes irréalistes : défricher les montagnes, créer des
champs dans des ravines…
Surtout, ils avaient
encore moins de liberté dans le village qu’ils n’en avaient à
Pékin. Ils n’avaient même pas de livres ; la bibliothèque du
district avait été fermée. En cultivant de bonnes relations avec
un ancien employé de la bibliothèque, il réussit à obtenir
quelques livres qu’il emporta en cachette. Mais il avait le
sentiment d’être dans une voie sans issue, et sans avenir.
Vagabond sans espoir
Il exprima ses
désillusions et ses doutes dans une lettre à un ami. Elle fut
découverte, et il ne lui resta plus qu’à fuir. Il vendit sa
montre, en tira quarante yuans et partit dans le Nord-Est. Il
trouva du travail comme menuisier dans la région des monts
Daxing’an (大兴安岭),
en Mongolie intérieure, une chaîne de montagnes sauvages et
boisées, très isolées.
Il erra ainsi dans la
région, de petits boulots en petits boulots, quand un jour, dans
une petite gare près de Harbin, il entendit dire que Lin Biao (林彪)
était mort (2). Il pensa aussitôt avec un immense espoir que les
choses allaient changer : il plia bagages et partit à Pékin.
Pour découvrir que rien, en fait, n’avait changé et n’allait
changer. Déçu à la fois par la campagne et par la ville, il
sombra dans le désespoir le plus complet.
Ouvrier dans une
mine de charbon
A partir de 1972,
cependant, la situation des "jeunes instruits" s’améliore
quelque peu. Certains sont admis en université, d’autres envoyés
travailler en usine.
En 1974, Zheng Yi se
retrouve charpentier dans une mine de charbon, dans la région
des monts Lüliang (吕梁山),
à l’ouest du Shanxi. Il va y rester jusqu’à la fin de la
Révolution culturelle.
1976 et après
En 1976, les années de
galère s’achèvent, pour Zheng Yi comme tant d’autres, sur la
perspective de pouvoir enfin continuer ses études. Il n’est
cependant pas encore question de revenir à Pékin : il doit
rester dans le Shanxi. Il entre à l’Ecole normale de Jinzhong,
dans le district de Yuci (榆次区),
pour étudier la littérature chinoise (晋中师专中文系),
puis devient rédacteur du Journal des lettres et des arts de
Jinzhong (晋中文艺).
Il est ensuite muté à
Taiyuan, la capitale de la province, et y fonde le journal
littéraire Le fleuve jaune (《黄河》).
En même temps, il commence à écrire, des poèmes et quelques
textes qui circulent sous le manteau. Il abandonne bientôt ses
activités éditoriales pour devenir écrivain professionnel et se
consacrer à l’écriture.
Ecrivain, auteur
de nouvelles
|
Début 1979, il
publie une première nouvelle qui fait sensation : « L’Erable »
(《枫》),
qui paraît le 11 février dans le Wenhuibao (文汇报)
de Shanghai. Mais il a écrit auparavant une première
nouvelle qu’il a cependant eu peur de signer de son
propre nom.
Le Sourire
figé
Cette nouvelle
s’intitule « Le sourire figé » (《凝结了的微笑》).
Zheng Yi
y décrit l’histoire tragique de deux "jeunes instruits",
un frère et une sœur, qui avaient été envoyés dans les
vastes territoires sauvages du Grand Nord (大荒北).
Apprenant que leur père vient d’être libéré de prison
après la mort de Lin Biao, ils décident de revenir à
Pékin pour le voir ; cependant, comme ils n’ont pas
d’autorisation, ils doivent |
|
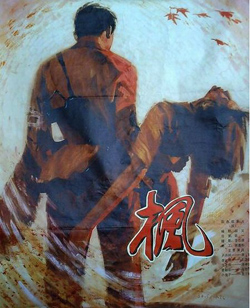
L’Erable, l’affiche du film |
partir en cachette et
n’ont d’autre solution que de faire le voyage cachés dans un camion.
A l’arrivée, on les trouve morts de froid.
A travers cette
histoire symbolique, Zheng Yi a voulu exprimer le caractère
inhumain de la Révolution culturelle telle qu’il l’a lui-même
vécue, et l’absurdité d’une politique qui a sacrifié une
génération entière de jeunes de son âge. Il a commencé à
l’écrire en 1978, mais a eu peur des ennuis que cela pouvait lui
attirer ; il a donc transformé le Grand Nord chinois en Sibérie,
Pékin en Moscou, et ajouté à la fin : traduit d’une nouvelle
parue dans le Quotidien de la Volga, sans même savoir s’il
existait un journal de ce nom.
La nouvelle est parue
incognito dans un journal de Canton, le Huacheng (《花城》).
L’Erable
« L’Erable »
(《枫》),
en revanche, eut un succès immédiat. L’histoire se passe au
début de la Révolution culturelle, au pire moment des luttes
entre factions de Gardes rouges. Deux jeunes, amoureux l’un de
l’autre, sont entraînés dans des bandes rivales ; dans le combat
final, la jeune fille se suicide en sautant du haut de
l’immeuble où elle est réfugiée, après avoir été blessée par son
ancien ami. C’était
la première nouvelle à traiter d’un tel sujet.
Elle fut adaptée au
cinéma dès l’année suivant sa parution, en 1980. Le film fut
réalisé au studio Emei du Sichuan par le réalisateur Zhang Yi (张一).
En août 1979, la nouvelle avait aussi fait l’objet d’une
publication en feuilleton dans un journal illustré, le
Liánhuán huàbào《连环画报》 ;
l’affiche du film reprit l’une des dernières illustrations de la
série.
Le succès de ce récit
prit Zheng Yi de court. A la fin d’un article de septembre 1979
publié dans le même Wenhuibao, il regrettait de l’avoir
écrit trop vite et sans réfléchir ; la nouvelle – qu’il
qualifiait à dessein d’« exercice » (习作)
- avait
donc beaucoup de défauts, dit-il :
...这些缺点不是偶然的,是工夫不深,还有待于长期努力
… ces défauts ne
sont pas étonnants, ils reflètent une écriture qui manque de
profondeur, il y a encore un long travail à faire.
(3)
« L’Erable » est à replacer dans le cadre du
courant de
littérature des cicatrices
(文革伤痕小说) qui souffre, dans l’ensemble, des mêmes
imperfections. Mais Zheng Yi voulait surtout calmer tout risque
de dérive politique, la bande dessinée, puis le film, ayant
suscité des controverses. Il cesse ensuite d’écrire directement
sur la Révolution culturelle pour aborder des thèmes ruraux,
dans des nouvelles à rattacher à la
littérature de recherche des racines (寻根文学), qui
correspondent cependant aussi à son expérience personnelle.
Le village lointain
et Le vieux puits
Il publie quelques
autres nouvelles – « Le Saule » (《柳》),
« Pluies d’automne sans fin » (《秋雨漫漫》),
« Le brouillard mystérieux » (《迷雾》),
«La rivière gelée » (《冰河》)
– qui ne rencontrent cependant pas beaucoup d’échos.
Il devient célèbre
avec les deux nouvelles ‘moyennes’ (中篇小说)
publiées en 1983 et 1985, dans la revue Dangdai (《当代》杂志)
: « Le village lointain » (《远村》)
et « Le vieux puits » (《老井》).
Toutes deux témoignent
des conséquences dramatiques de la pauvreté et du manque d’eau
sur les coutumes et les mentalités ; elles se passent dans la
région du Shanxi qu’il connaît bien, et dont il a lui-même
expérimenté les difficiles conditions de vie.
|
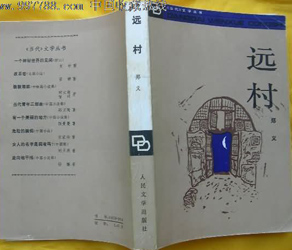
Le village lointain, recueil de 1986 |
|
La première,
« Le village lointain », se passe dans les monts
Taihang ; c’est sans doute une histoire dont il a été
témoin ou qu’on lui a racontée – ou tout simplement une
histoire qui était tellement courante qu’elle en devient
symbolique ; on en retrouve un écho dans « Le vieux
puits ».
La nouvelle
raconte un triste mariage arrangé entre un jeune garçon
amoureux d’une de ses camarades de classe, mais obligé
d’épouser une autre jeune fille pour que sa sœur puisse
en même temps épouser le frère de sa future épouse, de
manière à faire des économies sur les frais du mariage.
|
Zheng Yi souligne
ainsi l’altération des relations humaines induite par la
pauvreté, plus encore que par les coutumes, et sa peinture est
d’autant plus cruelle que le carcan oppressif imposé aux jeunes
est opposé à la liberté du chien du jeune homme, libre de partir
à l’aventure se chercher une partenaire quand bon lui semble.
|
Quant à la
seconde nouvelle, « Le vieux puits », c‘est sans
doute la plus célèbre car elle a été adaptée au cinéma
par Wu Tianming (吴天明)
en 1986, avec Zhang Yimou dans le rôle principal, et que
le film a été couronné de nombreux prix.
Zheng Yi y
relate la quête d’eau sisyphéenne d’un village du Shanxi
qui s’appelle, justement, « Veux puits », mais le vieux
puits en cause est sec depuis longtemps. La quête
millénaire de l’eau, qui est aussi une tradition
familiale, est maintenant reprise par un jeune qui
revient au village après avoir fait des études en ville
:
Sun
Wangquan (孙旺泉).
C’est aussi
pour lui un retour aux traditions de mariages
arrangées, renforcées, comme dans « Le village
lointain », par la pauvreté. Wangquan est amoureux d’une
de ses anciennes camarades de classe,
Zhao Qiaoying |
|
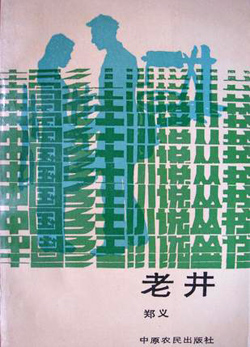
Le vieux puits, recueil de 1992 |
(赵巧英),
qui est elle aussi revenue de la ville après ses études.
Mais il est obligé d’épouser une jeune
veuve du village, car sa dot permettra de payer les frais du
mariage de son jeune frère.
Finalement, la quête
d’eau et le forage d’un nouveau puits qui porte toutes les
espérances de survie des villageois permettent à Wangquan de
retrouver, au-delà du sacrifice, le sens de la communauté, et
une symbiose avec la terre, et la nature.
Qiaoying,
elle, repartira à la ville…
Il y a toute une
dimension symbolique dans cette quête d’eau, qui se trouve
rejoindre la quête des racines à l’apogée du mouvement (4).
A partir de 1986,
cependant, Zheng Yi se lance lui-même dans une autre quête ; il
n’écrira plus de nouvelles, seulement un roman, « L’arbre aux
esprits » (《神树》),
publié en 1996.
Enquête au
Guangxi et exil aux Etats-Unis
Enquête sur le
cannibalisme
|
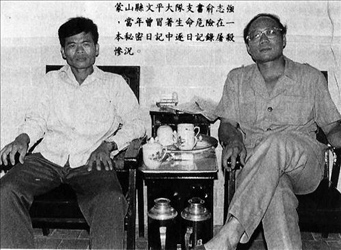
Zheng Yi au Guangxi en 1986 avec un de
ses interlocuteurs |
|
Il se rend au
Guangxi pour la première fois pendant l’été 1986 pour
enquêter sur des histoires de cannibalisme qu’on lui a
racontées et qui auraient eu lieu dans cette région
frontalière pendant la Révolution culturelle. Il
a d’abord
l’intention d’en faire un roman,
mais
l’atrocité des faits que lui relatent les personnes
qu’il interroge et qui en ont été témoins le fait
changer d’avis. Il y revient continuer son enquête en
1988.
Il découvre
peu à peu avec stupeur et horreur que, dans les années
1968-69, les séances |
d’accusation publique
se sont souvent terminées dans la région en meurtres et
dépeçages, faits
isolés d’abord, mais
prenant peu à peu des proportions d’hystérie collective.
Il en fait un
réquisitoire contre les autorités, et le système tout entier,
qui ont attisé la haine dans ces populations, en liant le
phénomène – au-delà des contingences de la Révolution culturelle
– aux dérives inhumaines que peut entraîner un pouvoir
totalitaire.
|
En 1989,
cependant, il prend une part active aux événements de
Tian’anmen, et il est obligé de se cacher pour éviter
d’être arrêté. C’est pendant cette période qu’il écrit
onze lettres à son épouse Bei Ming (北明),
lettres où il consigne les premiers résultats de ses
enquêtes au Guangxi. Il réussit à les faire passer à Liu
Binyan (刘宾雁)
aux
Etats-Unis ; elles seront publiées à Hong Kong en 1993,
sous le titre « Un épisode historique, onze lettres
jamais envoyées » (《历史的一部分,永远寄不出的十一封信》).
L’ouvrage
terminé, quant à lui, a été publié à |
|
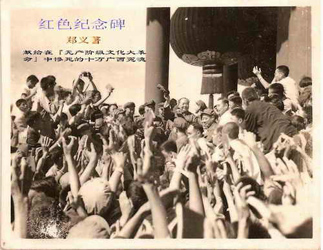
Stèles rouges |
Taiwan en 1993 sous le
titre « Stèles rouges » (《红色纪念碑》).
Exil aux Etats-Unis
|

Avec son épouse Bei Ming et Vaclav Havel
en 2006 |
|
Zhen Yi réussit
à passer à Hong Kong avec Bei Ming en mars 1992, et de
là aux Etats-Unis en décembre. Il y vit toujours.
Il fait partie
de l’association des écrivains chinois indépendants, et
a fait paraître ces douze dernières années divers
ouvrages sur les problèmes que doit aujourd’hui
affronter la Chine, dont les problèmes écologiques, et
toujours en lien avec le système totalitaire.
|
Notes
(1) Selon un entretien
avec Leung Laifong. Voir : Morning Sun, Interviews
with Chinese Writers of the Lost Generation, by Leung Laifong,
M.E. Sharpe Inc, 1994.
Pp. 259-269.
(2) Lin Biao est mort
le 13 septembre 1971. A la tête de l’APL, il était considéré
comme la cheville ouvrière de la Révolution culturelle ; c’est
lui qui avait conçu le Petit livre rouge qui portait une
épigraphe de sa main. Sa mort n’a cependant été annoncée dans la
presse qu’en 1972.
(3) Voir l’article « De
mon exercice d’écriture ‘L’Erable’ » (谈谈我的习作《枫》),
paru dans le Wenhuibao du 6 septembre 1979 :
http://www.tianyabook.com/renwu2005/js/z/zhengyi/000/002.htm
(4) Le texte de la
nouvelle Le vieux puits, en chinois :
http://emuch.net/html/201207/4755484.html
Traductions en
français
- Stèles rouges, du
totalitarisme au cannibalisme,
trad. Françoise Lemoine & Anne Au Yeung, Bleu de Chine, 1999.
Extrait :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/perch_1021-9013_1993_num_11_1_1628
- Prière pour une âme
égarée, trad.
Bernard Bourrit & Zhang Li, Bleu de Chine, 2007
- Enquête sur le
massacre de Binyang au Guangxi, dans Les Massacres de la
Révolution culturelle, textes réunis par Song Yongyi, trad.
Marc Raimbourg, Buchet/Chastel, rééd. Gallimard /Folio
Documents, 2008
Traductions de
nouvelles en anglais
- Old Well, tr.
David Kwan, China Books & Periodicals, février 1990, 176 p.
- Maple, in Perry
Link, Stubborn Weeds : Popular and Controversial Chinese
Literature after the Cultural Revolution, Indiana University,
1983, pp. 57-73.
- Morning Fog,
Chenwu, tr. Li Huoqing, Chinese literature, Autumn 1989, pp.
38-49.
|
|

