|
|
« Clefs pour la
Chine » de Claude Roy : plongée dans la Chine du début des
années 1950
par Brigitte Duzan, 7 février 2021
|
C’est en 1953 qu’est paru chez Gallimard le récit du
voyage en Chine fait par Claude Roy au tout début
des années 1950. Intitulé Clefs pour la Chine,
c’est bien plus que des clefs, présentées par thèmes
allant de la géographie et de l’histoire en toile de
fond à la peinture de la vie au quotidien dans une
Chine en pleine effervescence au lendemain de la
fondation de la République populaire. C’est une
vision émerveillée, poétique et pleine d’humour,
d’une Chine qui baignait encore dans l’enthousiasme
de l’épopée révolutionnaire, et le transmettait aux
rares voyageurs qui en faisaient la découverte.
C’est un précieux témoignage, qui se lit aujourd’hui
avec la nostalgie d’une époque qui promettait tant.
Voyage au long cours aux sources de la Chine maoïste
|
|
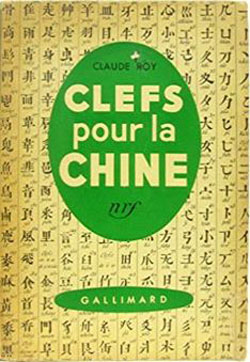
Clefs pour la Chine, 1953 |
La genèse de ce voyage reste assez mystérieuse, le texte ayant
été publié sans introduction et ne présentant aucune explication
sur l’organisation du voyage, ni aucune date précise, hormis un
mois de-ci de-là, au détour d’une page.
Raisons du voyage
|
Ses motivations ressortent assez clairement de son
chapitre sur la Chine dans le deuxième volume de son
autobiographie, Nous, publié en 1972, chez
Gallimard aussi. Ce qui l’a poussé vers la Chine,
c’est essentiellement sa déception du régime
soviétique, lui qui était communiste depuis 1943
et cultivait un idéal humaniste de socialisme
délivré de la tentation totalitaire. Dans une très
belle page, au début de ce chapitre, il dit, avec
l’humour qui le caractérise, l’enthousiasme un peu
aveugle des voyageurs revenus d’Union soviétique,
tels Paul Éluard et Loleh Bellon
qui avaient fait des centaines de kilomètres sur des
routes défoncées et à qui leur guide avait expliqué
que c’était exprès que ces routes étaient maintenues
dans cet état, pour freiner l’avance d’éventuels
convois ennemis :
« Brecht disait déjà en 1935, à son ami le
philosophe marxiste Walter Benjamin, qu’il se
dégageait de la Russie de Staline « une puanteur
pénétrante ». Comme l’odeur ne s’était pas
|
|
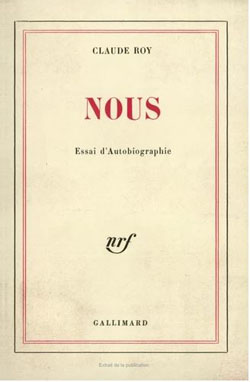
Nous, 1972 |
arrangée dans les années cinquante, nous tournions nos narines
vers d’autres horizons. Je m’étais mis alors à étudier le
chinois, où j’eus peu de persévérance, donc peu de succès. […]
J’étais déterminé à me rendre en Chine le plus tôt possible.
Quand j’y parvins, je ne fus pas déçu, mais ébloui
d’espoir… »
(Nous, p. 487)
Il poursuit, un peu plus loin :
« L’attirance que la Chine populaire exerça sur moi, et qu’elle
exerce encore sur tant d’hommes de gauche occidentaux, n’est
peut-être qu’un cas particulier de cette loi générale qui porte
à idéaliser ce qui est loin pour se consoler de ce qui, tout
près, est si peu idéal. Ceux que révolte l’absurdité
fondamentale des sociétés actuelles, quand l’espoir semble
s’éloigner de les réformer et d’en révolutionner le cours ici,
reportent alors sur le planisphère la mise de leurs espoirs. Ils
transfèrent leur enjeu là-bas, ailleurs, loin… » (Nous,
p. 488)
C’est donc un rêve qu’il poursuit en partant, un idéal à
concrétiser : en prenant l’avion pour Pékin, dit-il, il ne se
posait pas trop de questions :
« J’allais demander au vent d’est de me donner un peu
d’oxygène. Je le
trouvai. »
(Nous, p. 490)
« J’assistai à la grande rentrée des classes de
l’histoire. » (Nous, p. 491)
Il part, lesté de littérature, « retrouver Jules Verne,
pressentir Tchouang-Tseu, obéir à Claudel, vérifier Karl Marx »,
mais surtout « me consoler de Staline » (Nous, p. 493).
Cependant, on n’en sait pas plus sur l’organisation de ce
voyage, qui n’a pas dû être évidente. Au tout début de Clefs
pour la Chine, il écrit : « Lundi. Un télégramme : je
pars jeudi matin pour Pékin. Je rêve de ce voyage depuis
vingt-trois ans… » Et une dizaine de lignes plus bas : « Mercredi.
… Je n’aurai le visa chinois qu’à Prague : la France n’a pas
reconnu le gouvernement chinois… » Il est à Pékin le
mercredi suivant, après une escale à Moscou et une tempête
au-dessus du désert de Gobi.
Quel lundi, quels mercredis, on ne sait pas.
Le mystère des dates
Les dates exactes du voyage ne sont pas précisées, bien qu’il
s’agisse en fait d’une période bien précise. Il faut donc
reconstituer le parcours pour lui donner tout son sens, à partir
de deux événements dont Claude Roy a été le témoin privilégié :
la Réforme agraire et la guerre de Corée.
On trouve deux indications dans Nous :
« En juin, je quittai pour quelque temps Wang Kai [son jeune
interprète] et mes amis de Pékin pour suivre Yves Farge en
Corée. »
(p. 497)
« À mon retour en Chine, j’allai étudier un peu de près la
Réforme agraire, alors en
cours. »
(p. 500)
La loi de Réforme agraire (土地改革法),
l’une des premières du régime, a été adoptée le 28 juin 1950, et
la campagne s’est poursuivie jusqu’en 1953, avec un point
culminant en 1951-52. Quant à la guerre de Corée, elle s’est
déroulée à peu près au même moment, du 25 juin 1950 à fin
juillet 1953. Dans Clefs pour la Chine, Claude Roy rend
hommage à Yves Farges quand il apprend son décès alors que le
livre est sous presse et il mentionne qu’il était avec lui à
Pékin le 1er mai 1952.
Il est donc parti avec lui en Corée en juin1952.
Il mentionne à nouveau l’année 1952 dans le
chapitre sur la Réforme agraire,
pour dire qu’il était dans le village en été et qu’il faisait
très chaud ; il évoque ensuite sa vision de la Chine à la fin de
l’année.
On peut donc en déduire que Claude Roy est resté une bonne
partie de l’année 1952 en Chine, vraisemblablement d’avril à la
fin de l’année : il précise à la fin qu’il a écrit le livre
d’avril 1952 à avril 1953. C’est un témoignage rarissime sur la
période cruciale des débuts de la Chine nouvelle : celle de
l’enthousiasme et de l’espoir.
Un témoignage unique sur la Chine de 1952
Débarquant dans une Chine en ébullition, Claude Roy communie
dans la même ferveur révolutionnaire, la même folle ambition de
créer un pays nouveau, sur des bases nouvelles, éradiquant d’un
coup les injustices et les terribles inégalités du passé, et la
faim en particulier.
Il a divisé son ouvrage en trois parties : I. Premières vues,
soit ce qui saute aux yeux en arrivant, II. Retour en arrière,
pour faire un point sur l’histoire, et III. Vues secondes, sur
« les mouvements de l’esprit » et la culture. Ce sont dans tous
les cas des pages d’une écriture qui transporte, par l’acuité du
regard qu’elle révèle, et l’humour dévastateur et toujours
réjouissant avec lequel il nous décrit ce qu’il voit, et surtout
avec lequel il dresse des portraits de personnages.
Acuité du regard
Dans la première partie, après des considérations générales sur
le pays et son peuple, il nous offre (p. 68 et sq) des « pages
de journal » notées dans le désordre, qu’il justifie d’une
citation de Victor Hugo : « Je mêle les petites choses aux
grandes, comme cela vient… L’ensemble peint. » Et cela peint
très bien sous la plume incisive de Claude Roy.
La « Nouvelle loi sur le mariage » (新婚姻法)
a précédé la loi sur la Réforme agraire : elle a été adoptée le
1er mai 1950. Claude Roy note : « Le Journal du
peuple de ce matin donne des détails des tribunaux spéciaux de
divorce de la région du Foukien. Plus de 80 % des demandes de
divorce ont été introduites par des femmes ». Il ajoute juste
deux chiffres pour donner le contexte : l’un concernant le
nombre de fiancées-enfants dans un district de la région en 1949
(80 %) et l’autre le nombre de suicides féminins dans un autre
district.
Voilà pour l’émancipation des femmes. Nul besoin de discours
supplémentaire. (Du moins pas dans ce chapitre, il consacre tout
un chapitre, un peu plus loin, au « malheur d’être femme », puis
le suivant à l’application de la loi sur le mariage dans les
villages, ce qu’il appelle « La possibilité d’être femme »).
Même concision, dans ces « pages de journal », pour noter les
efforts de lutte contre l’illettrisme dans les campagnes :
« Grand titre à la une du Journal du peuple ce matin :
« Vingt-sept mille stylos vendus en une semaine par les
coopératives paysannes du Nord Hopei. » Sous-titre :
« Développements exceptionnels de la culture dans les masses
rurales. »
Les piques contre le Guomingdang et Tchang Kai-chek abondent.
Ainsi, rapporte-t-il, un philologue lui raconte que le
Guomingdang préférait changer le nom des choses pour s’épargner
la peine de les changer elles-mêmes. Et suit un savoureux petit
catalogue des changements de noms de ruelles à Pékin. Et son
philologue de lui citer Marat : « Trompés par les mots, les
hommes n’ont pas horreur des choses les plus odieuses décorées
de noms nobles, et ils ont horreur des choses bonnes cachées
sous des noms odieux. » Ce qui est autrement plus original que
de citer Confucius (sur la rectification des noms) et souligne
l’immense culture des lettrés chinois à l’époque, relayée par
celle de Claude Roy : ils s’entendaient à merveille.
Il consacre tout un chapitre, après les deux consacrés aux
femmes et au mariage, aux « Dieux du fleuve » (p.102 & sq), et
c’en est presque un appendice. En effet, Claude Roy s’étend sur
les anciens rituels visant à lutter contre les inondations et la
sécheresse, l’un étant le revers de l’autre, comme il le dit
dans une de ses formules qui frappent : « Trop d’eau, c’est la
famine. Pas assez d’eau : c’est aussi la famine ». Tous les
grands fleuves débordent régulièrement, le Yangtsé en tête.
Alors on bâtit des temples, au Dieu du Fleuve, où les paysans
vont porter leurs offrandes… sur lesquelles les prêtres
prélèvent leur part. Mais le Fleuve réclamait aussi sa « part de
chair fraîche » : des jeunes filles lui étaient sacrifiées.
Claude Roy cite ensuite les progrès réalisés pour dompter les
fleuves, en lançant un solennel appel aux paysans, qui au départ
n’étaient pas très enthousiastes, parce qu’ils se souvenaient
des taxes et des corvées prélevées régulièrement depuis l’aube
des temps pour les travaux hydrauliques, mais aussi des
désastres provoqués tout récemment encore pendant la guerre
contre le Japon par la rupture des digues qu’ils avaient
eux-mêmes construites, le Guomingdang ayant tenté d’arrêter
l’avancée des troupes japonaises en inondant des provinces
entières… Mais, dit Claude Roy admiratif, tout avait changé car
la terre qu’on leur demandait de préserver était désormais la
leur et le Parti réussit par la persuasion, non par la
contrainte - non par la force, mais par l’enthousiasme.
Retour sur l’histoire
Dans sa deuxième partie, Claude Roy revient sur l’histoire pour
souligner les injustices, la corruption, le népotisme, qui,
après des tentatives de réforme avortée dans un pays sombrant
dans l’impuissance, ont conduit à la révolution. Là encore, ce
qui prime, ce n’est pas tant ce qu’il dit, que la manière dont
il le dit, et les choix proposés. On notera en particulier son
éloge appuyé des Taipings (太平天国),
qu’il conclut ainsi avec un clin d’œil acerbe :
« Les Taï Pings battus, Hong [leur chef Hong Xiuquan 洪秀全]
se suicida
.
C’était d’un mauvais chrétien. La révolte avait duré dix-sept
ans et coûté la vie à seize millions d’hommes. […] Les
survivants des grands massacres durent trouver que les chrétiens
blancs manquaient de logique : les Taï Pings avaient pourtant
voulu appliquer leurs principes. Ils se détournèrent d’une
religion dont les représentants décapitent ceux qui veulent un
peu trop fermement la réaliser, et tiennent que le royaume des
cieux … doit rester suspendu vaguement dans le ciel et ne pas
essayer de descendre sur terre. Dieu était-il chinois ? les
Célestes étaient maintenant enclins à croire qu’il était plutôt
anglais, et négociant. »
(Clefs, p. 122)
Et il continue - il eût été dommage de s’arrêter là - en
décochant l’une de ses superbes piques dont ses Clefs
abondent :
« En écrasant les Tai¨Pings, les Occidentaux avaient rendu un
grand service à la cour de Pékin. Celle-ci fut d’une ingratitude
déplorable. L’empereur avait à payer le prix de cette victoire.
Il tergiversa, louvoya, retardant de jour en jour la
ratification des accords signés à Tien-Tsin en 1858. Les Anglais
dépêchèrent en Chine Lord Elgin : il fallait en finir.
Le père de Lord Elgin avait dérobé les sculptures du Parthénon
en Grèce. Son fils présida à l’incendie du Palais d’Été en
Chine… »
Il essaie de le racheter en le montrant au service de son pays,
ce qui l’obligeait à « faire taire ses scrupules » dont il ne
manquait pourtant pas. Et Claude Roy de citer un passage de son
journal où il notait ses « réflexions amères » sur le pillage
« de cette antique civilisation ». Mais le coup final est
d’autant plus brutal :
« Mais il servait sa Reine et les manufactures de sa patrie.
L’histoire contemporaine est peuplée ainsi d’instruments
lucides : ils voient le meilleur et exécutent le pire. »
|
Au théâtre, on applaudirait. Et qu’on se rassure :
il y en a autant pour les Français, Pierre Loti en
tête dont on lit avec délectation un superbe
portrait dans la série des Papiers d’identité
qui nous en livre de savoureux. Le portrait vachard
de Loti est ponctué de citations des articles
envoyés au Figaro où les lecteurs du journal
trouvaient « ce qu’ils attendaient : du sang (à la
une), de la volupté (en beau style) et de la mort
(plus qu’orientale). Le tout assaisonné d’une dose
convenable de pitié courtoise. » Les articles ont
été publiés par Loti sous le titre Les Derniers
Jours de Pékin et Claude Roy conclut :
« Relisant ces articles incroyables, on se demande
si cet huluberlu était simplement une canaille, ou
si cette canaille n’avait pas des côtés d’huluberlu.
Mais non : Loti n’était qu’un bourgeois-soldat
français, en 1900, assuré de la mission
civilisatrice des armes qu’il servait, et persuadé
que les |
|
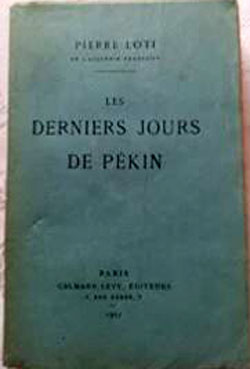
Les derniers jours de Pékin, 1925 |
Chinois, non, on ne parviendra jamais à pénétrer "ces très
vieilles humanités, incompréhensibles pour nous et presque un
peu fabuleuses". Fin. » (Clefs, p. 127)
Papiers d’identité
Ce sont ces portraits pleins d’un humour décapant qui sont parmi
les pages les plus réussies des Clefs pour la Chine,
émergeant ça et là au détour d’un chapitre sous le titre
Papiers d’identité. Les intéressés n’en ressortent pas
grandis, mais c’est l’occasion d’un délicieux moment de lecture.
Tout le monde y passe, à commencer par Sun Yat-sen (pp.
129-135). On n’a pas l’habitude de portraits aussi
irrévérencieux de lui, c’est d’autant plus drôle. Fils de
paysans misérables, « commis voyageur de la révolution », il
court le monde en quête d’argent pour fonder des journaux et
organiser des insurrections qui ratent, infailliblement ; ses
amis sont pris, torturés, exécutés, pas lui, il s’en sort
toujours, prend la fuite, part ailleurs, déguisé en coolie, en
femme, en mendiant, le visage enduit de terre, et recommence.
Leitmotiv de son autobiographie : « ce fut notre énième échec. »
Et puis un soir, après le dixième, il est au fin fond du
Colorado, il reçoit un télégramme lui annonçant « leur »
nouvelle tentative de soulèvement. Mais il n’a plus un sou. Il
décide donc d’envoyer le lendemain un télégramme pour retarder
ledit soulèvement, et va se coucher en attendant. Le lendemain
matin, au réveil, il apprend que tout le sud de la Chine est aux
mains de ses amis, que la République est proclamée ; il rentre
illico en passant par Londres et Paris pour collecter des fonds
au passage et se présente à l’Assemblée nationale de Nankin où
il est triomphalement élu Président de la République…
C’est sa première victoire, dit Claude Roy, mais pas longtemps :
Yuan Shikai lui aussi s’est fait élire président de la
République, dans le nord, lui. Et lui, il a tout, l’argent, les
soldats et la ruse. Il négocie, Sun Yat-sen lui remet les
pouvoirs, et Yuan Shikai reconnaissant le nomme … directeur des
chemins de fer. Immense éclat de rire. On est en pleine farce de
village.
Et la farce continue avec un autre portrait tout aussi décapant.
Car, pendant que Yuan Shikai se proclame empereur, fait
massacrer les membres du Guomingdang et entreprend de faire
assassiner Sun Yat-sen, celui-ci file au Japon, et se remarie.
Avec qui ? « Avec l’une des filles d’un colporteur de hamacs qui
avait fait fortune en imprimant des Bibles chinoises pour les
missionnaires », vous n’aurez peut-être pas reconnu le
richissime Charles Soong, père des épouses respectives de Sun
Yat-sen, Tchang Kai-chek et le banquier Kong Xiangxi, celles que
Claude Roy appelle « les trois filles du colporteur Soong ».
Quant à Sun Yat-sen, raté jusqu’au bout, il meurt d’un cancer du
foie le 12 mars 1925 : « premier chef d’Etat chinois qu’on voit
mourir pauvre ». Il faut dire quand même que, en 1952, Claude
Roy n’avait pas eu le temps d’en voir défiler beaucoup, des
chefs d’Etat chinois…
On a un chapitre entier sur Tchang Kai-chek qui est tout aussi
savoureux (p. 146). Claude Roy s’y livre en particulier à une
analyse de la doctrine de la « Vie nouvelle »
,
chaque précepte étant mis en parallèle, entre parenthèses, avec
la situation misérable de la population. On aimerait citer tous
les exemples, le premier étant le Précepte 6 : « Prenez vos
repas à des heures régulières, mangez modérément, tenez-vous
bien à table ». Commentaire : en 1932, la Chine connut l’une des
plus grandes famines de son histoire…
Cette verve se calme ensuite quand sont dépeints les grands
moments et les grands personnages de la geste révolutionnaire.
Il n’est plus question de rire.
De la comédie à l’épopée
Le ton change donc vers le milieu du livre quand Claude Roy
aborde ce qu’il faut bien appeler l’épopée maoïste, en
soulignant le caractère prémonitoire de la pensée de Mao
abandonnant la doctrine marxiste de révolution urbaine et
ouvrière en préconisant une révolution partant des campagnes,
menée par les paysans.
Mais, là encore, le morceau de bravoure est fourni par un
Papier d’identité, celui de Li Po-tsao, 43 ans, rencontrée à
Pékin dans la vieille maison abritant l’Association des auteurs
dramatiques (pp. 168-175). Il s’agit de l’une des survivantes de
la Grande Marche, devenue dramaturge et écrivaine après 1949 :
Li Bozhao (李伯钊)
.
C’est l’une de ces personnalités rares rencontrées par Claude
Roy, et qu’il réussit à peindre sous des dehors originaux. Au
milieu du récit dramatique de la Grande Marche, par cette
survivante des quelque trente femmes qui y participèrent, il
réussit à recueillir une anecdote pleine d’humour en feuilletant
des vieilles photos. Li Po-tsao s’arrête sur la photo d’un
garçon maigre, fusil à l’épaule, tué par les Japonais en 1942,
et raconte :
« Pendant la Longue Marche, il avait fondé la "Société des
Gastronomes délicats". C’était au pire moment de l’expédition,
dans les montagnes enneigées, nous n’avions rien à manger. On
mâchait une demi-heure une pincée de grains crus. Les
Gastronomes délicats comparaient pendant des heures la saveur du
grain mouillé avec celle du grain sec, le goût des racines de
keng et celui des racines de tchoun. Ils organisaient
aussi des concours du plus beau menu, évoquant pendant la marche
les festins qu’ils avaient faits autrefois… »
(Clefs, p.169)
L’élan initial se calme cependant peu à peu, comme tout élan
révolutionnaire. Et quand on en arrive à la troisième partie,
les « Vues secondes » concernant la culture, l’écriture n’est
plus aussi enlevée.
Pauvre culture
Claude Roy fait état dès la première partie de son livre de ses
rencontres avec les grands écrivains du moment :
Lao She (老舍),
Mao Dun (茅盾)
et même
Ding
Ling (丁玲),
tout étonné de la voir alors qu’on l’avait dite morte. Mao Dun
lui raconte les difficultés des écrivains de gauche sous le
Guomingdang (p. 70), Lao She lui dit travailler à une pièce de
mœurs pékinoises, « L’Égoût du dragon barbu », qui « a pour
sujet l’installation du tout à l’égoût dans une vieille rue de
Pékin »
.
On les sent un peu bridés, un peu trop désireux de chanter les
louanges du régime.
On sent déjà la culture en voie d’appauvrissement. Nous avons de
longues pages sur la pensée, la religion, la philosophie, mais,
dans le domaine littéraire, Claude Roy n’a guère que quelques
poètes classiques, et pour la période contemporaine, deux
écrivains à citer :
Guo Moruo (郭沫若),
avec un enthousiasme bordant la ferveur (le livre lui est en
partie dédié), et
Zhao Shuli (赵树理),
qu’il qualifie avec admiration de « ménestrel de 500 millions
d’hommes » et auquel il consacre un chapitre entier.
Zhao Shuli sera persécuté au début de la Révolution culturelle
et en mourra en septembre 1970. Lao She avait déjà disparu
quatre ans auparavant, et tant d’autres avec eux. Mais cela,
Claude Roy ne le pressentait pas encore. Il conclut ses
Clefs : « Je reviens de Chine, Ce n’est pas le bout du
monde, du vaste monde… Je ne me sens désormais chez moi que
là… »
Regrets a posteriori
Il va bientôt revenir de cet engouement-là, mais sans le
renier :
« Quand je relis Clefs pour la Chine, il me semble que c’est un
livre dépassé parce que le temps a passé. Mais ce que j’avais
cherché n’était pas alors, là-bas, un leurre : l’élan
révolutionnaire d’un peuple vers le bonheur. Et ce que j’ai
essayé d’exprimer n’était pas une illusion….
(Nous, p. 487-488)
Dès
1966, dès le début de la Révolution culturelle, il dénonce un
« déferlement de sottise anti-culturelle » Il cite les travaux
du grand sinologue Etienne Balazs sur
La
Bureaucratie céleste
et poursuit les « bobards savants sur la prétendue "spécificité"
chinoise ». « L’insondable Asie n’est insondable que pour notre
inculture », lance-t-il contre Julia Kristeva qui justifiait
notre incompréhension par le caractère énigmatique de la Chine.
En 1971, dans Les Habits neufs du président Mao, publié
par Champs libre,
Simon Leys rend
hommage à sa lucidité et à sa modération, affirmant que ses
analyses étaient les plus dignes de foi à une époque
où « quiconque passait quinze jours en Chine devenait sinologue
aussitôt ».
En 1977, Claude Roy
dénonce le mythe maoïste dans les colonnes de la revue Esprit en
s’élevant contre les « maolâtres » parisiens. En 1979, il publie
chez Gallimard un recueil de douze
articles parus dans la presse entre 1953 et 1979 : Sur la
Chine. Il n’y cache ni sa tristesse pour le pays et son
peuple, ni ses illusions passées quant à l'aptitude du maoïsme à
corriger ses erreurs. Il s’en prend aussi avec sa verve
coutumière aux rapports de l'intelligentsia parisienne avec
l'idéologie maoïste.
|
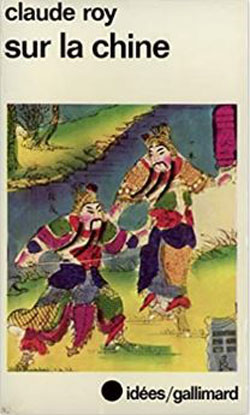
Sur la Chine, Gallimard/Idées 1979 |
|
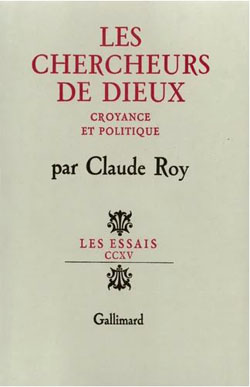
Les Chercheurs de dieux, 1981 |
En 1981, il tire un ouvrage, publié chez Gallimard, de ses
réflexions sur l'aveuglement qu'entraînent les idéologies :
Les Chercheurs de dieux : croyance et politique, où
il analyse la propension des hommes à vouer une véritable foi à
quelqu'un ou à quelque chose, en appliquant particulièrement
cette réflexion à l’ersatz de religion qu'est pour lui le
communisme.
J’ai laissé volontairement pour la fin le plus beau témoignage
de toutes les Clefs pour la Chine, le plus exceptionnel
aussi : ce que Claude Roy raconte de ce qu’il a vu de la Réforme
agraire en cours. C’est assez rare pour justifier d’être
développé séparément.
À lire en complément
La Faim de la terre, chapitre VI sur la Réforme agraire,
Clefs pour la Chine, pp. 56-67.
Également de Claude Roy :
|
- La Chine dans un miroir,
éditions Clairefontaine, Lausanne 1953.
Superbe ouvrage complémentaire des Clefs pour la
Chine, qui se présente comme un montage de
photos et de reproductions de papiers découpés
illustrant des poèmes et des contes populaires.
|
|
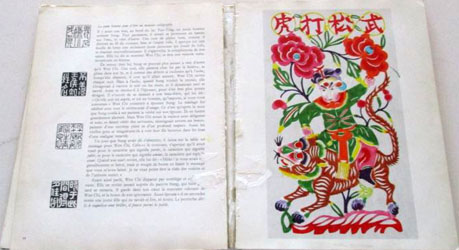
La Chine dans un miroir, 1953 |
- Le Voleur de poèmes,
250 poèmes dérobés au chinois,
Mercure de France, coll. Poésie, 1990.
|
|

