|
|
Yu Hua
余华
Présentation
par Brigitte
Duzan, 6 septembre 2009, actualisé 4 juin 2023
|
Yu Hua
est né en 1960 à Hangzhou (Zhejiang). Il avait six ans
au début de la Révolution culturelle : cette expérience
l’a marqué, et il en a fait le sujet de la plupart de
ses nouvelles et romans.
Enfance
marquée par la Révolution culturelle
Il a
grandi à Haiyan (海盐),
au nord du Zhejiang. Son père, qui était médecin, avait
été envoyé là pour lutter contre la bilharziose qui y
sévissait de manière endémique. C’était une toute petite
ville qui tenait du village, un endroit perdu, pauvre et
arriéré. Il a raconté
que, pendant la Révolution culturelle, la vie y était
d’une triste monotonie, rompue seulement par les
exécutions de ‘criminels’ ; la ville s’animait alors
comme lors d’un festival. Enfant, ces scènes d’exécution
l’excitaient comme |
|

Yu Hua 余华 |
un spectacle de foire ; il garde le souvenir du condamné s’agenouillant
sur le sol, tête baissée, le soldat visant la nuque et tirant…
Le sang semble
avoir été l’élément récurrent de son environnement et la mort un
voisinage habituel. Il décrit son père médecin comme un
personnage revêtu d’une blouse constamment maculée de sang qui
opérait dans une petite pièce en face de la maison familiale. La
maison était aussi en face des toilettes publiques, qui
servaient de poubelle aux infirmières, et de la morgue, endroit
frais et calme où il allait faire la sieste dans la chaleur de
l’été ; les corps n’y étaient déposés que la nuit, et il
entendait alors les gens pleurer de son lit.
Les sources de
l’atmosphère noire de ses premières nouvelles viennent de cette
expérience précoce de la violence et de la mort, dont il était
tellement imprégné que cela ressortait automatiquement sous sa
plume et qu’il en rêvait la nuit.
Comme tous les
jeunes de sa génération, son éducation a été réduite à néant par
la Révolution culturelle. Il est entré à l’école à six ans, au
tout début, et en est sorti dix ans plus tard, quand elle s’est
terminée. En 1976, il n’avait pratiquement pas ouvert un livre :
il n’y en avait pas. Les rares qu’il a pu trouver étaient
tellement abîmés qu’il n’en restait que les pages du milieu ; il
les a lus sans connaître ni le début ni la fin, ni le titre ni
de qui ils étaient.
Il a alors reçu
une formation rapide de dentiste, genre « dentiste aux pieds
nus », et a travaillé ainsi cinq ans dans une petite ville entre
Shanghai et Hangzhou, en détestant cette profession. Mais, à
l’époque, on ne choisissait pas ce qu’on faisait, on était
affecté à un poste par le gouvernement. Yu Hua ne pouvait donc
pas faire autrement. Cependant, il était fasciné par les jeunes
cadres du Bureau de la Culture local, qu’il voyait de son
cabinet se promener dehors à toute heure de la journée, sans
avoir, semble-t-il, grand-chose à faire. Son idéal, désormais,
fut d’entrer dans leurs rangs. L’un d’entre eux lui expliqua
que, pour cela, il lui suffisait d’écrire une nouvelle.
Il le fit,
envoya son court récit à une revue de Pékin qui la publia
illico, et Yu Hua entra au Bureau de la Culture, dûment muni
d’une autorisation officielle de transfert portant une douzaine
de superbes sceaux rouges. C’était en 1983, il faisait ainsi ses
débuts d’écrivain. Un an plus tard, il demanda à être muté à
Jiaxing ( 嘉兴),
la préfecture dont dépendait Huayan : au moins là, il y avait
une gare.
Années 1980 :
écrivain d’avant-garde
Son poste au
Bureau de la Culture n’était pas une aubaine financière ; tout
le monde, à ce moment-là, gagnait à peu près la même chose. La
seule différence tenait dans le travail réalisé pour gagner son
salaire : sa nouvelle affectation lui donna la liberté dont il
rêvait. Il espaça peu à peu ses présences, pour finir par ne
plus pointer qu’une fois par mois, pour toucher son salaire.
Il n’avait
cependant aucune formation d’écrivain, encore moins que de
dentiste. Privé de livres pendant toutes les années de la
Révolution culturelle, il n’eut pour toute lecture que les
affiches en gros caractères de l’époque, les dàzìbào
大字报,
qu’il lisait avec délectation non
point pour les slogans, mais pour les histoires qu’il y
trouvait, parce que les gens y dénonçaient leurs voisins et
leurs proches avec faconde et créativité ; c’était comme une
chronique de la vie quotidienne où il a puisé pas mal de son
inspiration initiale.
A partir des
années 1980, nombres d’ouvrages furent à nouveau publiés, en
particulier des traductions d’auteurs étrangers, et il se mit à
lire avec avidité, fasciné par des auteurs comme Kafka ou
Borges, ou encore Kawabata. Les premiers lui ouvrirent les
portes du fantastique, le second lui apprit l’amour du détail.
Ces lectures ont marqué le style de ses premiers écrits
,
d’un avant-gardisme assez caractéristique de l’époque : une
sorte de radicalisme esthétique cultivant l’image de l’artiste
dans sa tour d’ivoire, ce que l’on a appelé « les
écrivains d’avant-garde » (先锋派作家).
Les nouvelles
que Yu Hua publia alors dans divers magazines n’eurent guère de
succès, jusqu’en 1986 : son court récit (quelque quatre mille
caractères) intitulé « Parti loin de chez moi à dix-huit ans » (《十八岁出门远行》)
lui valut soudain une certaine notoriété. Il participa alors de
l’effervescence intellectuelle et artistique qui marqua ces
années de relative libéralisation, donnant l’impression que
tout, brusquement, était possible, y compris la liberté la plus
totale.
En 1988, il
réussit à partir à Pékin suivre des cours de littérature à
l’institut Lu Xun, où il rencontra une jeune poétesse, Chen
Hong, qu’il épousa. Mais cette période s’acheva net avec les
événements de Tian’anmen (4 juin 1989), qui marquèrent, avec la
reprise en main du pouvoir par la tendance conservatrice, un
tournant dans la création littéraire, et artistique en général,
tout autant que dans la vie nationale dans son ensemble.
Années 1990 :
écrivain populaire
En 1991, il
publie son premier roman : « Cris dans la bruine » (《在细雨中呼喊》).
Mais son style évolue ensuite, et c’est, selon ses propres
dires, par une nécessité interne, parce qu’il découvrit que ses
personnages avaient une existence propre qu’il ne maîtrisait pas
totalement, et dont il lui fallait respecter les exigences. En
outre, au début des années 1990, de nouvelles œuvres étrangères
furent traduites en chinois, son espace de lecture s’élargit ;
il fut influencé en particulier par V. S. Naipaul et Toni
Morrison qu’il découvrit alors.
Il faut bien
dire que son changement de cap, cependant, eut aussi des causes
extra-littéraires : vulgairement économiques. A partir de 1992,
la politique de réforme et d’ouverture relancée par Deng
Xiaoping se traduisit par l’abandon accéléré des formes de
contrôle public de l’économie dans tous les domaines, y compris
le domaine culturel, et l’édition en particulier. Les
subventions dont vivaient les maisons d’édition furent
supprimées et il leur fallut comme tout le monde se soucier de
leur rentabilité pour survivre. Dans ces conditions, les œuvres
d’avant-garde furent remisées dans les cartons de l’histoire. Il
fallait désormais assurer les recettes, avec des œuvres
populaires, des livres qui faisaient du chiffre.
Les écrivains
durent s’adapter, et c’est cette nécessité d’adaptation qui leur
fit rechercher d’autres sources d’inspiration, plutôt que le
contraire. Yu Hua suivit le mouvement général. En même temps,
cependant, il remit en cause son approche esthétique de la
littérature. Le genre avant-gardiste qu’il avait adopté jusque
là, comme beaucoup d’autres dans les années 1980, venait d’un
refus d’accepter l’orthodoxie maoïste qui voulait faire de la
littérature un outil politique au service du régime. Au début
des années 1990, il adopta une vision moins coupée de la réalité
sociale, une attitude plus engagée, réfléchissant les grands
problèmes nés de la modernisation accélérée du pays. Il en
revenait ainsi au rôle traditionnel en Chine de l’écrivain
reflet et critique de la société.
|
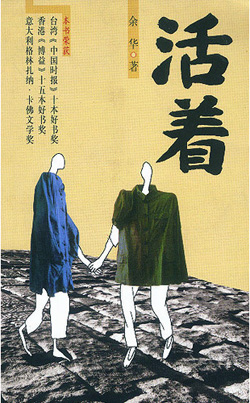
Vivre ! 《活着》 |
|
De ces
années datent ses deux premiers grands succès :
« Vivre ! » (Huózhe《活着》),
publié en 1993, et, en 1995, « Chronique d’un vendeur de
sang » (Xǔ Sānguān màixuè jì《许三观卖血记》),
publié en France sous le titre « Le vendeur de sang ».
Le
premier roman dépeint les événements qui ont marqué la
Chine des années 1940 au début de la période de réforme
et d’ouverture, à la fin des années 70. Le personnage
principal, Xu Fugui (徐福贵),
était au départ le seul héritier d’une riche famille de
propriétaires, vivant dans le luxe et gaspillant sa
fortune au jeu. Il finit par la dilapider totalement, et
être obligé de travailler la terre pour survivre, ce qui
le sauve au moment de l’arrivée au pouvoir des
communistes. Le livre le suit dans les divers malheurs
qui le frappent, au cours de la période du Grand Bond en
avant pendant laquelle meurt son fils, puis pendant la
Révolution culturelle, au cours de laquelle il perd sa
fille. Sur ses vieux jours, il se retrouve seul avec son
vieux buffle, mais |
toujours avec
la même inaltérable volonté de vivre et de s’en sortir, coûte
que coûte, qui est, pour Yu Hua, la caractéristique fondamentale
du peuple chinois, et ce qui fait sa force.
|
Le
livre est devenu un best-seller en Chine comme à
l’étranger. Mais s’il a connu un tel succès, c’est grâce
à l’adaptation au cinéma qu’en a faite Zhang Yimou, en
1994. Le film éponyme, avec deux stars du cinéma chinois
dans les rôles titres, Ge You (葛优)
dans le rôle de Fugui et Gong Li (巩俐)
dans celui de sa femme, fut présenté cette année-là au
festival de Cannes où il obtint le Grand Prix du Jury,
et Ge You celui de meilleur acteur. C’était une
consécration. Cependant, si « Vivre ! » est devenu un
best-seller mondial, c’est en grande partie parce que le
film a été interdit par les autorités chinoises, pour
dénigrer la politique du gouvernement chinois ; Zhang
Yimou a même été condamné à deux ans d’interdiction de
tournage. Le livre, comme le film, a ainsi fait la une
des journaux
,
et les ventes se sont envolées. Yu Hua est devenu une
célébrité mondiale. |
|

Le film de Zhang Yimou |
|
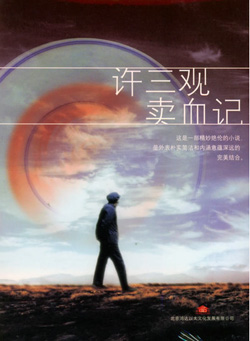
Le vendeur de sang
《许三观卖血记》 |
|
Quand
« Le vendeur de sang » est sorti en 1995, ce fut un
nouveau succès. Le récit reprend à peu près le même
contexte temporel que « Vivre ! » : ici ce sont les
trente années après 1949. Au début, dans les années
1950, Xu Sanguan (许三观)est
ouvrier dans une filature de coton, dans le Jiangsu,
lorsque, un jour, revenant d’une visite à un oncle à la
campagne, il croise deux amis qui vont vendre leur sang
et le persuadent d’en faire autant. Cela va lui
permettre de se marier. Le pli est vite pris, et Xu
Sanguan ira vendre son sang chaque fois qu’il aura
besoin d’argent. Le livre est sorti bien avant le
scandale de l’épidémie de Sida du Henan et le livre de
Yan
Lianke (阎连科)sur
le sujet
.
Cela fait longtemps que les paysans chinois vendent leur
sang pour arrondir leurs fins de mois. En ce sens, le
livre de Yu Hua est plus intemporel que celui de Yan
Lianke.
|
On retrouve
dans ce livre le thème principal du précédent, qui est un thème
récurrent chez Yu Hua : malgré le fatalisme du peuple chinois,
qui lui fait accepter les coups du sort comme les décrets du
gouvernement, son incroyable volonté de survivre face aux pires
catastrophes. Mais Yu Hua a développé là l’humour qui était
présent dans ses écrits depuis le départ, mais de manière
diffuse et subtile ; dans « Vivre ! », il apparaissait surtout
dans certains dialogues. Cet humour, de plus en plus décapant et
hilarant, souvent couplé à l’absurde, va désormais devenir sa
marque de fabrique ; cela correspond à son caractère, et au
caractère chinois en général, d’où, certainement, une partie de
son succès.
Années 2000 :
« Brothers »
|
En 2003
sort « Brothers » (《兄弟》)
qui fait l’effet d’une bombe. Avec ce livre, Yu Hua a
légèrement déplacé son curseur historique et opté pour
un style franchement burlesque pour dépeindre
l’absurdité d’un monde qui rappelle Tati autant que
Beckett. « Brothers », avec ses deux parties couvrant la
Révolution culturelle puis le fantastique boom
économique des années 1980-90, c’est un peu sa vie à
lui, son expérience personnelle. L’humour au vitriol
qu’il adopte est sans doute une manière d’évacuer la
tension dramatique de certains souvenirs tout en en
soulignant le non-sens des deux époques, chacune à sa
manière.
En
retraçant l’histoire de deux demi-frères, Li Guangtou (李光头)
et Song Gang (宋钢),
qui grandissent, comme Yu Hua, pendant la Révolution
culturelle, puis se retrouvent adultes pendant la
période de croissance économique après 1980,
« Brothers » illustre les bouleversements subis pendant
toute cette période par le pays et son peuple. La
première partie, née, on le sent, de l’expérience vécue,
est brillantissime et enthousiasme dès l’abord. La
seconde partie est plus travaillée, née d’un voyage de
plusieurs mois avec sa femme et son fils aux
Etats-Unis ; mais Yu Hua atteint là des sommets : une
écriture frénétique et truculente qui frise la démesure,
pour s’achever dans une fresque ubuesque d’un concours
de beauté où tout est truqué, fabriqué et frelaté, comme
la société de consommation actuelle.
Le
pire, en effet, c’est qu’on a l’impression qu’il
n’invente rien, d’ailleurs on le lui a souvent dit : des
Li Guangtou, il y en a partout, des types qui font
fortune en profitant de l’absence de règles et de
normes, dans la course générale au profit initiée par
Deng Xiaoping. Le génie tient dans la manière de le
dire. Le roman est le meilleur moyen, dit-on, de décrire
et décrypter une époque, « Brothers » en est l’une des
meilleures illustrations. |
|
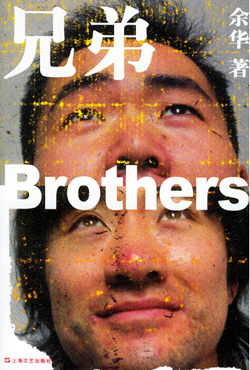
Brothers《兄弟》
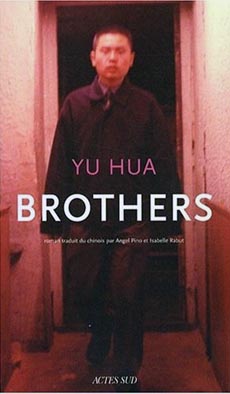
la traduction française |
Depuis lors, Yu
Hua passe le plus clair de son temps en voyages et conférences,
invité par ses différents éditeurs qui se le disputent. On
espère que cela lui laissera un peu de temps pour terminer
bientôt l’un des trois romans qu’il dit avoir commencé à écrire.
Années
2010 : Le septième jour
En 2010, Yu Hua
a publié un nouveau livre intitulé « La Chine en dix mots »
qui apparaît comme la synthèse des œuvres antérieures, faisant
le lien entre la Chine de Mao et la Chine d’aujourd’hui. Mais le
livre n’a pas été publié en Chine.
|
A
l’automne 2013, Yu Hua a collaboré au New York Times
avec une série d’essais sur les problèmes de la Chine
contemporaine qui en sont comme le complément.
En juin
de la même année, après sept ans de gestation, il a
publié un nouveau roman :
« Le septième jour » (《第七天》)
qui a été l’objet de vives controverses en Chine, et
traduit aussitôt en français. La traduction en anglais
est parue en janvier 2015.
Yu Hua
y décrit le parcours d’un homme mort sans sépulture, la
famille étant trop pauvre pour avoir pu lui acheter un
cercueil. Dans les sept jours suivant sa mort, son âme
erre dans les limbes, qui sont aussi les limbes du
souvenir. Il y rencontre les âmes de diverses personnes
mortes dans des circonstances violentes, inspirées de
faits divers de l’actualité, et retrouve les êtres chers
de son existence passée. |
|
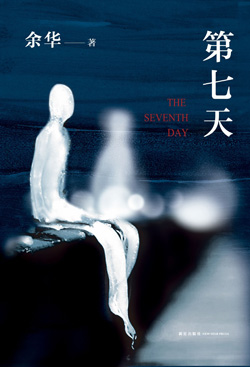
Le septième jour |
Yu Hua continue
d’être hanté par la violence de la société chinoise, une
violence quotidienne et endémique, et par l’absurdité qui en est
toujours la marque essentielle.
2021 :
Nouveau roman
|
En mars
2021, huit ans après « Le septième jour », paraît un
nouveau roman de Yu Hua :
« Wencheng » (《文城》)
[qui pourrait se traduire par « La ville des lettres »].
Le
roman conte l’histoire de Lin Xiangfu (林祥福),
pendant les dernières années de la dynastie des Qing et
le début de la période républicaine, époque chaotique de
banditisme et d’exactions des seigneurs de la guerre.
Originaire du nord, Lin Xiangfu est parti avec sa fille
dans le sud à la recherche de sa femme, Ji Xiaomei (纪小美),
qui a disparu après la naissance de leur petite fille.
Il s’installe dans le bourg de Xizhen (溪镇)
où il mène une vie humble et tranquille de menuisier.
Mais son passé est lié à la mystérieuse cité de Wencheng
que personne ne connaît, et qui pourrait aussi bien ne
pas exister…
Le
roman a une longue histoire : Yu Hua l’a commencé en
|
|
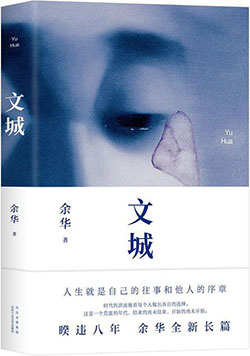
Wencheng |
1998, comme
préquelle de « Vivre ! », mais il en a abandonné l’écriture au
bout de quelque 200 000 caractères, a-t-il expliqué, car il ne
s’en sortait pas. Il a écrit « Brothers », puis « Le septième
jour », et ce n’est qu’en 2020, pendant le confinement, qu’il a
repris « Wencheng ». Au total, il a donc passé 21 années à
concevoir et écrire ce qu’il voulait être « un chuanqi
non traditionnel » (), dont il a fait une sorte de narration
légendaire. On y retrouve le mélange de réalisme, d’onirisme et
d’ellipses narratives cultivant le mystère qui caractérisent ses
plus belles nouvelles, et en particulier ses zhongpian
(voir ci-dessous).
En janvier
2022, le roman a été déclaré l’un des cinq meilleurs romans de
l’année 2021 en Chine. En octobre, il a été couronné du prix
littéraire Shi Nai’an (施耐庵文学奖)
lors de la cinquième édition de ce prix, remis le 24 mars 2023.
Traductions
en français
Romans
长篇小说
-
Vivre !
《活着》,
trad. Yang Ping, Le livre de poche, 1994, 223 p. /
Babel, 2008.
-
Le Vendeur de sang
《许三观卖血记》,
trad. Nadine Perront, Actes Sud, coll. « Lettres chinoises »,
1997, 285 p. /
Babel, 2006.
- Cris dans la
bruine
《在细雨中呼喊》,
trad. Jacqueline Guyvallet, Actes Sud, coll. « Lettres
chinoises », 2003, 325 p.
- Brothers 《兄弟》,
trad. Angel Pino et Isabelle Rabut, Actes Sud, coll. « Lettres
chinoises », 2008, 720p.
-
Le Septième
Jour
《第七天》,
trad. Angel Pino et Isabelle Rabut, Actes Sud, coll. « Lettres
chinoises », 2014, 272 p, Babel, 2014.
Novellas
(Zhongpian)
中篇小说
Les principales
ont été traduites en français, sous les dénominations les plus
diverses (petits romans, court roman, récits…). Elles datent de
la période 1987-1991 ; ce sont désormais des classiques et ont
fait l’objet de rééditions récentes en Chine. Ainsi un recueil
de quatre zhongpian comportant « Erreur dans la
rivière », « Un amour classique », « 1986 » et « Un incident
fortuit » a été publié en 2018 aux éditions Times Literature and
Arts (时代文艺出版社)
sous le titre de la première.
-
Un amour classique, trad.
Jacqueline Guyvallet, Actes Sud, coll. « Lettres chinoises »,
2000, 259 p. /
Babel, 2009. Recueil de quatre textes :
o
Quelques
pages pour Yang Liu《此文献给少女杨柳》
o
Un
événement fortuit《偶然事件》
- Un monde
évanoui, trad. Nadine Perront, Philippe Picquier, 2003, 150 p.
Recueil de deux
zhongpian de 1988 :
o
Erreur
au bord de l’eau
《河边的错误》
o Un monde
évanoui
《世事如烟》
- 1986,
trad. Jacqueline Guyvallet, Actes Sud, coll. « Lettres
chinoises », 2006, 88 p.
- Mort d’un
propriétaire foncier et autres courts romans,
trad. Angel Pino et Isabelle Rabut, Actes Sud,
coll. « Lettres chinoises »,
2018, 368 p.
Recueil de quatre zhongpian de la même période 1987-1991
:
o
Mort d’un
propriétaire foncier
《一个地主的死》
o
Typhon estival
《夏季台风》
o L’Affaire du 3
avril
《四月三日事件》
o
Frisson
《战栗》
Nouvelles
courtes 短篇小说
- Sur la route
à dix-huit ans et autres nouvelles, trad. Jacqueline Guyvallet,
Angel Pino et Isabelle Rabut, Actes Sud, coll. « Lettres
chinoises », 2009, 185 p.
Essais
随笔集
- La Chine en dix mots
《十个词汇里的中国》,
trad. Angel Pino et Isabelle Rabut, Actes Sud, coll. « Lettres
chinoises », 2010, 370 p.
Adaptations au cinéma
- Analyse
comparée du roman « Vivre ! » (《活着》) et
du film éponyme qui en a été adapté par Zhang Yimou :
http://www.chinesemovies.com.fr/films_Zhang_Yimou_Vivre.htm
- En 2023, le
film de
Wei Shujun (魏书均)
« Only the River Flows » (《只有河水在流》)
sélectionné dans la section Un certain regard au
festival de Cannes est adapté de la novella « Mistakes by
the River » (《河边的错误》),
ou « Erreur au bord de l’eau ».
A lire en
complément
- Deux
nouvelles :
La première, « Parti
à dix-huit ans loin de chez moi » (《十八岁出门远行》),
publiée en 1989, mais écrite deux ou trois ans auparavant, est
celle qui a fait connaître Yu Hua. Bien que ce soit une œuvre de
jeunesse, elle est cependant digne des œuvres de la maturité.
Elle fait partie de la veine humoristique de Yu Hua, avec un
petit côté absurde ; c’est le style que l’on retrouve, accentué
jusqu’au burlesque, dans « Brothers », comme si Yu Hua revenait
au point de départ, et à ce qui constitue en fait le reflet de
son caractère.
En même temps,
c’est une sorte de conte initiatique réaliste et empreint d’une
certaine mélancolie sous l’ironie.
La seconde
nouvelle, « L’enfant du crépuscule »
(《黄昏里的男孩》),
est un chef d’œuvre de cruauté brute et d’écriture réaliste. On
y retrouve sans doute les souvenirs d’enfance, ceux de la
Révolution culturelle, lorsque Yu Hua habitait dans la petite
ville de Haiyan, et que les gens affluaient pour leur unique
distraction : assister aux exécutions. C’est un peu la même
ambiance. Mais la nouvelle tente de trouver comme des
circonstances atténuantes à cette inhumanité.
On remarquera
qu’il n’est pas question ici de politique, ou de période
historique, juste des conséquences de la pauvreté et de la
misère, morale autant que physique.
- Les « nouvelles
moyennes » de la fin des années 1980.
- dans
l’actualité (2011) :
Après “La Chine en dix mots”, publication (numérique) de son
microblog par Yu Hua
Yu Hua est son nom de plume, associant le nom de jeune
fille de sa mère (余)au
nom de son père (华).
|
|

