|
|
La littérature
taïwanaise : état des recherches et réception à l’étranger
Sous la direction de
Chan Ning-ho, Joyce Liu Chi-hui, Peng Hsiao-yen, Angel Pino &
Isabelle Rabut
Textes édités par Angel
Pino & Isabelle Rabut
Editions You Feng,
novembre 2011.
|
Cet ouvrage
résulte de la publication des actes du colloque éponyme
(1) qui, organisé conjointement par
le Centre
d’études et de recherches sur l’Extrême-Orient (CEREO)
de l’université Michel de Montaigne de Bordeaux 3
et
l’Institute of Chinese Literature and Philosophy de
l’Academia Sinica de Taiwan
s’est tenu à Bordeaux du 2 au 4 novembre 2004. Les
communications sélectionnées ont été complétées par des
travaux bibliographiques inédits de manière à donner une
image aussi précise que possible (mais à la date de
2005) de la diffusion de la littérature taïwanaise en
Europe et aux Etats-Unis.
Son intérêt
tient en grande partie à la richesse des communications
qu’il contient, qui dressent un tableau, non pas
exhaustif, mais de certains aspects de cette littérature
(2), permettant de mieux la comprendre - une littérature
qui mériterait d’être mieux connue, mais qui reste
méconnue, en particulier en France, en raison,
essentiellement, du peu de traductions disponibles. |
|
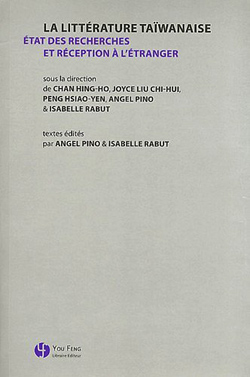
La littérature taïwanaise : état des
recherches et réception à l’étranger |
Après une introduction
d’Angel Pino et
Isabelle Rabut sur les
écueils qu’ont constitués et que constituent toujours la
politique et l’histoire pour cette littérature, l’ouvrage se
divise en deux « livres », chacun consacré à l’un des deux
termes du titre : état des recherches et réception en Europe et
aux Etats-Unis – la première étant limitée à trois pays
européens (France, Allemagne et Grande-Bretagne).
Le livre I se
divise en quatre parties, qui suivent l’ordre des communications
du colloque, mais dont on aurait pu inverser les chapitres pour
commencer par l’histoire, et la littérature dans ses rapports
avec elle.
1ère
partie : La question du modernisme
1. Les débuts de
l’introduction de la poétique moderne, par Chen Fang-ming (陳芳明)
2. Les flux culturels
transnationaux et la « taïwanité » de la littérature moderniste
de Taiwan, par Chiu Kuei-fen (邱貴芬)
3. Le modernisme
contestataire de Xiandai wenxue, par Zhang Yingde (張寅德)
Cette partie est axée
sur l’analyse de
la
réception/réinvention du modernisme littéraire à Taiwan pendant
la période 1950-1990. Elle traite en particulier de la lecture
des œuvres et des théories du modernisme occidental par les
écrivains et intellectuels taïwanais pendant cette période, en
contestant l'idée d'une simple imitation taïwanaise sous
influence occidentale et en soulignant au contraire la richesse
créative, non dépourvue d'ambiguïté, d’œuvres qui sont en fait
des reconstructions personnelles et intertextuelles.
2ème
partie : Histoire de la littérature
1. Vers la
taïwanologie : bilan et perspectives des recherches sur la
littérature taïwanaise, par Lin Juei-ming (林瑞眀)
2. Les débuts de la
création romanesque chez Yang Kui : discussion centrée sur
Révolte et mort d’un paysan pauvre, par Chen Wan-yi (陳萬益)
3. La narration de
l’histoire de la littérature taïwanaise de part et d’autre du
détroit, par Li Xiangping (黎湘萍)
- Les chapitres 1 et 3
de cette seconde partie présentent deux points de vue différents
sur l’écriture de la littérature taïwanaise. Le premier dresse
un tableau des difficiles débuts de chercheurs dont les travaux
se sont heurtés à l’incompréhension, aux ruptures de l’histoire
et aux aléas de la politique ; l’auteur tente de dégager les
particularités des recherches sur l’histoire littéraire
taïwanaise et conclut en soulignant les différents obstacles à
dépasser pour pouvoir progresser (dont les barrières
linguistiques).
- Le troisième chapitre
est une analyse de l’évolution de la narration de l’histoire
littéraire à Taiwan, par un professeur et chercheur de
l’Académie des sciences sociales de Chine (中国社会科学院).
Commençant par replacer l’histoire de Taiwan dans le contexte
général de l’historiographie chinoise, en partant du « Livre de
Wu » de la Chronique des Trois Royaumes (三国志.吴国),
Li Xiangping souligne
ensuite le traumatisme que fut la cession de l’île au Japon,
en 1895,
faisant de la narration de l’histoire taïwanaise un acte de
résistance, culturel autant que politique.
Cet article
est une superbe
introduction à l’histoire littéraire taïwanaise, qui aurait pu
être une introduction au livre lui-même. Il suit l’évolution des
études et publications, en en soulignant les idées de base, et
en terminant par un développement sur les deux « lacunes » de la
narration historique qu’il a passée en revue, et surtout, celle
qui lui semble la plus importante, l’oblitération, dans cette
narration, à partir des années 1950-60, de l’étendard du
« romantisme », trop évocateur du mouvement de révolte et
d’exaltation de l’individu lié au
mouvement du 4 mai et de
la Nouvelle Culture.
L’auteur conclut que
l’ « anti-romantisme » s’est alors affirmé comme distanciation
du politique, mais que toute l’histoire littéraire de l’île
montre au contraire que ce n’est que dans la tension politique
que la littérature taïwanaise peut donner le meilleur
d’elle-même.
- Quant au second
chapitre, l’auteur y revient sur les débuts de la création
romanesque de Yang Kui (楊逵,
1906-1985), pour redresser l’image d’un « romancier prolétarien
écrivant en japonais » :
l’auteur
souligne sa participation aux mouvements sociaux à son retour du
Japon en 1927, ses difficiles conditions de vie après son
mariage, ses nombreux travaux de traduction (dont « La véridique
histoire d’AQ » de
Lu Xun),
avant d’en arriver à l’argument
principal : les efforts d’écriture de Yang Kui en langue parlée
taïwanaise, dont il fut l’un des plus ardents défenseurs et dont
« Révolte d’un paysan pauvre » représente la première tentative
réussie.
3ème
partie : Littérature et histoire
1. L’histoire, la
fiction et les écrivains des villages de garnison depuis la
levée de la loi martiale, par Peng Hsiao-yen (彭小妍)
2. Progrès, décadence
et corps social : le visible et le non visible dans la
conscience décadente du Taiwan des années 1930 – du mouvement de
la Nouvelle Littérature à Yang Shichang en passant par Nanyin,
par Joyce Liu Chi-hui (劉紀寭)
3. La politique du
corps et l’image de la jeunesse : la littérature de fiction
taïwanaise à l’époque de l’occupation japonaise, par Mei
Chia-ling (梅家玲)
|
- Le premier
chapitre est une analyse des liens entre écriture et
mémoire, mémoire historique et mémoire culturelle à
travers la littérature, tels qu’ils se sont développés
après la levée de la loi martiale, en 1987. Avec le
déclin du pouvoir du Guomingdang et la fin de l’illusion
du retour aux sources identitaires, c’est tout un
imaginaire qui s’effondre pour les waisheng,
symbolisé par les villages de garnison (juancun
眷村),
constructions précaires qui n’avaient été construits que
pour une période provisoire, en attendant le retour à la
Chine mère.
Ces villages se
délabrent peu à peu, tandis que l’écriture de l’histoire
en tant que narration fictionnelle devient
« reconstruction imaginaire du passé ». L’analyse
s’appuie sur celle de l’œuvre deux auteurs
emblématiques à cet égard : Zhang Dachun (Chang Ta-chun
張大春)
et Zhu Tianxin (Chu Tian-hsin
朱天心) |
|

Zhang Dachun |
|
- La
« conscience décadente » et ses liens avec le discours
sur la modernité dans les années 1930 à Taiwan est le
sujet traité dans le second chapitre, pour – ici aussi –
le débarrasser de ses clichés et idées reçues. Joyce Liu
Chi-hui montre que la « conscience décadente », ou
« esthétique de l’ombre » telle qu’elle apparaît dans
les poèmes de Yang Chi-chang (楊熾昌),
a ses parallèles au Japon, mais aussi, étonnamment, dans
le néo-sensationnisme qui s’est développé à peu près au
même moment à Shanghai (3), dans un rapport ambigu entre
attachement mélancolique au passé et désir anxieux de
redressement spirituel passant par un renouveau
littéraire.
- Quant au
troisième chapitre, il présente une étude de la
représentation du corps dans la littérature de fiction
taïwanaise sous l’occupation japonaise, le corps étant
évidemment celui des jeunes, celui du printemps et de
l’espoir. Dans un pays où le pouvoir colonial avait
transformé |
|

Yang Chichang |
l’espace en le
modernisant, il fut identifié à la modernisation, créant une
ambiguïté sur les termes, une contradiction entre esprit et
corps, entre corps et désir, et entretenant chez le sujet
colonisé une confusion de valeurs identitaires et culturelles
qui se traduit dans les romans de l’époque.
4ème
partie : De quelques œuvres littéraires taïwanaises
1. La politique des
parenthèses : lecture de En ce jardin d’un rêve brisé de
Bai Xianyong à la lumière de Mrs Dalloway de Virginia
Woolf, par Li Sher-shiueh (李奭學)
2. Un canon oublié ? Wu
Mansha, le Périodique Vent et Lune et la littérature
populaire à Taiwan sous l’occupation japonaise, par Lin Pei-yin
(林姵吟)
3. Les romanciers
taïwanais de la jeune génération, par Esther Lin (林寭娥)
4. Réminiscences et
instants de mémoire dans le roman de Wang Wenxing Jiabian,
par Sandrine Marchand
5. Lecture minutieuse
d’Une « Balance » de Lai He, par Lin Ming-teh (林眀德)
|
Cette partie
regroupe les analyses de quatre œuvres littéraires
prises comme représentatives d’un aspect particulier de
la période considérée :
- le premier
chapitre étudie les analogies d’écriture entre « Mrs
Dalloway » de Virginia Woolf (1925), et « En ce jardin
d’un rêve brisé » (《游园惊梦》),
nouvelle de 1968 de
Bai Xianyong (Pai Hsien-yung
白先勇) :
réminiscences évoquées par flux de conscience et
digressions par le biais de parenthèses ;
- le second
chapitre traite du courant de littérature populaire
publié dans le périodique « Vent et Lune » (風與月),
sous l’occupation japonaise, et du cas de Wu Mansha (吳漫沙)
dont l’œuvre, au-delà de son soutien à la politique
coloniale du Japon, représente un reflet de la vie
sociale de Taipei sous l’occupation japonaise, et en ce
sens un complément de l’histoire officielle à ne pas
négliger ;
- le quatrième
chapitre apporte un commentaire intéressant |
|
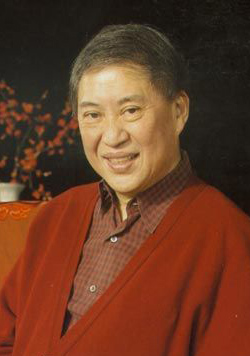
Bai Xianyong |
|
sur un « récit
de mémoire » qui commence par la disparition d’un père :
« Catastrophe familiale » ou Jiabian (家變)
de
Wang Wenxing (Wang Wen-hsing 王文興)
;
- et le
dernier chapitre est une analyse détaillée d’une
nouvelle de 1926 du poète
Lai He (賴和),
considéré comme le père de la Nouvelle Littérature
taïwanaise.
Une « Balance »
est
une illustration de la théorie des influences, courant
dominant de la littérature comparée ; elle a été inspiré
par « L’affaire Crainquetabille » d’Anatole France :
l’histoire a rappelé à Lai He l’arbitraire policier
qu’avait à subir la population taïwanaise.
Ce parcours en
ligne brisée est complété par un aperçu – par Esther Lin
- des romanciers de la « jeune génération »,
c’est-à-dire celle née entre 1960 et 1972.
Le livre II,
pour terminer, dresse un état des traductions en
|
|

Wang Wenxing |
français, en allemand
et en anglais, ainsi que des recherches réalisées sur la
littérature taïwanaise dans ces trois langues, et fait ressortir
les différences et les liens entre les stratégies de traduction
et d'édition de la littérature taïwanaise dans les pays retenus
et la visibilité de Taiwan qu’il en résulte.
Outre les riches
références bibliographiques, cet ouvrage apporte un précieux
éclairage sur la littérature taïwanaise moderne.
Notes
(1) Voir le programme
des communications :
www.cefc.com.hk/francais/enewsletter/LettreAoutSept/Programme11_bleu%20copie.pdf
(2) L’ouvrage concerne
uniquement la littérature moderne, de 1920 à nos jours, et la
littérature des auteurs d’origine chinoise, donc à l’exclusion
de celle des écrivains aborigènes.
(3) Voir Repères
historiques :
le haipai.
|
|

