|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 20
décembre 2023
et annonce de la séance suivante
par Brigitte Duzan, 24 décembre 2023
Cette dernière
séance de l’année était consacrée à
Feng Menglong (冯夢龙) et
à trois de ses recueils de contes traduits en français :
- La
tunique de perles, recueil de douze contes tirés du premier
des « Trois Propos » (Sān yán
三言), le
Yùshì míngyán
ou « Propos éclairants pour édifier le monde » (《喻世明言》).
Éditions des langues étrangères de Pékin, 1993, 295 p.
Et/ou :
- La vengeance de Cai Ruihong, recueil de treize contes
tirés du troisième des « Trois Propos », le Xǐngshì héngyán ou
« Propos éternels pour éveiller le monde » (《醒世恆言》)
Éditions des langues étrangères de Pékin, 1995, 388 p.
| |
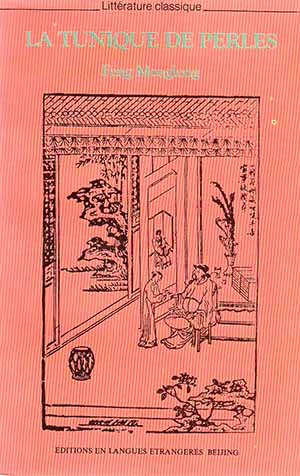
La tunique de perles,
édition des langues étrangères |
|
Et attribué à Feng Menglong, mais …
- Le Vendeur d’huile qui conquiert Reine de beauté, récit
tiré du troisième Propos, traduit sous la direction de Jacques
Reclus, préface de Pierre Kaser, éd.
Philippe Picquier, 1990, 91 p.
- Ou la traduction anglaise : The Oil Vendor and the
Courtesan, Tales from the Ming Dynasty, tr.
Ted Wang and Chen Chen, Welcome Rain Publishers, NY, 2007.
- On pourra aussi consulter par curiosité la première traduction
de ce texte en français, par Gustave Schlegel, en 1877 : Le
vendeur d’huile qui seul possède la Reine-de-beauté, ou
Splendeurs et misères des courtisanes chinoises. Original
conservé à la BnF et
numérisé par Gallica.
| |
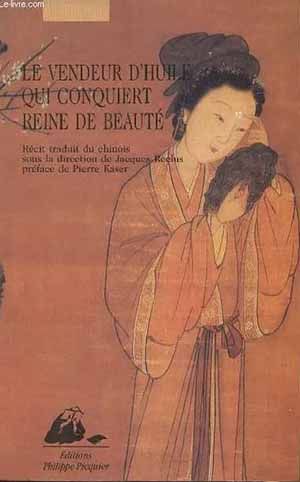
Le Vendeur d’huile qui
conquiert Reine de beauté |
|
| |
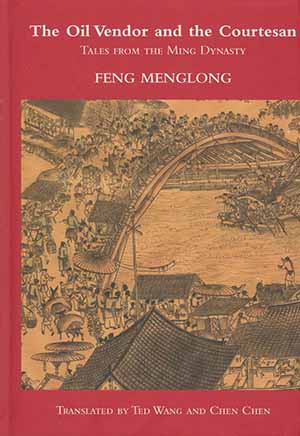
The Oil Vendor and the
Courtesan |
|
Le programme
comportait en outre trois textes supplémentaires disponibles en
ligne, original et traduction,
mais personne ne les a lus : le club est très attaché au papier,
et pour beaucoup des membres au plaisir de chercher un livre
difficile à trouver – ce qui était le cas des deux éditions des
langues étrangères de Pékin - et, l’ayant trouvé, d’en tourner
les pages.
Les rangs
étaient quelque peu éclaircis par l’appel du large – le voyage
s’avère le concurrent direct du club sinon de la lecture - mais
aussi par la proximité des examens pour certaines et l’approche
des fêtes pour d’autres. Ce qui a permis à chacun.e des
présent.e.s de s’exprimer librement, sans nul besoin d’avoir à
limiter son temps de parole.
Feng Menglong
en est sorti gagnant : tout le monde a bien aimé ses histoires,
et pour des raisons très diverses. En ce sens, il continue sur
sa lancée d’auteur populaire, dûment promu d’ailleurs en son
temps par ses éditeurs… popularité à relativiser, cependant,
comme le souligne Patrick Hanan dans son ouvrage de référence « The
Chinese Vernacular Story » : « Tous les recueils que Feng a
préparés étaient superbement édités, avec de belles
illustrations, d’abondantes notes et une ponctuation soignée. Il
a contribué à populariser la littérature vernaculaire auprès
d’un vaste public… mais pas des plus pauvres. »
Avec ses illustrations, la littérature vernaculaire à la fin des
Ming est devenue en fait objet de collection pour les lettrés
qui y goûtaient ainsi à la fois la perpétuation de l’art du
conteur et le plaisir esthétique trouvé dans la peinture. C’est
un autre aspect de ces histoires que l’on a tendance à oublier.
Communications in absentia
Quoi qu’il en
soit, c’est surtout de plaisir de lecture dont il a été
question durant cette séance, avec les diverses nuances
habituelles… et un souffle de brise marine envoyé par Martine
B. pour se faire pardonner et de n’être pas là et de n’avoir
rien lu. Mais la brise était bienvenue.
Geneviève
B.
avait renoncé à venir, « à demi noyée » sous l’avalanche des
tâches accumulées en fin d’année, mais elle avait lu quelques
contes, dans une « version éditée et traduite en anglais par le
poète contemporain Wang Guozhen »
.
Elle a trouvé l’anglais « insipide », mais bien apprécié dans
ces récits :
« - leur
« haute tenue » (confucéenne),
- l’importance
des chefs de clan qui, par leur travail dans la société,
parvenaient à élever leur clan à une position favorable et à
accumuler un prestige symbolique au sein de leur communauté,
- le rôle des
femmes,
leur perspicacité et leur endurance dans le malheur, leur
permettant d’arriver à construire une famille, comme dans le
conte du vendeur d’huile. »
Geneviève
dit adorer les contes en général, et en particulier ceux
d’Andersen traduits du danois par Régis Boyer
,
mais ceux de Feng Menglong l’ont surprise par leur concision, et
leur défaut de développements poétiques.
Avis
in praesentia
- Marion
J.
a beaucoup aimé l’humour et les rebondissements de ces récits
qu’elle a rapprochés de notre littérature du 17e
siècle. Ainsi les médecins peuvent donner des scènes aussi
cocasses que chez Molière, comme dans « Le rendez-vous secret de
Wu Yan »
.
[La maladie
est un thème récurrent dans les histoires de Feng Menglong,
comme dans la littérature vernaculaire ancienne, et elle donne
lieu à des rebondissements dans les intrigues, souvent comme une
sorte de châtiment prédestiné, au même titre que la pauvreté,
voire, feinte, comme un stratagème pour une femme désirant
séduire un moine ou voulant se protéger. Voir à ce sujet la
thèse sur « les histoires médicales dans la fiction vernaculaire
chinoise de la période impériale tardive » :
https://escholarship.org/content/qt2bm4160b/qt2bm4160b_noSplash_4c1dae4e8ce2ca70f23768585
228e0a1.pdf?t=qll0tk]
Marion
a particulièrement apprécié les détails de la vie courante,
montrant combien elle devait être dure : deuil pendant trois
ans, torture courante, époux séparés pendant des mois, le mari
partant travailler au diable vauvert, surtout quand il était
marchand, dettes encourues pendant des années, cruauté générale
(un jaloux allant jusqu’à défaire les bandages des pieds d’une
femme). Et justement vie dure surtout pour les femmes, cloîtrées
chez elles sans pouvoir mettre le nez dehors, et soumises à la
loi du mari et aux filouteries des entremetteuses autant qu’à la
lubricité généralisée jusque chez les moines. À ce propos, elle
s’est étonnée et amusée de la crudité de certains passages.
Rabelais est évoqué.
Et pour
terminer, elle remarque en riant : de la liste des différents
mariages, celui qui est voué à finir mal est celui conclu sur un
coup de foudre.
[Remarque qui
rejoint les derniers vers en exergue de « La tunique de perles »
(Jiang Xingge retrouve sa tunique de perles《蒋兴哥重会珍珠衫》),
le premier des récits des Yushi mingyan :
Gardez-vous de courir richesses et plaisirs /
vous vous épargnerez bien des ennuis.
Ce qui
pourrait être la morale générale de tous ces récits. ]
- Françoise
J.
a retenu de toutes ces histoires la riche galerie de personnages
(marchands et artisans, prostituées et courtisanes,
entremetteuses et servantes, moines et nonnes, voleurs et
brigands….), et savouré l’histoire de « La tunique de perles »,
en particulier, « comme on suce un bonbon ».
Elle a noté
l’entrée en matière avec précisions sur le lieu, l’époque, puis
ensuite la narration visant à l’édification morale, le mariage
étant donné comme solution idéale et finale au sort des filles –
ce qui n’empêche pas les femmes, sous des dehors soumis, d’avoir
du caractère et de s’arranger au besoin prestement de la morale.
Oui, remarque
Christiane P., la morale est très souple, dans le peuple,
même chez les bonzesses. Ainsi, dans « Le testament »
,
le magistrat réputé vertueux est quand même retors : il invoque
l’esprit du défunt pour se faire payer plus que ce qui lui avait
été promis au départ.
- MRC
a
lu les récits en chinois, comme à son habitude, mais plus
lentement car c’est une langue ancienne qui, bien que plus aisée
à comprendre que le wenyan classique, n’est pas
totalement fluide pour le lecteur chinois d’aujourd’hui. Cela
rend particulièrement sensible l’appauvrissement de la langue
chinoise aujourd’hui, dit-il.
Mais tout le
monde s’accorde pour trouver que c’est la même chose partout.
MRC
en gardait quelques souvenirs car certains de ces récits
figuraient dans les manuels scolaires quand il était écolier. Il
se souvenait en particulier de l’histoire de Du Shiniang : « Du
Shiniang de colère jette à l’eau son coffret aux cent trésors »
(《杜十娘怒沉百宝箱》)
.
La malheureuse ayant été vendue par sa famille à une maison
close, elle tente de sortir d’une vie de courtisane en épousant
un garçon de bonne famille, mais celui-ci en fait la vend pour
une poignée de taels à un riche marchand… Plutôt que d’accepter
ce sort, Du Shiniang préfère se suicider.
À l’école,
raconte MRC, on leur avait présenté Du Shiniang comme une
victime de la société « féodale » patriarcale, où les femmes
étaient réprimées par les lois familiales et sociales. Mais Du
Shiniang avait de hautes valeurs morales et a préféré la mort
plutôt que d’accepter l’injustice et l’ignominie de son sort.
C’était une rebelle, en lutte contre les normes féodales. Un
modèle, en quelque sorte.
MRC
a regardé sur CCTV [la télévision nationale chinoise] des séries
adaptées de cette histoire dans les années 1990.
[mais il y a
aussi un superbe film - remake d’un film plus ancien de 1940 -
produit aux studios de Changchun en 1981, réalisé par Zhou Yu (周予)
avec l’actrice Pan Hong (潘虹)
dans le rôle principal :
https://www.youtube.com/watch?v=UmAmpFOx3Us
]
En outre, il a
écouté une conférence sur internet sur les récits de Feng
Menglong : le thème général concernait les personnages des
marchands et courtisanes, personnages souvent très riches,
surtout les premiers, et disposant de capital. Et pourtant, le
capitalisme ne s’est pas développé en Chine. L’une des raisons
étant que, dans la société confucéenne traditionnelle, les
marchands étaient au bas de l’échelle sociale, comme les
prostituées justement. On a dans ces récits l’illustration des
blocages de la société qui n’ont pas permis l’émergence d’une
petite bourgeoisie capitaliste.
[Voir à ce
propos l’étude de Claire Lebas (Université de Rennes 2) : « Les
marchands dans la société chinoise, éléments historiques,
conceptuels et littéraires : étude d'une sélection de nouvelles
du Sanyan de Feng Menglong ».
À télécharger.]
Par ailleurs,
MRC propose deux caractères pour définir ces narrations :
qí (奇),
étrange, surprenant, et qiǎo (巧),
par hasard, par coïncidence. Les hasards et coïncidences sont en
effet nombreux dans les intrigues, justifiant l’expression
« sans coïncidence (ou hasard) pas d’histoires » (wu qiao bu
cheng shu无巧不成书
). En fait, le hasard n’en est pas toujours un car il y a
souvent une logique ou des raisons cachées qui rapprochent deux
personnages.
Oui, dit
Christiane P., on sent parfois l’effort pour rendre une
histoire crédible malgré tout.
Marion J.
voit là encore un parallèle chez Molière où les coups du sort
sont souvent inattendus.
[Ainsi dans
« L’Ecole des femmes », par exemple, l’idée qu’on ne peut guère
se prémunir contre le cocuage, jusqu’à en faire une défense
comique :
« Ce sont
coups du hasard dont on n’est point garant,
Et bien sot,
ce me semble, est le soin qu’on en prend » (I,1) ]
-
Christiane P. a été sensible à la peinture des mentalités et
de la vie quotidienne, et tout particulièrement celle des
femmes.
Elle a vu dans
le contexte social et la pensée en contrepoint un mélange de
taoïsme, de confucianisme et de bouddhisme. Par exemple, dans le
récit « Chen Xiyi par quatre fois refuse la nomination
impériale » (《陈希夷四辞朝命》),
Chen Tuan (Xiyi) cultive le don de l’hibernation et du sommeil
et finit par atteindre l’immortalité à 118 ans, de la même
manière qu’un bouddhiste atteignant l’éveil – son corps est
resté souple même après sa mort.
Christiane
a bien aimé l’histoire de l’incendie du temple Baolian, dernier
récit du recueil « La vengeance de Cai Ruihong »
.
Les moines sont souvent dépravés et lubriques, qu’ils soient
taoïstes ou bouddhistes, mais ceux du temple Baolian l’étaient
particulièrement : ils avaient organisé une immense entourloupe
pour faire croire aux gens du village en mal de descendance
qu’il suffisait de confier leurs femmes au temple pour qu’elles
tombent enceintes. Le juge Wang en a le cœur net en envoyant
deux prostituées pour servir d’appât. On a là une satire féroce
de la manière dont les moines abusaient de la crédulité et de la
superstition des villageois.
Christiane
trouve aussi que les femmes de bonnes familles sont plus souvent
pardonnées que les autres, et qu’elles prennent plus facilement
des libertés avec la morale. Elle a aussi été frappée dans
certains récits par le rôle de la rumeur dans les villages. On a
là de véritables comédies sociales, dit-elle, parfois très
drôles comme dans l’histoire du rendez-vous secret de Wu Yan
où la jeune He, pour nourrir le garçon qu’elle cache sous son
lit, doit demander de la nourriture supplémentaire et finit par
être soupçonnée d’être atteinte de boulimie, d’où appel à des
médecins dignes de Molière (comme le disait Marion). La
morale à la fin est sauve de justesse.
Celle qu’elle
a particulièrement appréciée, pour sa construction narrative,
est « La vengeance de Cai Ruihong » (《蔡瑞虹忍辱报仇》)
qui montre bien le poids de la tradition confucéenne. Dans ce
récit, la vengeance relève du devoir filial : il est dit dans
le » Livre des Rites » (Liji《禮記》)
qu’on ne peut pas vivre sous les mêmes cieux que l’assassin de
son père. C’est le cas de la jeune fille au centre du récit dont
toute la famille, sauf elle, a été décimée par des bandits. Elle
semble se soumettre à eux, mais ce n’est que pour mieux se
venger, après quoi il ne lui reste plus qu’à se suicider.
| |

La vengeance de Cai
Ruihong |
|
À côté de ces
comédies de mœurs, Christiane a aussi été sensible à la
satire sociale de la corruption, tout autant que des
superstitions, comme dans « Treize morts pour une sapèque » (《一文钱小隙造奇冤》).
Mais dans l’ensemble, elle a beaucoup aimé les ficelles du
conteur/fabuliste, son humour, ainsi que la diversité des thèmes
et des dialogues, voire des discours de certains personnages
(l’entremetteuse par exemple, machiavélique). Certains récits
lui ont semblé très modernes, comme l’histoire des « lingots
voyageurs » du récit « Shi Fu homme de bien »
où elle a trouvé un véritable monologue intérieur.
- Dorothée
MS,
quant à elle, a lu un recueil de textes traduits en allemand, La
tunique de perles et autres, dans une collection intitulée
« Neuer chinesischer Liebesgarten » (anthologie d’histoires
d’amour chinoises de la période Ming).
Elle a lu
l’histoire de « La tunique de perles » comme celle de Pénélope :
Pénélope dont on ne parle pas, elle ne fait qu’attendre,
attendre Ulysse qui, lui, voyage et a plein de trucs à raconter.
Mais justement, chez Feng Menglong, elle a trouvé qu’on ne sait
pas grand-chose, au contraire, des voyages des marchands, ni de
leur monde à eux.
[Sauf celui
qui fait la fortune de sa maîtresse dans le récit tiré du
dernier des San Yan : « Indigné, le vieux valet Ah Ji fait la
fortune de sa maîtresse » (《徐老仆义愤成家》).
En effet, ce sont justement ses diverses transactions, et le
flair aussi bien que l’esprit d’entreprise avec lesquels il les
mène à bien, qui constituent le cœur de l’intrigue, et les
détails sont importants pour montrer son irréfragable probité].
En revanche,
elle a apprécié les détails pratiques de la vie quotidienne, et
en particulier le coût exorbitant des entremetteuses…
- Sylvie D.
a choisi pour sa part une adaptation en bande dessinée de « La
tunique de perles » (rebaptisée « perlée ») parue chez You Feng.
C’est une réduction du texte, mais en version bilingue, avec
transcription pinyin, que Sylvie a trouvée pratique pour
travailler un peu son chinois tout en lisant l’histoire.
Histoire qui
l’a intéressée par la satire sociale qui en transparaît : les
mariages et remariages du mari l’ont amusée.
[Ces
adaptations en bandes dessinées chez You Feng sont inspirées des
bandes dessinées chinoises dites
lianhuanhua
(连环画),
qui ont eu leur heure de gloire au
début du 20e
siècle
avec les progrès des techniques d’impression, puis pendant la
période maoïste à des fins d’édification des masses à un moment
où la majorité de la population était encore quasiment
analphabète. C’est donc l’image qui prime, le texte ne venant
qu’en contrepoint. Sauf dans le cas des « nouvelles
illustrées de Lu Xun » par Feng Zikai
(丰子恺),
par exemple, où l’illustration est une mise en image du texte,
respectueusement préservé – dans un autre format.
Dans le cas de
Feng Menglong, chez You Feng, on perd le texte, résumé en
quelques lignes, en chinois moderne. Le titre du livre est
trompeur, il faudrait dire : adapté de Feng Menglong].
| |
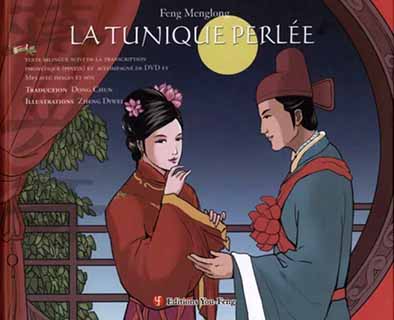
La
tunique perlée, éd. You Feng |
|
________
Pour conclure,
je laisserai la parole à André Lévy et à son article paru en
1967 dans le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, sur
deux contes de Feng Menglong tirés l’un du premier des Trois
Propos, qui relève du récit historique, mais avec visite de
l’enfer, l’autre du troisième :
Deux contes
philosophiques Ming et leurs sources.
Contes définis
comme philosophiques car l’un pose le problème du mal (à travers
l’arrivée au pouvoir du Premier Empereur Qin Shi Huangdi),
dénonce le pouvoir de l’argent et loue la révolte, tandis que
l’autre brode sur le thème de la recherche de l’immortalité à
travers l’adaptation, à travers un conte en langue classique du
9e siècle, d’une histoire venue d’Inde.
L’étude
d’André Lévy montre bien tout l’art de Feng Menglong dans la
précision réaliste de la peinture sociale et des détails
psychologiques, avec recours récurrent au monologue intérieur,
comme l’a bien noté Christiane P.
Réalisme qui
n’exclut pas le merveilleux mais l’intègre au quotidien.
Prochaine
séance :
Le mercredi
24 janvier 2024
Au programme,
une poétesse des Tang devenue prêtresse taoïste –
Yu Xuanji (魚玄機/魚玄机)
- qui a inspiré un roman de Robert Van Gulik :
- Assassins
et poètes (Poets
and Murders, pub. posthume 1968), trad. Anne Krief, 10/18, 1985
/1999, 279 p. : la dernière aventure du juge Di.
Et éventuellement (faute de mieux à lire dans le métro) le roman
de Qiu Xiaolong également inspiré du personnage de Yu Xuanji :
- Une
enquête du vénérable juge Ti, attribuée à l’inspecteur Chen Cao,
traduit par Adelaïde Pralon, Liana Lévi/Piccolo, 2020, 144
pages.
Ou original en anglais : The Shadow of the Empire (A Judge Dee
Investigation), Severn House, 2021.
A lire en
complément
- Pour
plus de détails sur l’histoire de la poétesse et son contexte :
Gender, Power and Talent, the Journey of Daoist Priestesses in
Tang China, Jinhua Jia, Columbia University Press, 2018. Chap.
VII: Unsold Peony. The Life and Poetry of the Priestess-Poet Yu
Xuanji.
- Des
traductions de ses poèmes :
En anglais
en ligne
avec les
textes
originaux en chinois.
En français :
trois poèmes traduits dans l’anthologie
Femmes poètes de la Chine,
de Shi Bo, Le Temps des Cerises, 2015, pp. 87-89
|

