|
|
Danmei :
la littérature comme phénomène de société
par Brigitte
Duzan, 7 juillet 2025
Danmei
(dānměi
耽美)
signifie littéralement «
se
livrer, s’adonner à la beauté ». C’est un genre littéraire dont
la thématique est constituée par les relations intimes entre
personnages masculins, et dont la particularité est d’être écrit
par des femmes pour un public généralement hétérosexuel, et en
grande partie féminin. Mais c’est là une définition quelque peu
réductrice car le danmei mêle en fait, selon les auteurs
et autrices, des genres très différents, des romans
traditionnels chinois, dont les romans d’arts martiaux, à la
science-fiction et à la fantasy.
Le danmei
est encore relativement récent en Chine continentale où, limité
par les conditions d’expression et de publication, il est tout
au plus un phénomène de société. Ses origines, au Japon,
montrent cependant qu’il peut être créatif.
I. Origines
japonaises
Également
désigné par le terme de Boys’ Love (BL), ce genre de fiction est
apparu et s’est développé au Japon dans les années 1970, dans
les cercles du magazine Barazoku (薔薇族),
la Tribu des roses, lancé en 1971. La rose Bara, en
chinois qiángwēi (蔷薇 :
rose du Japon) est associée à la culture gay japonaise, inspiré
sans doute d’un recueil de photographies homoérotiques publié
par Yukio Mishima et Eikoh Hosoe (細江
英公) en
1963 : Bara-kei (薔薇刑)
« Killed by Roses »
.
Du yuri
….
Il existe un
équivalent féminin : yuri (百合)
ou « Girls’Love » (GL), en chinois bǎihé (百合),
le lys, également apparu dans les années 1970. Ces œuvres de
fiction concernent des relations intimes entre femmes, mais pas
forcément lesbiens, des liens spirituels ou des relations
fusionnelles. Elles sont historiquement et thématiquement liées
au shōjo manga (少女漫画),
le manga pour filles, l'une des trois principales catégories
éditoriales du manga, avec le shōnen manga (少年漫画),
mangas pour jeunes ados, et le seinen manga (青年漫画),
mangas pour jeunes adultes masculins.
Shōjo,
cependant, désigne plutôt une classe sociale, apparue
pendant l’ère Meiji pour désigner les filles et jeunes femmes
entre adolescence et mariage, donc d’une part les adolescentes
scolarisées dans le secondaire (avec idée associée d’innocence
et de pureté) et les jeunes femmes moga (modan gāru
モダンガール),
c’est-à-dire la « modern girl » des années 1920, non mariées,
qui travaillent et ont une image plus ou moins sulfureuse. Les
premiers magazines dédiés aux shōjo apparaissent en 1902
avec la création du Shōjo-kai (少女界)
ou « cercle des filles ».
| |
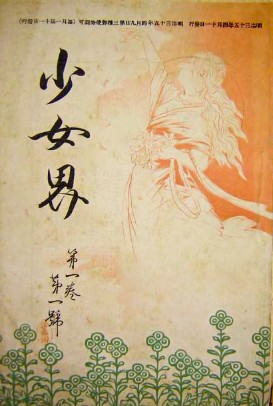
Premier numéro du Shōjo-kai, 1902
|
|
Cependant,
les mangas restent sous-représentés dans ces magazines, ce sont
tout au plus quelques pages, laissant la place majoritairement
au shōjo shōsetsu (少女小説)
ou « roman pour filles », constitué de romans et poèmes
illustrés. Ces histoires illustrées - histoires « d'amour et
d'amitié » - sont déterminantes dans la mise en place de la
culture shōjo, en posant les bases de thèmes récurrents.
En tête des autrices emblématiques de cette époque, on trouve
notamment Nobuko Yoshiya (Yoshiya Nobuko吉屋
信子) et
sa série Hana monogatari (花物語),
« Les Contes de la fleur », 52 récits publiés entre 1916 et
1924. Cette romancière décrit des relations de type esu
(エス),
pratique née de la scolarisation des filles au début de l’ère
Meiji désignant les relations intimes entre deux écolières d’âge
différent, l’onē-sama (お姉さま, grande
sœur) et l’
imōto
(妹, petite
sœur). Son dernier ouvrage est publié en 1971, deux ans
avant sa mort : Nyonin Heike (女人平家)
ou « Les Dames du Heike ».
| |
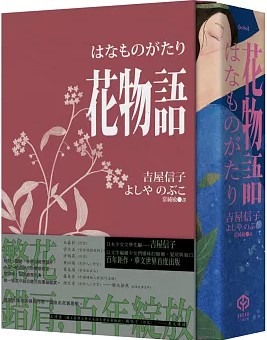
Hana monogatari |
|
L’esu
se retrouve également, au même moment, dans la littérature
chinoise de la période de la Nouvelle Culture, chez les
romancières autour de
Lu Yin (庐隐),
et en particulier son amie
Shi Pingmei (石评梅)
avec
laquelle elle a entretenu une longue correspondance et dont elle
a écrit l’histoire tragique.
Après la
guerre et son cortège de privations et de malheurs, l’heure est
plutôt au divertissement. Au Japon, le roman populaire se
développe à nouveau, avec des librairies de location qui
rappellent aussi ce qui se passe en Chine avec les
lianhuanhua
(连环画).
De nouveaux
mangakas, dont Osamu Tezuka (Tezuka Osamu
手塚 治虫),
reprennent la figure de l'héroïne garçon manqué, mais dans un
nouveau format déjà populaire dans le shōnen manga, le « story manga »,
qui propose de longs récits dramatiques plutôt qu'une succession
de vignettes plus ou moins indépendantes. L'œuvre emblématique
du genre est « Princesse Saphir » (Ribon no kishi
リボンの騎士)
de Tezuka, sorte de conte de fées publié de 1953 à 1956 dans le
magazine Shōjo Club, qui impose ce type de récit et son
style dynamique dans les magazines shōjo. Ces magazines
publient par ailleurs des récits d'aventures mettant en scène
une jeune fille, parfois travestie, qui se bat à l'épée, un
genre, le onna engeki (女剣劇?),
apparu dans les années 1920, où l’on retrouve les
histoires chinoises de nüxia (女侠)…
| |
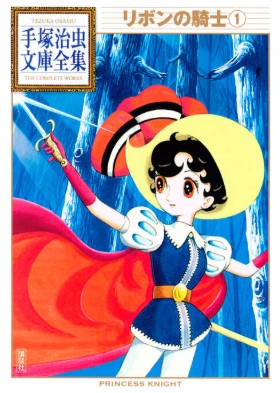
Princesse Saphir Ribon no kishi
リボンの騎士
(vol. 1) |
|
Jusqu’à la fin
des années 1950, le manga pour fille Shōjo est
principalement produit par des hommes, avec des tragédies à la
chaîne. Mais, au cours des années 1960, de nombreux magazines
mensuels sont remplacés par des hebdomadaires, des concours
permettent de repérer de nouveaux auteurs, où les femmes
dominent. Les années 1970 sont l’âge d’or du shōjo manga
avec une nouvelle génération inaugurant des thèmes inédits :
science-fiction, fantasy, manga historique… C’est aussi à cette
époque que deux autrices lancent un nouveau genre : le shōnen'ai
ou yaoi (やおい)
= BL),
mettant en scène les liens intimes et affectifs, et souvent
ambigus, entre personnages masculins.
… au
yaoi
Les deux
autrices, pionnières du genre BL, sont Keiko Takemiya (竹宮
惠子, Takemiya
Keiko), née en 1950, et Moto Hagio (萩尾望都, Hagio
Moto), née en 1949. La première débute comme mangaka en
février 1967 avec un manga publié dans le magazine COM fondé par
Osamu Tezuka : Otōto (弟),
histoire de deux « frères » qui préfigure les thématiques BL
qu’elle développera par la suite. Elle s’installe à Tokyo à
partir de 1970 et emménage avec Hagio Moto, dans un appartement
proche de celui de leur amie commune Norie Masuyama, formant
avec d’autres mangakas le « salon Ōizumi », base du « groupe de
l’an 24 » (24年組, Nijūyo
nen Gumi).
Keiko Takemiya
publie ensuite le « Poème du vent et des arbres » (風と木の詩Kaze
to ki no uta)
publié à partir de janvier 1976 et jusqu’en 1984. C’est devenu
un classique : il a contribué au lancement en octobre 1978 du
magazine [June], l’un des premiers dédiés au genre Boys’ Love
(BL).
| |
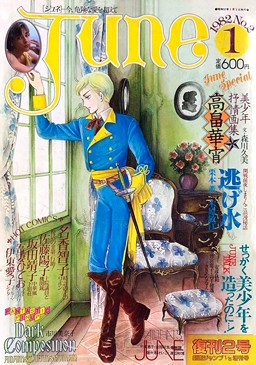
Le
magazine June, numéro de janvier 1982,
avec
une couverture illustrée par Keiko Takemiya |
|
Moto Hagio,
pour sa part, après des débuts difficiles, décolle après avoir
attiré l’attention de Norie Masuyama qui lui fait connaître les
œuvres de Hermann Hesse, puis après avoir emménagé avec Keiko
Takemiya, dans le quartier Ōizumi, créant là un salon à l’image
des salons littéraires français du 19è siècle dans le but
d’améliorer la qualité du Shōjo manga, alors déconsidéré
auprès des critiques et éditeurs. Le Salon prend fin en 1973,
mais le Shōjo manga entre alors dans son âge d’or. En
1974, un éditeur travaillant pour le Shōjo Comic demande
à Moto Hagio une œuvre semblable à « La Rose de Versailles ».
C’est « Le Cœur de Thomas » (トーマの心臓, Tōma
no shinzō), grand classique de BL inspiré des
Bildungsromane de Hermann Hesse ainsi que par le film de
1964 « Les Amitiés particulières » de Jean Delannoy d’après le
roman de Roger Peyrefitte. Il a été adapté en film, au théâtre
et en roman. Ayant ainsi acquis la notoriété lui permettant de
se libérer des contraintes éditoriales, Moto Hagio a ensuite
publié ce qu’elle désirait faire depuis le début : des histoires
de science-fiction qui étaient encore inexistantes dans le genre
Shōjo manga. C’est de la science-fiction féministe,
influencée par Ursula Le Guin. Puis, à partir des années 1980,
Moto Hagio aborde des thématiques plus dures et plus sombres :
thrillers avec parricide dans le milieu de la drogue, ou
science-fiction post-apocalyptique….
De son côté,
Riyoko Ikeda (池田理代子Ikeda
Riyoko),
l’autrice de « La Rose de Versailles », connaît un immense
succès
,
avec des adaptations qui renouvellent le genre : le film réalisé
en 1978 par Jacques Demy « Lady Oscar », ou la comédie musicale
interprétée par la troupe féminine du Tarazuka. Ikeda crée
ensuite « La fenêtre d’Orphée » (オルフェウスの窓, Orufeusu
no Mado) publié de 1977 à 1981 dans le mensuel Seventeen.
L’histoire de « La Rose de Versailles » était celle de la reine
Marie-Antoinette et d’Oscar François de Jarjayes, élevée comme
un garçon par son père et, devenue militaire, affectée à la
garde de la reine ; « La fenêtre d’Orphée », fondée sur une
légende, est l’histoire des liens entre trois personnages
masculins, dont l’un est en fait une femme, comme Oscar. Ikeda
sème ainsi les bases du développement d’un nouveau genre, dit
bishōnen (美少年),
dont le personnage masculin est androgyne. Bishōnen qui
sont également privilégiés par Moto Hagio, dans une ambiguïté de
genre, théoriquement « neutre » (中性, chūsei),
mais intérieurement féminin, autorisant diverses
interprétations.
De là est né
le danmei….
II. Le
danmei : une littérature de plus en plus populaire en Chine,
mais censurée
C’est au début
des années 1990 que le genre Boys’ Love (BL) a été introduit en
Chine continentale via des traductions taïwanaises piratées de
mangas japonais. Le terme danmei est lui-même emprunté au
japonais tanbi (耽美),
au sens d’esthétisme.
En 1999 ont
été créés plusieurs forums danmei en ligne qui ont
d’abord servi les fans chinois de BL japonais, mais ont vite
accueilli des histoires originales écrites par des Chinoises. De
cette même année 1999 date la création du premier mensuel
chinois consacré au danmei – « Danmei Season » (《耽美季节》)
- qui a continué jusqu’en 2013 malgré l’absence d’autorisation
officielle. Au début, les premières communautés étaient le fait
d’amateurs. Puis se sont multipliés les sites web de fiction sur
internet. Le plus important pour ce qui concerne le danmei
est « Jinjiang Literature City » (Jìnjiāng Wénxuéchéng 晋江文学城),
fondé en 2003, qui publie des œuvres originales, romances
hétérosexuelles, gays, lesbiennes et autres. Le genre attire un
vaste public, les adaptations se multiplient et sont diffusées
sur les plateformes vidéo (youku, tencent, etc).
| |

Jìnjiāng Wénxuéchéng 晋江文学城
|
|
On peut
distinguer plusieurs phases de développement :
1/ Phase
initiale (1994-2003 )
On peut dater
cette phase initiale des débuts officiels de l’internet en
Chine, en avril 1994.
Mais, dès 1998
a été conçu le projet « Bouclier doré » (金盾工程)
qui a abouti en novembre 2003 à l’établissement du « Grand
Pare-feu » (ou Great Firewall of China
防火长城)
qui a isolé l’internet chinois du reste du monde. Les fictions
danmei comportant des descriptions érotiques ou des
éléments relevant de la « culture queer » ont été bloquées,
cette culture étant considérée comme le produit de la modernité
occidentale et potentiellement dangereuse pour les valeurs
sociales chinoises.
Le danmei
est ainsi apparu comme une menace pour le pouvoir et a été
combattu comme tel, alors que l’homosexualité masculine a été un
trait de société en Chine depuis les temps les plus anciens, et
qu’on en a maints exemples dans la littérature ancienne. Dans la
littérature classique, en effet, à côté de nombreux poèmes
célébrant des amitiés masculines fondées sur une connivence dans
l’appréciation de l’art et de la poésie, il existe des récits
fictionnels dont l’intrigue repose sur une liaison entre deux
hommes, le plus souvent dans une relation maître-disciple. Ces
amours masculines se trouvent entre autres dépeintes avec humour
dans l’œuvre de Li Yu (李漁)
au 17e siècle, en particulier dans son recueil de
nouvelles écrites en langue vulgaire intitulé « Théâtre du
silence » (Wusheng xi《无声戏》).
La sixième « pièce » de ce théâtre est justement l’histoire d’un
riche lettré qui adopte un jeune garçon d’une grande beauté dont
il est tombé éperdument amoureux et qu’il « épouse » ; le titre
donne aussitôt à l’histoire une connotation classique : « Un
homme du genre "mère de Mencius" déménage trois fois pour
éduquer son protégé » (《男孟母教合三迁》).
| |
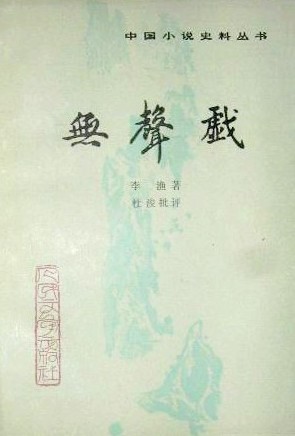
Wusheng xi,
éd. 1989 |
|
Li Yu a ajouté une introduction pleine d’humour dans laquelle il
offre une petite histoire des coutumes homosexuelles
(masculines) de l’époque, dont il fait une tradition « du
Sud » : le « mode méridional » (nanfeng (男风).
L’histoire se passe donc dans la région du Fujian, sous
l’empereur Jiajing des Ming (嘉靖帝),
c’est-à-dire pendant la période 1522-1566. La tradition semble
s’être généralisée par la suite, en particulier dans les milieux
de l’opéra de Pékin. Un roman du milieu du 19e siècle
exalte l’amour romantique liant des lettrés passionnés d’opéra
et des jeunes garçons spécialisés dans les rôles féminins :
c’est le « Miroir précieux pour classer les fleurs » (Pinhua
baojian《品花宝鉴》)
de Chen Sen (陈森),
datant de 1837, où le genre devient une notion floue et
instable, les limites entre masculin et féminin apparaissant
comme des constructions essentiellement sociales, de même que, à
l’opposé, on a aussi une confusion des genres dans l’opéra
traditionnel où des rôles masculins étaient interprétés par des
femmes : rôles martiaux ou rôles de lettrés - souvent des femmes
déguisées en hommes pour aller passer les examens impériaux qui
étaient interdits aux femmes.
| |
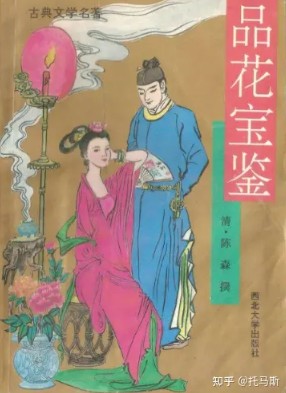
Le
Pinhua baojian |
|
Mais ces
textes sont décriés par les réformistes chinois du début du 20e
siècle. Le Pinhua baojian de Chen Sen, en particulier, a
été vertement critiqué par Hu Shi (胡适),
l’un des grands maîtres à penser de la renaissance culturelle du
début du siècle ; une pratique aussi institutionnalisée et
entrée dans les mœurs que l’homosexualité masculine est ainsi
contestée dans les années 1900-1910 comme appartenant à des
déviances d’une certaine élite de la société chinoise
« féodale », et en tant que telle contraire à l’esprit de
modernisation.
L’intérêt
suscité par le thème de l’homosexualité au début du 20e siècle
dans une Chine en plein bouleversement socio-culturel est
apparent dans l’émergence de termes spécifiques pour désigner
l’amour entre personnes du même sexe : tongxing lian’ai (同性恋爱), tongxing
ai (同性爱)
et autres variations ; ces néologismes sont créés sous
l’influence des ouvrages et romans occidentaux traitant
d’homosexualité, pour les traduire en chinois. Les traductions
et articles se multiplient, en particulier dans les journaux
féminins comme Le journal des femmes (《妇女杂志》).
On a donc bien là un phénomène précurseur des danmei
inspirés du Japon à partir des années 1990, y compris dans le
fait que les fictions sont essentiellement destinées à un
lectorat féminin.
Cette première
phase s’achève en 2003 avec la création de « Jinjiang Literature
City » qui marque une sorte de stabilisation et normalisation du
danmei, fondée sur le compromis.
2/ Phase
d’expansion
(2003-2016)
Tandis que les
danmei piratés des débuts étaient réprimés, la plateforme
Jinjiang a été « acceptée » et a permis un développement du
danmei marqué par une diversification des contenus et des
modes d’expression. En même temps, le danmei chinois se
distinguait des formes développées à Taiwan, sur la plateforme
« Haitang Culture » (海棠文化)
en particulier. Devenu le principal site de référence de BL en
Chine continentale, « Jinjiang Literature City » s’est efforcé
de rechercher des œuvres originales de qualité, dans des genres
et sur des thèmes très variés allant des arts martiaux à
l’histoire dynastique, renouant ainsi avec la littérature
vernaculaire classique, comme un retour aux sources.
Ces œuvres
originales de danmei, ou yuandan (原耽),
se sont particulièrement développées entre 2013 et 2016 selon
une double approche :
- D’une part,
dans un contexte où la ligne idéologique était de « renforcer la
confiance dans le socialisme à caractéristiques chinoises », le
danmei l’a interprété en termes de confiance dans la
longue histoire culturelle du pays, en rupture avec l’imitation
de la culture populaire occidentale aussi bien que des mangas
japonais et des dramas coréens. Le danmei s’est tourné
vers la société chinoise contemporaine, mais aussi vers
l’histoire classique, celle des Trois Royaumes et de la dynastie
des Tang en particulier, avec des fictions mêlant réalité et
fantasy.
- D’autre
part, cette culture originale danmei s’est développée en
lien avec la normalisation de la cybersphère publique chinoise.
« Jinjiang Literature City », en particulier, permet aux auteurs
et à leurs lecteurs de former une communauté interactive, tandis
que WeChat, Weibo et autres offrent des réseaux de diffusion et
d’échange qui vont dans le sens d’une popularisation du
danmei. L’amélioration de la technologie permet des progrès
aussi dans la génération de revenus stables et diversifiés.
3/ Phase
d’essor des romans et de leurs adaptations
(2016-2021)
L’année 2016 a
été nommée « Année des séries danmei » en raison de la
multiplication des adaptations à la radio et sur internet, ce
qu’on appelle les dāngǎi (耽改).
Au lieu de se contenter d’œuvres littéraires en production
papier, avec des profits publicitaires restreints, le danmei
est passé d’une niche culturelle à un vaste marché commercial en
ligne et à la télévision, alimenté par des produits dérivés de
toutes sortes, dont les albums de chansons.
Il faut
ajouter le fait que le dangai a aussi été inspiré par les
héros de Startrek, l’univers Marvel et autres, et a généré un
fandom généralement proche du slash dit euroaméricain
(欧美).
Ce cercle de fans a décliné, pour se rabattre sur les
célébrités, à commencer par les deux jeunes Wang Junkai (王俊凯)
et Wang Yuan (王源)
du groupe TF Boys, puis Huang Jinyu (黄景瑜)
et Xu Weizhou (许魏洲),
les deux acteurs du premier dangai, diffusé début 2016,
« Addicted » (《上瘾》),
adapté du roman « Are you Addicted ? » (《你丫上瘾了》)
de l’autrice Chai Jidan (柴鸡蛋).
La série a disparu des plateformes de streaming chinoises trois
épisodes avant la fin. Les acteurs ont continué leur carrière,
mais séparément : ils ont désormais interdiction de se produire
ensemble.
C’est cette
prolifération de la culture danmei et des cercles de fans
qui a suscité la réaction brutale des autorités de censure,
d’abord contre les séries dangai.
4/ Succès
populaire et censure des adaptations (2021-2024)
Lors d’un
symposium à Pékin de l’Administration de la radio, du cinéma et
de la télévision nationales, le 16 septembre 2021, le directeur
adjoint
Zhu Yonglei (朱咏雷)
a demandé
« que soit renforcée la qualité des créations de séries
télévisées » et appelé « à résister résolument à la tendance
actuelle à adapter des danmei (“耽改”之风)
et autres divertissements (du même genre) » [坚决抵制“耽改”之风等泛娱乐化现象].
Il a également déploré le phénomène chaotique des luttes entre
fans, faisant allusion à deux des plus populaires séries
télévisées dangai qui ont déchaîné des passions pour les
acteurs : « The Untamed » (Chen Qingling《陈情令》)
et « Word of Honour » (Shanhe ling《山河令》).
« The
Untamed » a été diffusée sur Tencent Video en trois saisons
(2018-2021). La série est adaptée d’un roman de l’une des plus
célèbres autrices de danmei, connue sous le pseudonyme de
Mo Xiang Tong Xiu (墨香铜臭) :
« Le Grand Maître de la cultivation démoniaque » (Mo Dao Zu
Shi
《魔道祖师》).
La série dépeint un monde où les humains se livrent au culte de
l’immortalité (xiānxiá
仙俠)
.
Au début de l’histoire, le « jeune maître » en arts martiaux,
beau comme un dieu, du clan Gusu Lan (姑苏蓝氏),
Lan Zhan (蓝湛),
arrive dans un village attaqué par une force démoniaque. Il y
retrouve un homme qu’il a rencontré dans le passé, Wei Wuxian (魏无羡),
qui cultivait l’immortalité mais a dévié de la voie et créé une
« voie démoniaque » (guidao
鬼道).
« Word of
Honour » est une série en 36 épisodes diffusée de février à mai
2021 sur Youku (qui l’a coproduite). Elle est adaptée d’un roman
danmei de l’autrice connue sous le pseudonyme de
Priest : « Faraway
Wanderers » (Tianya ke
《天涯客》)
et figurait sur la liste Teen Vogue des meilleurs « dramas BL »
de 2021. La série a été retirée des plateformes vidéo chinoises
en août 2021 à la suite de l’interdiction de l’acteur Zhang
Zhehan (张哲瀚)
qui en interprète l’un des deux rôles principaux, aux côté de
Gong Jun (龚俊)
.
En 2018, une
autre série, diffusée sur Youku en juin-juillet, avait subi
l’ire des autorités pour son contenu « vulgaire et nocif » :
« Guardian » (Zhèn Hún
《镇魂》),
également adapté d’un roman de Priest. L’histoire se passe sur
une lointaine planète semblable à la terre où un détective et un
professeur enquêtent sur des phénomènes surnaturels. L’ire des
censeurs était motivée par le sous-texte homoérotique. Mais,
comme les autres, la série a rendu célèbres les deux acteurs
principaux, Bai Yu (白宇)
et Zhu Yilong (朱一龙)
– ce même Zhu Yilong que l’on retrouve en chef de la police
criminelle dans le film « Only
the River Flows » (《河边的错误》)
de Wei
Shujun (魏书均)
qui était en compétition au festival de Cannes en 2023, et qui a
battu des records au box-office quand il est sorti sur les
écrans chinois en octobre.
À la suite de
l’allocution de Zhu Yonglei, 57 séries danmei ont été
interdites en Chine continentale. Ainsi, le 30 janvier 2023, la
série télévisée « A League of Noblemen » (《君子
盟》)
adaptée du roman de Dafeng Guaguo (大风刮过)
semble être passée entre les gouttes, mais, deux mois plus tard,
bien que sur le même thème, « Justice in the Dark » (《光·渊》)
diffusée sur Youku a été suspendue après le huitième épisode.
Cela crée un sentiment d’incertitude sur l’avenir des dangai.
5/ Censure
des romans et arrestations de leurs autrices (2024-2025)
En 2024, les
autorités sont passées à la vitesse supérieure, en réprimant en
masse au lieu de procéder individuellement : à partir du début
de l’année, plus de cinquante autrices ont été interpellées par
les autorités judiciaires de l’Anhui et du Gansu pour diffusion
d’ouvrages classés « pornographiques ».
La répression
a en fait commencé en 2018, lorsque Tianyi (天一),
autre figure majeure du danmei, a été condamnée à dix ans
et demi de prison, ce qu’on a appelé « l’incident Tianyi de fan
fiction » (天一同人本事件).
Son roman Gongzhan (《攻占》),
décrivant une relation homosexuelle entre un professeur et son
élève, avait généré plus de 150 000 yuans de revenus. Le
jugement a été rendu par la cour du district de Wuhu dans la
province de l’Anhui (安徽省芜湖县法院)
fin octobre 2018. Le Centre d’inspection et de supervision de la
qualité (littéraire) avait auparavant souligné la violence, les
insultes et autres actes de « perversion sexuelle » dont ces
œuvres abondent, selon les censeurs, et les avaient classées
dans la rubrique « publications obscènes » (“淫秽出版物”).
Tianyi a été arrêtée à son domicile dans le Jiangsu et ramenée à
Wuhu dont la cour a prouvé que l’accusée avait vendu en ligne
plus de 7000 exemplaires du livre, pour un profit « illégal » de
150 000 yuans. D’où la condamnation à dix ans de prison,
confirmée par une deuxième cour, sans possibilité d’appel.
On a comparé
ce verdict avec les cas de violence domestique, enlèvements et
violences sexuelles intervenus pendant la même période, et
réglés par des peines minimales. Il faut souligner que la loi
sur la criminalité des publications illégales (《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》)
date de 1998, et que l’homosexualité n’est plus considérée comme
un crime en Chine depuis 1997. La répression semble donc viser
une forme d’expression culturelle et littéraire, dans un climat
politique visant à renforcer une morale traditionnelle fondée
sur la famille confucéenne, au service du pouvoir. Il faut
souligner aussi que la plupart des autrices arrêtées publiaient
sur la plateforme Haitang Literature (海棠文学)
qui est spécialisée dans le danmei et dont les serveurs
sont à Taiwan. Jinjiang, pour sa part, pratique une sorte
d’autocensure depuis 2014 : le site a requalifié en chun’ai
(纯爱),
« amour pur », les romans danmei publiés sur son site en
interdisant tout contenu intime et explicite en-dessous du …
cou. Les sanctions varient aujourd’hui selon les revenus tirés
de la vente des livres et la capacité des condamnées à
rembourser.
Les démêlés de
ce genre avec la justice remontent plus précisément au vote du 7
novembre 2016 par le Comité permanent du Congrès national du
peuple de la « Loi sur la cybersécurité » (《网络安全法》),
puis à son entrée en vigueur en juin 2017 : les questions
relevant de l’homosexualité « et autre perversions sexuelles »
sont classées parmi les principales cibles de la réglementation.
Mais s’y ajoutent les intérêts financiers.
C’est en 2017
que
Jin Yong (金庸)
a poursuivi en justice, pour avoir plagié des éléments de son
œuvre, le roman danmei sérialisé sur internet en 2001
puis publié en 2002 : « Les jeunes d’ici » (《此间的少年》),
premier roman de Jiang Nan (江南),
nom de plume de Yang Zhi (杨治).
C’est le « premier procès de fan fiction » (“同人第一案”)
en Chine, et c’était en fait une question de produits dérivés (二次创作)…
et de gros sous. Les personnages (et ceux des romans suivants)
sont en effet inspirés des romans de Jin Yong, mais l’histoire
est complètement différente. Dans la fiction de Jiang Nan, Guo
Jing (郭靖)
est un étudiant venu de Mongolie qui étudie la chimie (comme
Jiang Nan) à l’université Bianjing (汴京大学) [ancien
nom de Kaifeng, dans le Shuihuzhuan par exemple]; le
premier jour, il rencontre Yang Kang (杨康),
étudiant en biotechnologies, puis Huang Rong (黄蓉),
étudiante en physique
…
En 2009, le
roman figurait parmi les « Dix œuvres remarquables » de la
compétition « Dix ans de littérature sur internet » organisée
conjointement par les éditions de l’Association des écrivains
chinois et China Online. En 2010, les étudiants de l’université
de Pékin en ont produit une version filmée (« There They
Were »). Puis, en 2016, Huace Films (华策影业)
a annoncé une adaptation au cinéma tandis qu’était aussi
annoncée une adaptation télévisée. C’est alors que Jin Yong a
intenté une action en justice, pour violation des droits
d’auteur.
En juin 2015,
un auteur en ligne écrivant sous le pseudo « Le grand méchant
loup ailé » (“长著翅膀的大灰狼”)
avait été condamné à 3 ans et demi avec sursis pour des raisons
similaires. En 2017, Shen Hai (深海)
est devenu encore plus célèbre pour avoir été arrêté « pour
opérations commerciales illégales » (非法经营罪).
Désormais, la répression est systématique et vise, en majeure
partie, de toutes jeunes autrices qui gagnent ainsi leur vie.
Leur peine, qui peut aller jusqu’à dix ans de prison, est
allégée si elles peuvent rembourser les sommes perçues, mais on
leur demande parfois d’en rembourser le double.
La frayeur a
gagné toutes ces jeunes écrivaines dont beaucoup n’ont guère
plus d’une vingtaine d’années. Et l’on sait que la peur est une
puissance force de dissuasion. Les messages de soutien, les
conseils juridiques, les témoignages disparaissent à mesure que
la police resserre l'étau. Même les lectrices sont parfois
convoquées pour un interrogatoire.
Mais pourquoi
tant de sévérité? Parce que le danmei, loin d'être une
simple littérature de niche, est devenu un phénomène de société.
Il offre aux femmes un espace d'expression codé, à rebours des
normes patriarcales. Pour beaucoup de jeunes autrices, c'est une
manière d'échapper au quotidien où le désir féminin est tabou et
où le mariage et la natalité sont présentés comme des impératifs
nationaux.
Quant au genre
littéraire lui-même, mêlant des éléments thématiques qui
remontent à des traditions anciennes de narration historique, en
reformulant les classiques, du
wuxia
(武侠)
au
chuanqi
(传奇),
il mériterait peut-être d’être mieux connu, comme les romans de
wuxia et comme ceux, en leur temps, du courant des
Canards mandarins et papillons (鴛鴦蝴蝶派).
Mais la censure détruit aveuglément, dans l’œuf, cette
littérature émergente. Comment dans ces conditions voir émerger
une épigone de
Su Manshu (苏曼殊)
ou de
Zhang Henshui (张恨水),
voire une réincarnation de Li Yu (李漁) ?
|
|

