|
|
Histoire littéraire : les sources
anciennes
VI. Le Han Fei Zi
《韓非子》
A.
Présentation générale
B.
Légisme et confucianisme, d’un gouvernement à l’autre
par Brigitte
Duzan, 30 août 2025
Le
Han Fei Zi
(《韓非子》)
est l’ouvrage le plus complet qui nous soit parvenu de la pensée
légiste telle qu’elle a été élaborée par Han Fei au 3e
siècle avant J.C., à l’apogée de la période des Royaumes
combattants. C’est le système de gouvernement « par les lois »
instauré d’abord par Ying Zheng (嬴政), dans
le royaume de Qin (Qin guo
秦国) ;
fondé sur un principe d’encadrement draconien de la population
visant à « enrichir l’État et renforcer l’armée » (fùguó qiángbīng 富国强兵),
cet « art de gouverner » lui permit d’éliminer ses rivaux et
d’établir un Empire unifié fondé sur les mêmes principes.
| |
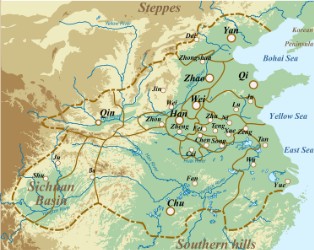
Les
Royaumes combattants à l’époque de Han Fei
(carte
Comses) |
|
1/ Han Fei
et son époque
Han Fei
n’était pas le premier à concevoir un tel système ; il a surtout
systématisé des modes de gouvernement qu’avaient mis au point
des prédécesseurs illustres : Guan Zhong (管仲),
ministre et conseiller du duc Huan de Qi (Qi Huangong
齐桓公) au
7e siècle avant J.C., Shang Yang (商鞅),
conseiller du duc Xiao de Qin (秦孝公),
au 4e siècle av. J.C., auxquels il faut ajouter Shen
Buhai (申不害)
et Shen Dao (慎到).
Les deux
premiers nous ont laissé des ouvrages à leur nom, mais la grande
différence avec le livre de Han Fei, c’est qu’ils sont
essentiellement théoriques, aussi sévères que la pensée qu’ils
exposent, fondée sur l’idée que la nature humaine est
fondamentalement mauvaise et qu’on ne peut la redresser ni
tenter de lui inculquer une quelconque morale ; on ne peut donc
gouverner le peuple que par l’attrait de récompenses et la peur
de châtiments terrifiants.
C’est ce que
préconise le
Han Fei Zi
(《韓非子》),
anecdotes à l’appui, et ce que, à sa suite, souligne entre
autres l’ouvrage de Romain Graziani « Les Lois et les Nombres »
qui insiste sur l’un des fondements du système : la nécessité
d’évaluer et quantifier les ressources et la production afin de
pouvoir asseoir précisément les barèmes de récompenses et
punitions orientant et motivant la population réduite à sa
principale force productive : les paysans. L’ouvrage dissèque en
huit chapitres les méthodes de calcul très élaborées,
aboutissant à un art de gouverner impersonnel et sans fondement
moral, sur la base d’un contrôle permanent et (quasiment) total
de la population, et ce jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’un
absolutisme fondé sur la légitimité du prince en tant
qu’émanation de la loi cosmique et selon le principe de
spontanéité.
Les documents
trouvés lors des fouilles archéologiques qui se sont multipliées
ces dernières années en Chine sont venus corroborer ce système
en apportant des exemples concrets de l’application des
principes légistes et en permettant donc d’en apprécier la
portée pratique. Mais le Han Fei Zi lui-même fourmille
d’anecdotes, savoureuses dans leur sobriété, qui étayent le
raisonnement en montrant le chaos et la corruption générale qui
régnaient à son époque – un chaos tel que seule une main de fer
pouvait en venir à bout. Et le système a refleuri en Chine à
chaque période de chaos, pour les mêmes raisons, l’histoire
chinoise étant une histoire cyclique fondée sur des références à
d’illustres précédents. Le légisme a perduré dans les
institutions, mais surtout dans les esprits.
Par ses
anecdotes, le Han Fei Zi se rapproche d’un roman, et
appelle à se pencher sur la notion de pensée philosophique (et
politique) comme mode d’expression littéraire, avec tout un jeu
de miroirs utilisant des exemples concrets.
Une pensée, en Chine plus que partout ailleurs, vaut par la
manière dont elle est exprimée, se traduisant in fine en
expressions valant slogans.
Han Fei nous livre un tableau de la société de son époque, avec
ses manœuvres à tous les niveaux, depuis les cuisines où les
maîtres de l’art culinaire déploient autant d’astuces tordues
pour se débarrasser de leurs adversaires que les ministres au
sommet de l’État. Les intrigues dressent les uns contre les
autres les membres des clans qui divisent la société, jusque
derrière les portes et tentures des chambres des femmes.
2/ Des
nombres à la lettre, du symbole à la réalité.
Tout commence
par la formule « Enrichir l’État, renforcer l’armée » (fùguó qiángbīng 富国强兵)
inscrite en 2012 en tête des valeurs fondamentales du régime
chinois sous sa forme condensée, résumée à ses deux principaux
caractères : fùqiáng (富强).
L’homme
d’abord, dit Guan Zhong
Dans ce but,
le souverain repose sur une population divisée en quatre
groupes : les hommes éduqués de l’élite, ministres et
conseillers ou se voulant tels (shì
士) ;
les paysans (nóng
農/农)
qui forment la masse laborieuse – ce sont ceux qui travaillent
les champs
田
(écrit
曲)
avec une houe
辰 ;
les artisans (gōng
工)
et les marchands (shāng
商).
Cependant, les seuls fiables, que l’on peut exploiter car étant
attachés à la terre, sont les paysans, appelés au besoin à
devenir soldats en troquant la charrue pour l’épée. C’est une
classification qui date du Guanzi (《管子》)
mais qui n’a pas changé pendant tout l’empire, les marchands
étant relégués au bas de l’échelle sociale, avec des nuances
selon les auteurs
.
Cependant, le
Guanzi commence par un premier chapitre – Mùmín
牧民 ou
« Berger du peuple » – qui en expose le concept fondamental : il
faut donner la priorité au peuple et à son bien-être comme le
fait un berger veillant sur son troupeau. C’est d’abord en
enrichissant le peuple que le souverain pouvait enrichir l’État
selon Guan Zhong, d’où la formule qui a été reprise par Mencius
et bien d’autres : prendre l’homme comme fondement, le mettre au
centre de ses préoccupations (yǐ rén wéi běn 以人為本/以人为本).
Il s’en dégage un sentiment de paternalisme bienveillant qui n’a
rien de légiste. Ce qui l’est, c’est la rigueur de
l’organisation sociale à des fins productives.
L’agriculture d’abord, dit Shang Yang
| |
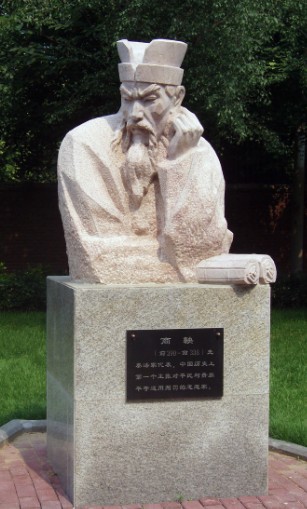
La
statue de Shang Yang |
|
Dans la
production, Shang Yang distingue une production essentielle (běn
本)
d’une production qui ne l’est pas, c’est-à-dire secondaire (mò
末)
– mò
末
étant étymologiquement l’opposé de la racine běn
本
(par exemple la tête de l’arbre), c’était, selon la tradition,
tout ce qui n’était pas la production agricole, soit l’artisanat
et le commerce :
古代称农为本nóng
wéi
běn,反本为末fǎn
běn wéi mò,即工商业
gōng shāng yè.
Autrefois on
disait que l’agriculture était l’essentiel, et ce qui ne l’était
pas secondaire, c’est-à-dire l’artisanat et le commerce.
Encore faut-il
distinguer les marchands relativement stables car disposant
d’une boutique ou au moins d’un étal au marché (gǔ
賈/贾)
des shāng toujours en voyage
.
Ce qui est problématique, chez les marchands, dans le système
légiste, c’est leur caractère général de population itinérante (yóu
遊/游),
ce qui en fait une menace pour la stabilité sociale et les rend
difficiles à contrôler et à taxer. C’est la paysannerie qui
fait la richesse de l’État, d’où la politique visant à attirer
celle des États voisins, comme le préconise Shang Yang (chapitre
Lái mín
来民).
Mais ce monde paysan doit aussi constamment être sur le pied de
guerre, les instruments aratoires (nóng qì
农器)
devant naturellement se convertir en instruments de guerre, et
l’encadrement de la population correspondant à l’organisation de
la soldatesque en brigades.
Dans ce monde
cloisonné, la population ne pouvait que vivre frugalement, selon
l’idéal mohiste, mais perverti car il n’englobe pas le souverain
comme chez Mo Zi (墨子)
dont l’ouvrage comporte tout un chapitre consacré à « Renoncer
aux excès » (cí guò
辭過/辞过)
.
Si les légistes ont perverti cet idéal, souligne R. Graziani (p.
96), c’est parce que, contrairement aux Mohistes qui voyaient
dans le peuple (mín
民)
l’incarnation de l’intérêt public dans un sens de justice
sociale, les légistes, eux, ont procédé à une distinction entre
le souverain identifié comme représentant l’intérêt général et
collectif (gòng
共)
et le reste de la population qui ne pouvait avoir que des désirs
privés et égoïstes (sī
私).
Le peuple devait donc logiquement être freiné dans ses désirs
d’enrichissement pour qu’il se consacre pleinement au travail
productif, travail de la terre ou la guerre au besoin.
En poussant le
raisonnement plus loin
,
on peut imaginer une série d’oppositions liant morale et
intérêt, la tradition (confucianiste) associant les activités
« secondaires », c’est-à-dire non agricoles (mò
末),
à l’intérêt, ce qui relève du profit (lì
利),
alors que l’agriculture en tant que production essentielle (běn
本)
est liée à la droiture morale (yì
義/义).
D’où il découle que c’est en favorisant l’agriculture que l’on
peut avoir une économie gouvernée selon des principes moraux.
C’est une véritable idéologie agraire qu’ont élaborée les
légistes, mais elle a été reconvertie par les lettrés confucéens
selon leurs propres principes moraux.
Idéologie agraire et contrôle social
Raisonnement
démagogique de pure hypocrisie dénoncé par Étienne Balazs dans
son étude sur l’économie et la société de la Chine
traditionnelle
où il montre que marchands et lettrés avaient en fait des liens
d’intérêt en contradiction avec cette doctrine : si le marchand
gênait le lettré, explique-t-il, c’est parce qu’il échappait à
la division traditionnelle de la société entre une caste
bureaucratique dominante (littéralement ‘ceux du dessus, d’en
haut’ : shàng
上)
et une masse d’exécutants (le bas de l’échelle sociale : xià
下).
Mais c’est justement ce conservatisme social excluant le
marchand qui a bloqué le processus d’accumulation du capital
commercial ; seuls étaient possibles les placements usuraires.
Le lettré est devenu propriétaire foncier et usurier.
L’empereur
Hongwu (洪武),
fondateur de la dynastie des Ming au 14e siècle, est
revenu vers ces idéaux de frugalité et de stabilité de
l’économie agraire en décrétant que la stabilité politique
repose sur le soutien à l’agriculture et la répression du
commerce. En même temps, dans le cadre de ses réformes de 1370,
il a instauré le système du lǐjiǎ (里甲)
inspiré des structures mises en place par Guan Zhong, puis Shang
Yang et les légistes à leur suite. Dans le traité « À
l’intérieur des frontières » (Jìng nèi《境內》)
du « Livre du Prince Shang » (《商君書》),
les hommes sont organisés par groupes de cinq, comme au combat ;
si l’un se fait tuer, les quatre autres sont décapités, mais si
l’un d’eux revient avec une tête, il est exempté d’impôts. Une
victoire se mesure en nombre de têtes capturées. La vie agricole
est ainsi militarisée.
L’empereur
Hongwu reprend le système : les foyers ruraux sont regroupés en
unités de 110 (réduits ensuite à 100) constituant un « village »
(lǐ
里)
dont les membres sont responsables collectivement ; les foyers
sont enregistrés dans des « registres jaunes » (huáng cè
黃冊 /黄册)
sur la base desquels sont calculées la corvée, les taxes et les
diverses tâches de service public incombant aux chefs de
villages. Le statut de chacun était héréditaire, y compris pour
les soldats.
C’était une
variante du système du bǎojiǎ (保甲)
instauré par le réformateur Wang Anshi (王安石)
sous les Song du Nord, au 11e siècle – le terme de
bǎo (保défendre,
protéger) soulignant l’objectif de maintien de l’ordre et
d’organisation de la défense territoriale, ensuite étendu à la
collecte des taxes.
Mais, pour
exercer un contrôle adéquat de la population et de la
production, encore fallait-il les chiffrer. D’où l’intérêt des
techniques de calcul.
La
militarisation par les nombres
Les nombres
dépassent largement l’utilisation pratique qu’en ont fait les
légistes ; ils ont dans la culture chinoise une valeur
symbolique qu’a amplement analysée Marcel Granet dans son
ouvrage fondamental sur la pensée chinoise.
Mais, chez Granet, les nombres sont plus des valeurs
qualitatives que quantitatives, et il le souligne : « Pour les
Chinois, les Nombres sont remarquables, à la façon des
Emblèmes » (début du chapitre III) ; ils ont une fonction
classificatoire et un pouvoir descriptif.
| |
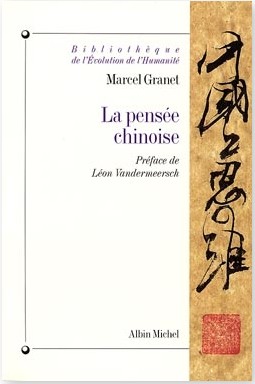
Marcel Granet, La pensée chinoise
|
|
Rien de tout
cela chez les légistes, ou très peu. On est ici dans le concret
et le pratique, ce que Granet appelle « Les recettes de
gouvernement » dans son livre IV sur « Sectes et Écoles ».
Graziani tire la couverture à lui en retenant du chapitre de
Granet sur les légistes (chap. 4 : « L’art de légiférer ») que
« le maître mot dans l’administration des hommes et des choses
est le rendement », plus exactement : « Ce qui justifiait
l’empire de l’Étiquette, c’est l’Efficace qu’on lui
prêtait. Ce qui autorise à déclarer la loi souveraine, c’est le
rendement effectif (gōngyòng
功用) de
la pratique administrative quand elle s’appuie sur des lois. »
(La pensée chinoise, p. 373) - gōngyòng c’est-à-dire son
utilité pratique.
Utilité
pratique à mesurer et chiffrer, au-delà de la schématisation
symbolique du monde esquissée dès le « Livre des documents » (Shangshu《尚书》)
et de « l’effet d’ordre » résultant de l’association des formes
et des choses à des nombres. Le nombre, c’est « le point de
contrôle » sur les choses, à commencer par le terrain militaire,
comme le souligne le premier traité de science militaire qui
nous soit parvenu, datant du 6e siècle avant J.C. :
« L’art de la guerre » (Sūn Zǐ bīngfǎ
《孙子兵法》)
de Sun Zi (孫子/孙子).
Dès le premier
chapitre, l’auteur lance l’idée, nouvelle pour l’époque, que la
suprématie au combat ne dépend pas de la taille des armées ni de
leur valeur martiale, mais de la connaissance précise des forces
en présence sur le terrain et de l’exploitation rationnelle et
intelligente de ces données chiffrées. Au chapitre 5,
« Puissance stratégique » (Bīngshì
兵勢), il
est dit :
亂生於治,怯生於勇,弱生於強。治亂,數也;勇怯,勢也;強弱,形也。
Le chaos naît
de l’ordre, la lâcheté du courage, la faiblesse de la force.
Ordre et chaos sont question de nombre ; courage et lâcheté
question de situation ; force et faiblesse question de forme.
La
quantification passe par des procédures précises (chap. 4 :
« Formations militaires » Jūn xíng
軍形) :
兵法:一曰度,二曰量,三曰數,四曰稱,五曰勝。地生度,度生量,量生數,數生稱,稱生勝。
L’art de la
guerre : 1/ mesurer (dù
度),
2/ évaluer (liáng
量),
3/ dénombrer (shǔ
數),
4/ peser (chēng
稱),
5/ remporter la victoire (shèng
勝/胜).
C’est sur le terrain que l’on prend la mesure, la mesure donne
une estimation des quantités et la quantité donne le nombre,
qu’il s’agit de peser pour obtenir la victoire.
Ces procédures
sont adaptées à la vie agricole par Shang Yang, donnant
naissance à la pratique des inventaires chiffrés pour gouverner
les royaumes. Il précise même la composition idéale du
territoire, entre forêts, lacs, marais, rivières, routes, bonnes
et mauvaises terres. Les chiffres ne sont plus des séries
symboliques mais statistiques, comportant des normes à
respecter, sauf à s’exposer à des punitions proportionnelles,
les retards des messagers ou des convois de condamnés, par
exemple, le trajet étant chronométré. On le voit à plusieurs
reprises dans le roman « Au
bord de l’eau » (Shuihuzhuan《水浒传》).
R. Graziani
cite l’exemple du recueil de normes fixées pour les artisans que
l’on a trouvé dans les fiches sur bambou exhumées en 1975 de la
tombe n° 11 du site archéologique de Shuihudi, dans le
Hubei (Shuìhǔdì Qínmù Zhújiǎn
睡虎地秦墓竹简),
un site exceptionnel d’une immense valeur documentaire mais
aussi artistique, pour le style de calligraphie et l’art de la
reliure
.
Ce sont des documents qui datent du début du 3e
siècle avant J.C. et sont précieux pour comprendre les lois et
règlements administratifs de la période des Royaumes combattants
dans l’État de Qin, vers l’époque de Han Fei. Les plus
importants sont les statuts légaux concernant les procédures
administratives de contrôle des résultats (xiào
lǜ
《效(律)》),
y compris des procédures mathématiques complexes
,
et celles sur les corvées et le travail forcé (yáo
lǜ《徭律》),
avec « les normes de productivité pour les travailleurs » (gōngrén
chéng《工人程》)
– normes qui concernaient aussi les femmes condamnées aux
travaux forcés dans des ateliers d’État : elles devaient fournir
un travail égal à la moitié de celui d’un homme dans le même
atelier, avec barèmes dégressifs pour les travaux en alternance
sur une même tache et pour les mineures ! Tout était pris en
compte, y compris la durée du jour en été et en hiver…
| |
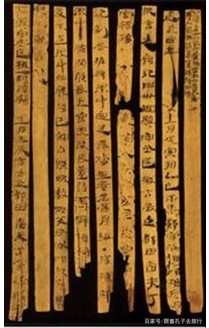
Les fiches sur bambou de
la tombe n° 11 de
Shuihudi |
|
| |
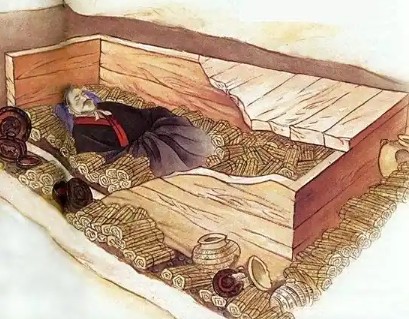
Reconstitution de la tombe avec les fiches
soigneusement
reliées et rangées autour du corps |
|
Tout est posé
en termes de proportions : rétributions proportionnelles au
travail fourni, travail proportionnel à la longueur du jour,
peines proportionnelles aux fautes et délits, etc. Cette idée
est suggérée par le terme même qui désigne ces règlements et
procédures : lǜ
律.
Il désignait en effet, à l’origine, les rapports numériques
entre les tubes musicaux de la théorie musicale chinoise.
L’art et
la magie du chiffre : du slogan à la liste
La primeur des
nombres pour l’appréhension du réel, et la vie pratique, se
retrouve dans l’établissement du calendrier, l’astrologie et les
techniques de divination ; on choisit encore aujourd’hui les
jours « favorables » pour les démarches de la vie courante.
Magie du nombre que l’on retrouve dans les formules chiffrées
des slogans politiques chinois, procédé mnémotechnique que l’on
trouve déjà dans le Han Fei Zi :
- chap. 7 :
Deux « poignées » (èr bǐng
二柄)
pour « tenir le peuple » et donc le gouverner, c’est-à-dire
châtiments et récompenses,
- chap. 9 :
Les huit « infamies » (bā
jiān
八姦),
qui définit la traitrise et la corruption comme étant en premier
lieu le fait de « ceux qui partagent la même couche » (同床),
le caractère
姦
désignant (visuellement) la débauche ;
- chap. 10 :
Les dix fautes (shí guò
十過/过) ;
- chap. 16 :
Les trois précautions (sān
shǒu
三守),
c’est-à-dire les manquements dont il faut se garder, en veillant
à ce que les règles soient respectées (shǒu
守) ;
- chap. 46 :
Les six contrariétés (liù fǎn
六反) qui
désignent six types de personnages loués pour leur talent, leur
sagesse, leur érudition, leur éloquence, leur courage et leur
honneur, mais qui sont en fait tout le contraire, des
hypocrites, stupides et trompeurs, qu’il s’agit de démasquer ;
- chap. 47 :
Les huit fausses apparences (bā shuō八說)
et chap. 48 : Les huit canons (bā jīng
八經),
- chap. 49 :
Les « cinq vermines » (wǔ dù五蠹)
à éliminer, comme « les quatre nuisibles » (sì hài
四害) ou
les « cinq catégories noires » (hēi wǔ lèi
黑五类) de
l’ère maoïste.
« L’art de la
guerre » n’est pas en reste : il donne (chap. 3) « trois raisons
pour lesquelles un souverain devrait s’inquiéter pour son
armée » (故君之所以患于军者三)
et « cinq facteurs pour prédire la victoire » (故知胜有五),
(chap. 11) « neuf sortes de terrains » (九地)
pour un combat, etc. En fait, tous les traités militaires et
politiques de la Chine ancienne procèdent de même, les chiffres
ayant pour eux de susciter la curiosité et d’inciter à
rechercher ce qu’ils cachent, et révèlent à la fois.
La période
maoïste a poursuivi l’extermination des « vermines », dans la
droite ligne du Han Fei Zi : « Que cent fleurs
s’épanouissent » (百花齐放)
en 1956, campagne suivie d’une répression menée selon des quotas
arbitrairement fixés par Mao, mais devenant ainsi normes
absolues, « Exterminer les quatre nuisibles
»
(Chú sì hài 除四害),
en 1958, au début du Grand Bond en avant, « Détruire les quatre
vieilleries » (破四旧)
en 1966, au début de la Révolution culturelle, etc. Chaque fois,
les normes deviennent obligation morale aussi bien que pratique,
la réalité devant se calquer sur les chiffres proclamés et non
plus l’inverse, créant un monde fictif qui est une véritable
dictatures des nombres.
| |
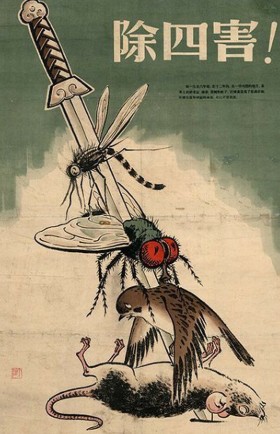
Chú sì hài
除四害,
poster 1958 |
|
On
pourrait de même dresser un tableau synthétisant par leurs
slogans chiffrés les politiques des dirigeants chinois de l’ère
post-maoïste, à partir de Hua Guofeng (华国锋)
proclamant en février 1977 vouloir suivre les « Deux sans
exception » (Liǎng gè fán shì
两个凡是) :
les décisions de Mao et ses directives. Deng Xiaoping a ensuite
proposé des slogans plus classiques, en quatre caractères :
« émancipez vos esprits, recherchez la réalité dans les faits »
(解放思想,
实事求是),
« s’enrichir est glorieux » (zhìfù guāngróng致富光荣),
mais il a quand même forgé le concept des « Quatre
modernisations » (sìgè xiàndàihuà
四个现代化)
et celui de « Un pays, deux systèmes » (yī guó liǎng zhì
一国两制)
appliqué à Hong Kong à partir de 1997… jusqu’en 2020.
| |

Luttez
d’arrache-pied pour réaliser les « Quatre
modernisations »
为实现“四个现代化”而努力奋斗
(Affiche de septembre 1978, coll. Landsberger) |
|
Jiang Zemin (江泽民)
a poursuivi en 2000 avec « Les trois représentent » (sāngè
dàibiǎo
三个代表),
développé dans son discours de 2002 pour le 80e
anniversaire de la fondation du Parti. Hu Jintao (胡锦涛)
a lancé en 2005 le concept de « société harmonieuse » (和谐社会),
mais il l’a complété en 2007 par « Les trois suprêmes » (sāngè
zhìshàng
三个至上)
pour contrôler le domaine judiciaire (les juges doivent toujours
considérer comme « suprême » la cause du Parti, l’intérêt du
peuple ainsi que la loi constitutionnelle) et en 2012 par « Les
deux voies à ne pas prendre » (两个不走) :
la vieille voie de l’enfermement et de la rigidité, et la voie
mauvaise des changements d’allégeance. Il restait à Xi Jinping à
reprendre l’idée de « cinq mille ans de civilisation chinoise »
(中华文明五千年)
et faire miroiter « le rêve chinois » (中国梦),
qui est en train de se fracasser… sur les chiffres de l’économie
et de l’emploi : la réalité refuse de se plier à ce qui reste un
rêve, et la synthèse des nombres comme emblèmes symboliques et
comme éléments de maîtrise quantifiée du réel reste de l’ordre
de l’imaginaire.
Reste la loi (fǎ
法)
comme outil de pouvoir, avec tout ce que le terme comporte
d’ambiguïtés.
3/ Le
gouvernement par la loi et ses limitations en Chine
Les Légistes
rejoignent les Confucéens dans la même idée de la nécessité du
contrôle social, la différence étant que, pour les premiers, ce
contrôle passe par des procédures mécaniques imposées de
l’extérieur, tandis que, pour les seconds, il est assuré par des
rites intériorisés relevant de la tradition ancestrale. Quand on
parle de loi (fǎ
法),
il s’agit à l’époque de code pénal.
La
répression par la loi
Les premières
lois écrites, à l’usage du peuple, sont accueillies par une
véritable fronde de la noblesse : après une première tentative
de codification dans l’État septentrional de Jin (晋),
au 7e siècle avant notre ère, c’est dans le petit
État de Zheng (鄭國/郑国),
au centre de la plaine du nord, au 6e siècle avant
J.C., que le premier ministre Zi Chan (子產/子产)
eut le premier l’idée de faire inscrire les lois sur des
chaudrons de bronze pour les faire connaître du public –
initiative qui déclencha aussitôt une vague de critiques,
prédisant que le peuple s’emparerait des lois pour multiplier
les litiges et tenter d’en tirer profit, et qu’il deviendrait
ainsi ingouvernable.
C’est ce qui
transparaît dans le « Commentaire de Zuo » ou
Zuo Zhuan
(《左传》)
des « Annales
des Printemps et Automnes » (《春秋》).
Dans ce commentaire, c’est le rite (lǐ
禮/礼/)
qui est mis en avant pour assurer l’ordre social
.
Et c’est ce qui est préconisé par le signataire d’une lettre à
Zi Chan restée célèbre, s’élevant contre la publication urbi et
orbi des lois pénales instaurées dans l’État. Elle est citée in
extenso dans le commentaire :
Règne du duc
Zhao (541-510, 6ème année/
《昭公六年》) :
[Dans la 6ème
année], le 3ème mois, l’État de Zheng fit
graver son code pénal [dans le bronze]. Shu Xiang écrivit une
lettre à Zi Chan pour le mettre en garde (三月,郑人铸刑书,叔向使诒子产书曰)
:
« Dans le
passé, les anciens rois passaient des lois après en avoir
discuté et n’imposaient pas de châtiments. Ils craignaient que
le peuple développe un esprit querelleur et soit impossible à
contrôler. […] Ils leur enseignaient la loyauté, les incitaient
à bien faire, leur inspiraient le goût du travail assidu,
s’assuraient qu’ils vivaient dans l’harmonie, les traitaient
avec respect, [mais] les gouvernaient avec force et décidaient
avec fermeté. [Il faut] un souverain sage et loyal, […] qui
règne par la bienveillance et la douceur, pour que le peuple lui
fasse confiance et s’en remette à lui, sinon c’est le chaos. »
La lettre
poursuit en citant les anciennes dynasties : c’est quand la
politique a créé le chaos qu’ont été créés les châtiments, pour
tenter d’y remédier. Et Shu Xiang prédit la fin de l’État de
Zheng, qui sombra effectivement dans le chaos. Mais le modèle
fit aussitôt des émules. Une vingtaine d’années plus tard, en
513 avant notre ère, l’Etat de Jin fait graver dans le métal son
code pénal, le « Livre des Châtiments » (Xíng shū
刑書/
刑书), et
Confucius lui-même s’élève contre cette initiative, en reprenant
les mêmes arguments que ceux avancés par Shu Xiang – dûment
notés aussi dans le « Commentaire de Zuo » (Règne du duc Zhao,
29ème année《昭公二十九年》).
C’est ainsi
que les États des Printemps et Automnes ont peu à peu abandonné
les rites en faveur des lois, et des lois écrites. Au début de
la période des Royaumes combattants, dans l’État de Wei (魏国),
issu de la partition de Jin, est rédigé un « Classique des
lois » (Fǎ jīng
法經/法经)
attribué à Li Kui (李悝),
qui l’aurait compilé à partir de textes de lois de différents
autres États. Ce classique, daté du début du 5e
siècle avant J.C., servit de modèle aux codes ultérieurs et
aurait influencé Shang Yang, puis Han Fei. L’État de Chu (楚国)
ouvrit ensuite une autre brèche : sous le règne du roi Dao (楚悼王),
le général et grand stratège Wu Qi (吳起/吴起)
révoqua les titres de noblesse en appliquant aux nobles le
principe de la solidarité pénale (liánzuò
連坐/连坐),
comme tout le monde. Ce qui valut à Wu Qi d’être mis à mort avec
tout son clan lorsque, lors des funérailles du roi Dao, des
archers tirèrent sur lui mais touchèrent le corps du roi
derrière lequel il s’était protégé : il fut victime de la loi de
solidarité qu’il avait lui-même instaurée, dans ce cas pour
lèse-majesté. Il rejoint la cohorte des ministres légistes
victimes de leurs propres lois.
La
sécurité par la loi ?
Publiée et
diffusée, la loi s’appuie sur des procédures automatiques liées
à l’établissement de normes chiffrées, uniformes sur la totalité
du territoire, entraînant la dépersonnalisation du pouvoir et
celle des relations sociales, loin de l’image du pater
familias dans la cité. La loi devient ainsi un outil dans le
processus de centralisation autoritaire de l’État. Si égalité il
y a en Chine, c’est dans l’application des lois, et ce sous
couvert de lutte contre la délinquance et aujourd’hui le
terrorisme, pour la sécurité de chacun, dans un processus
parallèle de standardisation des modes de vie en milieu urbain.
On est
toujours dans l’objectif d’ « enrichir l’Etat, renforcer
l’armée », mais l’ennemi est devenu tout aussi impersonnel que
le pouvoir. Le système ne peut empêcher les dérives dues à
l’inévitable gabegie humaine, et la recherche de l’intérêt
personnel que cherchait à combattre Han Fei. L’autoritarisme
centralisé est aussi corruption généralisée, entraînant un
cercle vicieux de contrôles et de représailles, la fascination
abstraite pour la loi entraînant une sorte de fétichisme
utopique détournant du réel et de la pratique concrète du
pouvoir ; car celui-ci repose alors sur une administration
tentaculaire favorisant toutes les fraudes et spoliations – y
compris l’usurpation du pouvoir lui-même par les brigands
d’envergure, protégés par le système même visant à assurer la
sécurité du royaume, comme le rapporte – ironiquement – le
Zhuangzi
en
citant, dans le chapitre 10, l’histoire de l’usurpation du trône
de Qi par Tian Chengzi (田成子)
après son assassinat du duc Jian de Qi (齊簡公)
en 481 avant notre ère
.
La précision
minutieuse des lois ne fait qu’aggraver les sentences, mais ne
protège pas contre la fraude, ce qui conduit le Zhuangzi,
dans ce même chapitre 10, à rejeter en bloc tous ces règlements,
contrats et lois afin que, libéré, le peuple retrouve sa
« nature originelle ». C’est un véritable cri de révolte contre
les prétendus « sages » et leurs codes de lois qui ne font en
fait qu’asseoir leur puissance et leur autorité : quand naît un
sage naît en même temps un bandit (圣人生而大盗起).
Mais Zhuang Zi
était un anarchiste. Il n’a pas laissé de modèle de
gouvernement.
Le
retour du confucianisme
D’où le retour
du confucianisme qui, depuis les Han, a permis d’enrober les
procédures légistes d’un semblant de rituel assorti du regard
bienveillant de l’autorité pour les rendre plus acceptables.
Retour du confucianisme dans les années 1980 (en Chine et dans
toute l’Asie du Sud-Est), après plus d’un siècle de mise à
l’écart, puis de tentative radicale d’éradication pendant la
Révolution culturelle. Retour à la tradition, mais revisitée,
car comme le dit le Han Fei Zi, les temps changent et il
faut changer avec eux.
Retour qui a
suscité une floraison de textes et d’ouvrages et a été le thème
des trois premiers cours d’Anne Cheng au Collège de France : « Confucius revisité :
textes anciens, discours nouveaux ».
À lire en
complément
L’ouvrage
magistral de Léon Vandermeersch : La formation du légisme,
recherche sur la constitution d’une philosophie politique
caractéristique de la Chine ancienne, réimpression de
l’EFEO, 2000.
À consulter sur Gallica.
Voir
Le
Traité des rites : canonisation du rituel et
ritualisation de la société (ouvrage
collectif), Maisonneuve et Larose, 2021. Actes du
colloque sur le « Livre des rites » (《禮記》/《礼记》)
qui s’est tenu au Collège de France en juin 2018.
Cette
histoire a donné le chengyu :
“窃钩者诛,窃国者侯”
qiè gōu zhě zhū, qiè guó zhě hóu
Qui
vole un hameçon finit décapité, qui vole un État est
couronné marquis.
|
|

