|
Brève histoire du xiaoshuo,
de la nouvelle au roman
VI. Les romans historiques sous
les Ming
2. Au bord de l’eau (Shuihuzhuan《水浒传》)
2.A Le Shuihuzhuan
et ses sources historiques
2.B Les
différentes versions du roman
2.C
Le roman et sa postérité
2.D Les cartes à jouer du Shuihuzhuan
illustrées par Chen Hongshou
par Brigitte
Duzan, 11 juillet 2025
La première
édition du Shuihuzhuan date de 1368, c’est-à-dire du tout
début de la dynastie des Ming, mais ce n’est qu’une
« cristallisation des épisodes » par écrit
,
les origines en sont bien plus lointaines : roman éminemment
populaire, il a été élaboré à partir de récits relevant de la
tradition orale des conteurs, formant peu à peu à partir des
Song un corpus de cycles narratifs dont les héros sont devenus
légendaires dès la fin des Song du Sud (voir
Au bord de l’eau 2.A. Le
Shuihuzhuan et ses sources historiques).
| |
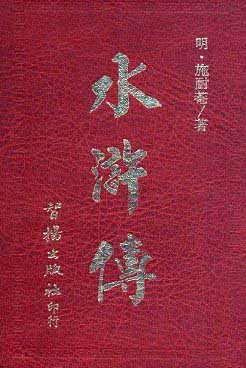
Le
Shuihuzhuan de Shi Nai’an |
|
Fidèle en
quelque sorte à ses origines, le roman n’a pas de version
« consacrée » ni d’édition définitive. Il en existe plusieurs
versions, qui vont d’une version courte en 70 chapitres et un
prologue à une version longue en 120 chapitres. Le plus ancien
récit des aventures de Song Jiang et de sa bande remonte aux
débuts de la dynastie des Yuan, mais les prémices de l’histoire
se trouvaient déjà dans des ouvrages antérieurs datant des Song
du Sud, au 13e siècle.
Ouvrages
précurseurs
- Des traces
de l’histoire se trouvent dans les « Propos d’un vieil ivrogne »
(Zuiweng tanlu
《醉翁谈录》)
de Luo Ye (罗烨),
en dix volumes, ouvrage dans lequel sont rassemblés des récits,
chansons et poèmes divers, en commençant par une introduction
qui les divise en huit doubles catégories selon leurs thèmes.
- L’« Éloge de
Song Jiang et de ses trente-six compagnons plus une préface » (Song
Jiang san shi liu zan yu xu
《宋江三十六赞并序》)
de Gong Shengyu (龚圣与)
donne un résumé de ce qui était déjà, à son époque (à la fin de
la dynastie des Song, au 13e siècle), un ensemble de
récits qui circulaient dans le peuple comme Gong Shengyu le dit
dans sa préface : « On peut entendre dans les quartiers
populaires des histoires relatives à Song Jiang, mais elles ne
sont pas dignes de fournir matière à un livre, bien qu’il se
trouve des hommes… pour les écrire. »
- L’ouvrage de
Gong Shengyu est cité dans la quatrième partie (《续集上》)
d’un recueil de notes « au fil du pinceau » (biji
笔记)
de Zhou Mi (周密)
datant du 13e siècle : « Notes diverses de l’année
guixin » (Guixin za shi《癸辛雜識》)
– Zhou Mi qui était spécialiste des conteurs… et conteuses des
Song, dont il a publié des récits dans ses « Vieilles histoires
de Wulin » (Wulin Jiushi (《武林旧事》),
en 1290.
- « Faits
négligés de l’ère Xuanhe des Song »
(Da Song Xuanhe yishi《大宋宣和遺事》/《大宋宣和遗事》)
,
daté du début de la période mongole.
| |
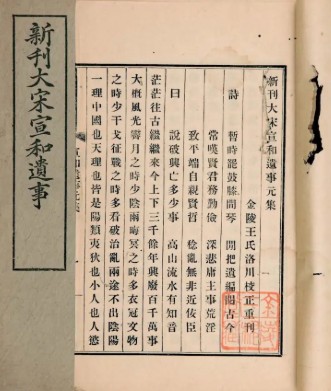
Da Song
Xuanhe yishi
|
|
L’ouvrage, en
dix chapitres, couvre l’histoire des Song des débuts du 11e
siècle jusqu’à l’instauration du régime des Song du Sud en 1127.
Le 4e chapitre traite des aventures de Song Jiang et
de ses compagnons, jusqu’à leur défaite par le général Zhang
Shuye (张叔夜).
Mais l’histoire est située d’abord dans les monts Taihang (太行山)
.
On peut
résumer l’histoire telle qu’elle apparaît dans ce chapitre à
partir des grandes lignes de son sommaire
:
- Douze hommes
sont choisis pour escorter le convoi de Plantes et de Pierres
rares et précieuses destinées à l’aménagement du jardin de
l’empereur. Au moment de partir, ils se jurent fraternité et
font serment de se prêter secours en cas de danger. On trouve là
les premiers membres de la « confrérie » de Song Jiang. L’un
d’eux, Yang Zhi (杨志),
reste en arrière pour attendre un autre, Sun Li (孙立),
qui n’arrive pas. Il est bloqué par une forte chute de neige.
- Yang Zhi
ainsi bloqué se retrouve bientôt dans le besoin et réduit à
vendre son précieux sabre pour assurer sa subsistance. Il tombe
sur un jeune voyou qui tente de l’escroquer et il le tue. Sur
quoi, il est jeté en prison, chargé de la cangue, condamné à
être marqué au visage (tatoué comme un criminel) et exilé à
Weizhou.
- En chemin,
il tombe sur Sun Li qui part vite prévenir les autres. Ils
piègent et tuent l’escorte de Yang Zhi, le libèrent et partent
se réfugier sur le mont Taihang où ils deviennent des brigands.
- Au même
moment, le grand secrétaire impérial réunit de l’argent et des
joyaux divers pour envoyer le tout à la capitale comme cadeau
d’anniversaire à son beau-père, le grand-maréchal Cai. Chao Gai
(晁盖)
et huit de ses hommes réussit à enivrer l’escorte et à s’emparer
du trésor. [Chao Gai qui sera ensuite le « roi céleste » (晁天王),
père fondateur de la bande de Song Jiang]
- Chao Gai est
recherché, son domaine est investi par la maréchaussée, mais,
prévenu par Song Jiang qui travaille au yamen, il réussit à
s’enfuir. Chao Gai et ses huit hommes vont grossir les rangs des
bandits et s’installent dans les marais du Liangshan.
- Quant à Song
Jiang, il revient à la sous-préfecture reprendre sa charge, mais
il y retrouve son amie Yan Poxi dans les bras d’un autre homme,
et de rage tue les deux amants.
- Pour
échapper aux poursuites, il va se cacher derrière chez lui, dans
le temple de la déesse du Neuvième Ciel. Et là il reçoit un
Écrit céleste portant 36 noms et prénoms, octroyé aux « 36
généraux-tigres afin que Song Jiang soit leur chef et devienne
le champion de la loyauté et de la justice ».
- Song Jiang
part au Liangshan rejoindre Chao Gai, mais il est mort. Il
complète les rangs de sa bande et, avec ses 36 généraux, il
déclenche la révolte. Ils partent piller, incendier et tuer dans
plus de 80 districts en rapportant d’énormes butins.
- Song Jiang
n’oublie pas la grâce qu’il a reçue du Mont sacré de l’Est et va
y faire des offrandes.
- La Cour
publie un décret invitant Song Jiang et sa bande à se rallier.
L’invitation est apportée à Song Jiang par le maréchal Zhang
Shuye. Les 36 compagnons rentrent dans l’obéissance loyale à la
cour. Ils sont envoyés réprimer les bandits de trois provinces,
puis Song Jiang reçoit mission de réduire la rébellion de Fang
La (方臘),
après quoi il est nommé gouverneur militaire.
On a là les
principaux épisodes du roman, mais cela reste un amalgame hâtif
de récits qui avaient sans doute formé à l’époque des cycles
narratifs différents, centrés sur deux zones géographiques
distinctes, que laisse deviner le passage soudain des monts
Taihang aux monts Liang, le symbolisme des monts Taihang en
matière de révoltes populaires ayant été transposé dans celui
des marais du Liangshan, sur fond de réalité historique. Il y a
aussi de grandes différences dans les personnages, ne serait-ce
que dans leur nombre puisqu’il manque les 72 « astres
terrestres », lieutenants des 36 bandits principaux.
Ce sont les
dramaturges du théâtre zaju (杂剧),
sous les Yuan, qui vont alors s’emparer de ce récit, ou de
certains de ses épisodes, avec des ajouts et des interprétations
divergentes. Ces dramaturges étaient des lettrés marginalisés
par le pouvoir mongol, remisés au bas de l’échelle sociale, et
qui se trouvaient par là-même au contact des couches populaires,
écrivant pour elles et dans leur langue, en collaboration avec
les acteurs au sein des guildes. Les aventures des bandits des
Monts-Liang étaient un matériau de choix, mais surtout celles de
héros comme le Tourbillon noir Li Kui (黑旋風李逵)
qui prend dans ces pièces une importance prédominante, alors
qu’il est juste mentionné comme accompagnant Song Jiang au
Liangshan dans les « Faits négligés de l’ère Xuanhe ». En
revanche, le personnage de Song Jiang se présente peu ou prou de
la même manière dans toutes ces pièces.
Le roman tel
qu’on le connaît aujourd’hui est ainsi le résultat d’un
remarquable travail de collecte et d’organisation de tous ces
matériaux épars dont certains provenant de textes, ou cycles
narratifs, disparus.
« Au bord
de l’eau » et ses différentes versions
Partant d’une
version originale en cent épisodes mentionnée par Lu Xun mais
disparue, le Shuihuzhuan se décline en plusieurs versions
dont la différence essentielle tient à la part plus ou moins
importante attribuée aux luttes menées par Song Jian contre les
Liao et divers bandits après son ralliement à l’empereur. Mais
on peut dire que c’est à partir de la version de Shi Na’an et
Luo Guanzhong (施耐庵/罗贯中)
que le texte a été définitivement fixé dans ses grandes lignes,
dans le courant du 14e siècle.
1) La
version de Shi Nai’an et Luo Guanzhong
en cent chapitres
Cette première
version du roman, selon Lu Xun, comporte elle-même deux
variantes dont l’une en 115 chapitres, dite « composée par Luo
Guanzhong de Dongyuan » (“東原羅貫中編輯”/“东原罗贯中编辑”),
version qui, en 1640, fut imprimée avec le « Roman des Trois
Royaumes » sous le titre « Chroniques de personnages héroïques »
(Yingxiong pu《英雄譜》/《英雄谱》).
L’histoire commence avec la libération par erreur des démons, se
poursuit avec les rassemblement des 108 brigands dans le marais
du Liangshan, le ralliement à l’empereur, la pacification des
Liao et des trois révoltes, pour finir avec l’empoisonnement de
Song Jiang. Lu Xun en trouve le style gauche, comme s’il
s’agissait d’une simple ébauche.
Une autre
édition, en 100 chapitres, en serait une édition synthétisée,
portant le même titre : « Au bord de l’eau, [histoires de]
loyauté et de justice » (Zhongyi shuihuzhuan《忠義水滸傳》/《忠义水浒传》).
Celle-ci, publiée pendant l’ère Jiajing (1521-1567) par Guo Xun
(郭勛),
haut fonctionnaires favori de l’empereur, portait la mention
« Écrit par Shi Nai’an de Qiantang et arrangé par Luo
Guanzhong ». Cette édition est perdue, mais il en existe une
version conservée au Japon dans une réimpression du 18e
siècle dont l’exergue a été changée en « Compilé par Shi Nai’an
et remanié par Luo Guanzhong » (“施耐庵集撰,羅貫中纂修”/
“施耐庵集撰,罗贯中纂修”).
On ne sait
trop qui sont exactement les deux auteurs, mais Luo Guanzhong a
vraisemblablement révisé la version établie par Shi Nai’an, et
c’est cette version « Shi-Luo » en 100 chapitres qui est
considérée comme la version d’origine du Shuihuzhuan, qui
a circulé pendant près de deux siècles sans modification après
une réédition en 1589.
| |
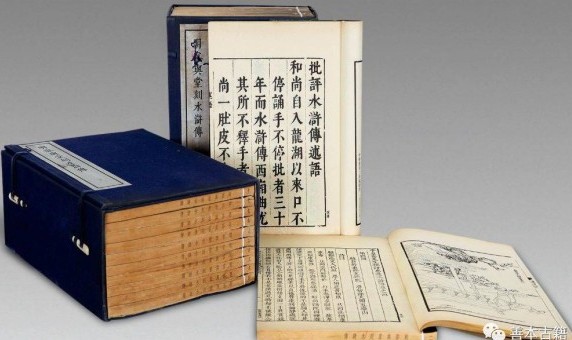
Zhongyi shuihuzhuan
(édition illustrée) |
|
Cette étape de
création est marquée par « une idéalisation accrue des
motivations de la bande des marais des Monts-Liang ». C’est
cette véritable mission morale dont Song Jiang se fait le
porte-parole qui est la grande innovation par rapport aux textes
antérieurs dans lesquels les brigands n’étaient au fond que de
simples malfaiteurs. Les brigands sont élevés au rang de héros
chargés de « faire justice au nom du Ciel » (替天行道),
avec pour devise les deux caractères inscrits sur leurs
bannières : zhōng yì (忠义/義),
c’est-à-dire « Loyauté et justice ».
Cette
innovation essentielle contribue à la cohésion du roman en lui
donnant une logique interne : c’est celle qui préside à la
réunion progressive des 108 héros, et parfois, pour les
derniers, à leur intégration au sein de la bande grâce à des
stratagèmes pas toujours très honnêtes. Cette cohésion se
manifeste aussi bien dans l’art narratif, la formidable
individualisation des personnages, et dans la construction de
l’ensemble, dont la narration est parfaitement bouclée à la fin.
Les petits préambules et beaucoup de poèmes, relevant de l’art
des conteurs et de la chantefable, qui distrayaient l’attention
du lecteur ont été en outre supprimés.
En revanche,
Guo Xun a incorporé un passage avant la répression de la révolte
de Fang La : la campagne contre les Liao qui, historiquement,
n’a eu lieu qu’après. Cela ajoute un élément peu crédible car
Song Jiang ne souffre d’aucune perte parmi ses hommes, alors
qu’ensuite ses rangs sont décimés et qu’ils sont très peu à
revenir à la capitale. C’est ce genre de modification qui va
modifier la teneur du texte après la fin des Ming, phénomène que
R. G. Irwin a qualifié d’ « amplifications de l’histoire », mais
accompagnées de réductions du texte.
2) La
version en 120 chapitres de Li Zhi
C’est un
éditeur du Fujian qui commence à altérer le texte, à la fin du
16e siècle. Pour le vendre plus facilement, il
abrège, ajoute des interventions surnaturelles, de nouvelles
interpolations auxquelles il donne un caractère inédit, celles
des campagnes contre les deux autres bandits, Tian Hu (田虎)
et Wang Qing (王庆),
et surtout des illustrations.
C’est à partir
de cette version en 110 chapitres que paraît au début du 17e
siècle une version en 120 chapitres avec les
interpolations ajoutées précédemment, mais avec des corrections
stylistiques. Et cette version est due à un original, Li Zhi (李贄),
qui démissionna de ses charges officielles en 1581 pour se
consacrer à la rédaction de ses ouvrages mais aussi à l’étude du
bouddhisme. Il finira par se suicider en prison pour idées
subversives en 1602. C’est après sa mort, en 1614, qu’un de ses
amis publie sa version qui est la plus longue du roman, en 120
chapitres, intitulée, en reprenant le titre antérieur mais en en
soulignant le caractère intégral, « Histoires de loyauté et de
justice des Bords de l’eau, livre complet » (《忠義水滸全書》/
《忠义水浒全书》).
Li Zhi a conservé la totalité des épisodes concernant les
campagnes contre les Liao et contre les deux bandits Tian Hu et
Wan Qing, avant celle contre Fang La. Mais cette version de Li
Zhi réintroduit en outre les passages versifiés que Guo Xun
avait supprimés, et elle est enrichie de soixante illustrations
pleine page.
| |
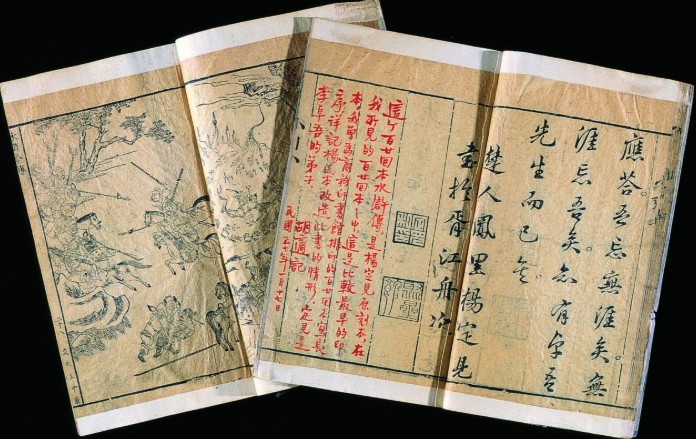
La
version longue, en 120 chapitres, illustrée |
|
3) La
version en 70 chapitres et un prologue de Jin Shengtan
La version
longtemps la plus connue est celle de Jin Shengtan (金聖嘆/金圣叹),
achevée en 1641. Jin Shengtan était un lettré né à Suzhou en
1608 (ou 1610), à la fin des Ming, et témoin des années
chaotiques des débuts de la dynastie des Qing. Il ne semble pas
avoir accepté de fonction officielle au début du régime
mandchou, préférant se retirer à la campagne et vivre une vie
paisible comme il la dépeint dans l’une des préfaces au
Shuihuzhuan.
Il devait cependant avoir quelques ennemis dans les milieux
autour de l’empereur. En 1661, il se joignit à d’autres lettrés
pour protester contre les brutalités d’un magistrat collecteur
d’impôts notoirement corrompu ; il fut condamné à mort et
exécuté avec ses dix-sept co-inculpés – histoire qui pourrait
très bien constituer un épisode du « Bord de l’eau » . C’est
après sa mort qu’un cousin fit éditer ses œuvres : deux
anthologies et des commentaires.
Résolument
anticonformiste, il a établi une liste de « Six œuvres de
génie » (六才子书)
où il mêle des œuvres en langue classique – le
Zhuangzi
(《庄子》),
le Li Sao (《离骚》)
de Qu Yuan (屈原),
les « Mémoires
historiques » (Shiji《史记》)
de Sima Qian (司马迁),
les poèmes de Du Fu (杜甫)
– et des œuvres populaires en langue vulgaire généralement
décriées par les lettrés – l’ « Histoire du pavillon de
l’Ouest » (Xixiang ji《西厢记》),
pièce de théâtre zaju de Wang Shifu (王实甫),
et… le Shuihuzhuan qu’il place en cinquième position.
Mais la version qu’il en a laissée est une version tronquée : de
la version originale Shi-Luo il a supprimé tous les chapitres
qui relatent l’amnistie de Song Jiang et de ses compagnons et
leur lutte ultérieure contre les Liao et les bandits. Sa version
s’arrête brutalement au moment où les 108 camarades sont au
complet et célèbrent leur réunion. Il n’est pas question de
pardon ni d’amnistie. Jin Shengtan a ajouté un chapitre final
(en faisant du premier chapitre un prologue) qui rapporte un
rêve de Lu Junyi (卢俊义),
bras droit de Song Jiang, annonçant l’exécution de toute la
bande.
| |
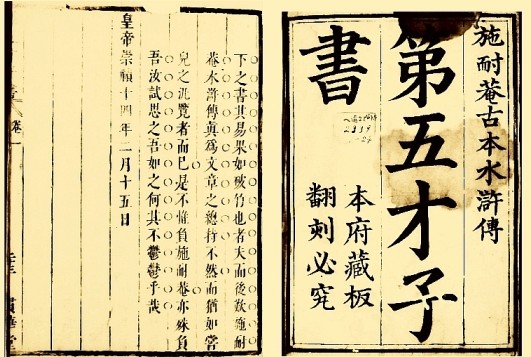
Le
Shuihuzhuan, cinquième des œuvres de génie
|
|
Il en a publié
en 1644 une édition de son roman assortie de commentaires. Il
prétendait avoir trouvé une édition ancienne ne comportant que
les chapitres 1 à 71, et que c’étaient là, selon lui, les seuls
authentiques ; on n’a évidemment jamais trouvé cette édition. La
suppression de la fin du roman changeait profondément la
signification de l’œuvre et répondait à une intime conviction de
Jin Shengtan, dictée sans doute par les circonstances
historiques, la Chine du début du 17e siècle étant la
proie de bandes de brigands et de rebelles comme Li Zicheng (李自成)
qui contribua à la chute des Ming. C’est sans doute son amertume
de voir le pays sombrer ainsi qui lui a fait adopter le
pseudonyme de Shengtan (圣叹),
tiré des « Analectes » de Confucius : le sage qui soupire.
Dans son
Shuihuzhuan, il n’est plus question de bandits au grand
cœur, champions de loyauté et de justice, qui ne se sont
réfugiés dans les marais du Liangshan que poussés par la
nécessité, parce qu’ils avaient été victimes de la corruption et
du népotisme des milieux officiels du régime impérial. Les
bandits sont transformés en brigands purs et simples qui ne
méritent que la décapitation. Jin Shengtan a donc supprimé du
titre les caractères
忠义. Ce
qui ne l’empêche pas de professer une immense admiration pour
l’œuvre, mais selon des critères esthétiques, en justifiant son
travail d’un point de vue littéraire, car il a en outre supprimé
des passages versifiés et effectué des corrections stylistiques.
Ses commentaires sur la manière de lire le roman, expliquant
certaines techniques littéraires,
sont toujours aussi intéressants aujourd’hui.
C’est cette
version courte qui a donné la première traduction du roman en
anglais : celle de Pearl Buck, publiée en 1933 sous le titre
« All Men Are Equal ». La première traduction de la version
longue, par Stanley Shapiro, date de 1981, traduction de
référence parue sous le titre « Outlaws of the March ». La
traduction la plus complète est la traduction japonaise
Suikoden, par Komada Shinji, en trois volumes : c’est la
traduction des 120 chapitres, y compris tous les passages en
vers et passages interpolés, et avec en outre tout un appareil
de notes.
La traduction
de Jacques Dars, avec elle aussi tout son appareil de notes et
commentaires, est un autre monument de sinologie.
4) La
traduction en 92 chapitres de Jacques Dars
Comme
l’explique Étiemble dans son avant-propos à l’édition La Pléiade
d’ « Au bord de l’eau », la traduction était à l’origine une
commande qu’il avait passée à Jacques Dars pour sa collection
« Connaissance de l’Orient » chez Gallimard, et il s’agissait à
l’origine de la version en 70 chapitres. Mais, lorsque Jacques
Dars a choisi de restituer la version longue du roman, le coût
en devenait impossible à assumer pour la collection
« Connaissance de l’Orient ». Étiemble l’a alors proposé pour la
collection « La Pléiade ».
Le texte des
70 premiers chapitres est donc celui de Jin Shengtan, qui est
considéré comme très beau littérairement. Pour le reste des 22
chapitres, en l’absence d’une édition critique définitive,
Jacques Dars a utilisé deux éditions longues, éditées en 1961 et
1975, en choisissant les variantes qui lui paraissaient
préférables et en supprimant les passages en vers, comme l’avait
fait Jin Shengtan (mais en gardant les poèmes en fin de
chapitres). Il a aussi décidé de ne pas traduire les passages
reconnus comme étant interpolés : d’abord les chapitres
concernant la campagne contre les Liao, puis ceux concernant les
deux campagnes contre les rébellions de Tian Hu (田虎)
et Wang Qing (王庆),
ne gardant que la campagne contre Fang La (方臘).
Le roman se termine par un épilogue qui raconte la triste fin de
Song Jiang et de ses compagnons qui avaient réussi à survivre
aux derniers combats contre Fang La, victimes des ultimes
règlements de compte des âmes damnées et ministres pourris de
l’entourage de l’empereur.
C’est la seule
traduction des 70 premiers chapitres plus le prologue qui est
éditée dans la collection « Folio », pourtant titrée « Shi
Nai-an. Au bord de l’eau », avec pour sous-titre « Version de
Jin Sheng-tan ».
2.C L’influence ultérieure du roman
Jacques Dars en donne une traduction complète dans l’
introduction à sa traduction du « Bord de l’eau » (La
Pléiade, pp. XC-XCIX).
|

