|
|
Brève histoire du xiaoshuo,
de la nouvelle au roman
VI. Les romans historiques sous
les Ming
2. Au bord de l’eau (Shuihuzhuan《水浒传》)
2.A Le Shuihuzhuan et ses sources
historiques
2.B Les différentes versions du roman
2.C Le roman
et sa postérité
2.D Les cartes à jouer du Shuihuzhuan
illustrées par Chen Hongshou
par Brigitte
Duzan, 5 septembre 2025
Avec le
« Roman des Trois Royaumes » et « Le Rêve dans le pavillon
rouge », « Au bord de l’eau » est le classique le plus connu, le
plus populaire, dans toutes les couches de la population. C’est
une source inépuisable de références, citations et modèles
littéraires, de controverses aussi ; le Shuihuzhuan est
l’un des textes classiques qui a suscité, et continue de
susciter, le plus de passion en Chine, le plus d’adaptations, au
cinéma, à la télévision, au théâtre, en bandes dessinées et jeux
vidéo et autres, mais pas seulement en Chine, car il a essaimé
aussi au Japon ainsi que dans les pays du sud-est asiatique qui
partagent la même culture.
1/ D’un
modèle à l’autre
a) Du
Shuihuzhuan au Jin Ping Mei
La postérité
immédiate et sans doute la plus directe du Shuihuzhuan
est le célèbre roman de la fin des Ming élevé au rang de grand
classique : le Jin Ping Mei (《金瓶梅》),
également en langue vernaculaire.
Dans ce roman, l’une des trois femmes au centre de la narration
n’est autre que Pan Jinlian (潘金蓮),
mais le récit est centré sur son amant, le marchand Ximen Qing (西門慶/西门庆),
arriviste corrompu et débauché, suffisamment riche pour
entretenir six femmes et concubines.
| |
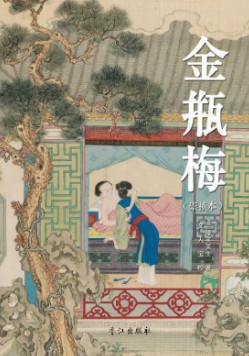
Le
Jin Ping Mei, éd. 2017 |
|
Le roman
commence par une référence directe au Shuihuzhuan, le
premier chapitre étant un rappel de l’épisode où Wu Song (武松)
venge le meurtre de son frère en tuant brutalement son ex-femme
Pan Jinlian qui en est coupable, puis Ximen Qing – ce qui
l’oblige à fuir au Liangshan pour éviter d’être lui-même
condamné et exécuté. Dans le Jin Ping Mei, Ximen Qing ne
meurt qu’à la fin, d’une surdose d’aphrodisiaques que lui a
administrée Pan Jinlian. Tout le roman diffère par ailleurs
trait pour trait du Shuihuzhuan : toute l’histoire tourne
autour des prouesses de Ximen Qing avec ses dix-neuf partenaires
sexuels, femmes, et maîtresses mais aussi un domestique, dans la
tradition des « manches coupées » (duàn xiù
断袖) de
la tradition chinoise.
Le roman va
cependant bien plus loin que les scènes érotiques, avec leurs
descriptions factuelles et euphémismes traditionnels, pour
lesquelles il est célèbre. C’est en fait une condamnation de la
classe dirigeante chinoise, fortunée et dévoyée – Ximen Qing est
un marchand enrichi, ces marchands dont
Han Fei
se
méfiait comme de la peste. En ce sens, on peut considérer le
Jin Ping Mei comme un roman dans la ligne du Shuihuzhuan,
pas seulement pour les emprunts directs, mais comme dénonciation
des abus commis par toute une frange de la haute société. Il
traduit une vision assez noire de la décadence morale de la
société, qui rejoint finalement la pensée de Xun Zi (荀子) selon
laquelle la nature humaine est foncièrement mauvaise et
nécessite une éducation morale pour être « redressée ».
Dans sa
« Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》),
Lu Xun (鲁迅)
l’a classé parmi les célèbres romans de mœurs de la période Ming
(chapitre 19 :
明之人情小說),
ce qu’il appelle « les livres sur la passion du temps » (“世情書”).
C’est le plus célèbre de ceux-ci, dit-il :
初惟鈔本流傳,袁宏道見數卷,即以配《水滸傳》為“外典”(《觴政》),故聲譽頓盛;世又益以《西遊記》,稱三大奇書
Au début,
seules circulaient des versions manuscrites du livre. Yuan
Hongdao (袁宏道)
ayant pris connaissance de plusieurs volumes (juan
卷),
il le classa avec le Shuihuzhuan dans ce qu’il appela les
« classiques non officiels » (“外典”)
[qu’il considérait comme ouvrages de référence]. Il donna ainsi
une grande notoriété au roman ; avec le Shuihuzhuan et le
Xiyouji [Le Voyage en Occident], il fit alors partie des
« Trois livres remarquables ».
Le
Shuihuzhuan est donc devenu la référence en matière de
classiques du temps de Yuan Hongdao, c’est-à-dire l’ère Wanli
des Ming (fin du 16e siècle, début du 17e).
Il faut noter ici que Yuan Hongdao était un ami et disciple de
Li Zhi (李贄),
ce penseur néo-confucéen et bouddhiste non conventionnel avec
lequel il a étudié pendant plus de dix ans ; or, ce Li Zhi est
l’auteur, entre autres, d’une version en 120 chapitres du
Shuihuzhuan
…
b) De la
Chine au Japon, du Shuihuzhuan au Suikoden
o
La
vogue des éditions illustrées dans le Japon du 18e
siècle
La première
édition d’une traduction du roman en japonais (le premier
volume) date de 1757 ; elle a gardé le titre chinois, prononcé
Suikoden en japonais. Cette traduction a été suivie de
celle du philologue Takebe Ayakari, « Le Bord de l’eau
japonais » (Honchô suikoden
本朝水滸傳),
dont la première partie a été publiée en 1773, et la deuxième
seulement en 1959. L’histoire est transposée dans le Japon de
l’ère Nara, et relate la lutte d’Emi No Oshikatsu (le Song Jiang
du roman chinois) pour empêcher le moine Dôkyô d’usurper le
trône impérial. Ce récit ainsi transposé est en outre écrit dans
une langue archaïsante avec divers emprunts aux classiques
japonais qui, reflétant les recherches philologiques de
l’auteur, exercera une profonde influence sur les maîtres du
yomihon (読本).
Ce yomihon,
littéralement « livres de lecture », est un genre de livres
de l’époque d’Edo qui, contrairement aux éditions japonaises de
l’époque, comportaient peu d’illustrations, l’accent étant mis
sur le texte (d’où leur appellation), avec des emprunts
narratifs issus de la littérature historique, chinoise et
japonaise. C’était donc, de manière contradictoire, une
littérature issue de la tradition orale et populaire chinoise,
mais écrite dans une langue de lettrés, peu accessible au commun
des lecteurs.
L’un des
maîtres de ce nouveau genre, Ueda Akinari (上田秋成),
grande figure de la littérature japonaise du 18e
siècle, développera cependant des récits populaires dans le
genre fantastique, à commencer par les « Contes de la pluie et
de la lune » (Ugetsu monogatari
雨月物語)
dont la première édition date de 1776.
Parmi ces neuf contes, on notera entre autres « La lubricité (yín
婬)
du Serpent blanc » (Jasei no In 蛇性の婬),
inspiré de la « Légende
du serpent blanc » (《白蛇传》).
Le
Shuihuzhuan sera même féminisé, en un « Suikoden des
femmes » (Fûzoku Onna Suikoden
風俗女水滸傳)
publié en 1783.
En 1805, le
grand auteur de romans populaires, dont une trentaine de
yomihon, Kyokutei Bakin (曲亭
馬琴)
publie un Suikoden illustré par Hokusai, intitulé
« Nouvelle édition illustrée du Suikoden » (Shinpen
Suikogaden "新編水滸画伝").
C’est l’une des nombreuses adaptations de littérature chinoise
en japonais faites par Bakin, mais cette édition du Suikoden
illustrée par Hokusai lance le mouvement et contribue à la fois
à la notoriété de Bakin et à celle du roman : elle déclenche une
véritable « fièvre du Suikoden ».
Dans ce
contexte, en 1827, l’éditeur Kagaya Kichibei commissionne l’un
des derniers grands maîtres de l’ukiyo’e (浮世絵),
Kuniyoshi Utagawa (歌川
国芳1798-1861), pour
illustrer une nouvelle édition du roman.
Les célèbres
estampes, colorées et comme animées, représentant les 108 héros
du Liangshan contribueront à la popularité des personnages du
roman devenus de véritables héros japonais.
La série sera complétée par des illustrations des femmes du
Fûzoku Onna Suikoden, dans la tradition de l’ukiyo’e,
ces « images d’un monde flottant » portant aussi toute une
symbolique sociale.
| |

Le
Suikoden des femmes, illustration
de
Kuniyoshi, « Ken Shogo »
(Harvard Art Museum) |
|
L’immense
succès des estampes de Kuniyoshi en suscitera d’autres, dont la
série de Tsukioka Yoshitoshi (月岡
芳年)
réalisée en 1866-1867, après la mort de son maître Kuniyoshi :
des illustrations plus sombres, totalement apocryphes, reflétant
l’anarchie et la violence du Japon d’alors, emporté dans
l’effondrement du système féodal, et empruntant des images de
fantômes et de monstres à la littérature fantastique en vogue
par ailleurs. Elles marquent en même temps l’apogée du genre de
l’ukiyo’e.
| |

Yoshitoshi : Yume no Chokichi luttant contre
le
crapaud magique Jiraiya (hors cadre)
de
la série « Beaux et braves héros
du
Suikoden » Biyû Suikoden (1866) |
|
La popularité
du roman, reconfiguré selon l’esprit du temps, s’est encore
développée au 20e siècle avec les adaptations en
mangas et en adaptations télévisées. Mais, à la fin du 19e
siècle, c’est la traduction de la suite du roman initial qui a
trouvé des lecteurs enthousiastes, non seulement au Japon mais
dans le Sud-Est asiatique.
o
Les
héros du Bord de l’eau comme colonisateurs
Il y a en fait deux séquelles au Shuihuzhuan : : celle de
Chen Chen (陳忱/陈忱),
« Au Bord de l’eau, suite » (Shuǐhǔ hòu zhuàn《水滸後傳》/《水浒后传》),
qui date du début des Qing, et celle de Yu Wanchun (俞萬春),
« Chronique de l’élimination des bandits » (Dàng kòu
zhì《蕩寇志》/
《荡寇志》),
publiée sous le règne de l’empereur Daoguang (道光帝
1820-1850), en gros deux siècles plus tard.
| |
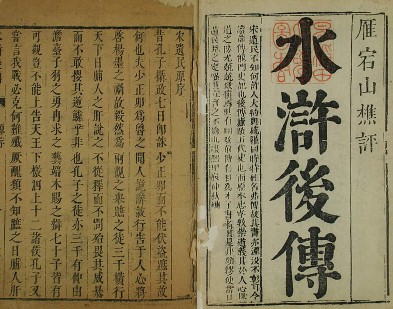
Chen
Chen, Shuǐhǔ hòu zhuàn, éd. 1664
(conservée à l’université Waseda, à Tokyo) |
|
Le roman de
Chen Chen est probablement une suite à la version « écourtée »
en cent chapitres : Song Jiang est mort, les autres rebelles se
sont mis au service de la cour des Song, contre l’envahisseur
Jin. Quant au roman de Yu Wanchun, il s’intitulait d’abord
« Dénouement du ‘Bord de l’eau’ » (Jié Shuǐhǔzhuàn《结水浒传》),
et ce dénouement est radical : pas question que Song Jiang se
rallie à l’empereur, soit amnistié et aille pour lui réprimer la
révolte de Fang La, il est en fait capturé par Zhang Shuye (張叔夜)
– ce qui est conforme à l’histoire officielle selon les Annales.
Dans la
séquelle imaginée par Chen Chen, les héros survivants du
Liangshan sont contraint et forcés par la corruption et la
fourberie de la cour impériale à redevenir des hors-la-loi.
C’était en filigrane dans les derniers chapitres du roman
original. Quand les hordes Jürchen des Jin envahissent l’empire
des Song, ils tentent de s’y opposer, mais ils finissent par se
replier vers le sud et à s’installer dans un pays plus ou moins
mythique dénommé « Siam ». Ce Shuǐhǔ hòu zhuàn, dont une
édition de 1664 est conservée à l’université Waseda, à Tokyo, a
été traduit plusieurs fois en japonais, et en particulier par le
poète Mori Kainan dont la traduction a été publiée entre 1893 et
1895 par la maison d’édition tokyoïte Kōin shinshisha. Cette
nouvelle version fait des rebelles du Liangshan des héros
colonisateurs, se donnant pour noble ambition de transplanter
l’essence de la civilisation chinoise pour la perpétuer en terre
étrangère. On est là dans le contexte de l’ère Meiji (1868-1912)
et des dernières grandes révoltes de samouraïs.
La publication
a été interrompue par la première guerre sino-japonaise (août
1894-avril 1895), et la reprise de la publication a été
accompagnée par un commentaire du traducteur reflétant les
changements de la situation géopolitique. Le « Siam »,
finalement, a perdu sa signification symbolique de refuge contre
la crise dynastique des Song, et été reconfiguré en lieu bien
plus complexe de croisements politiques et culturels. Surtout,
le roman a en outre été traduit en langue thaï, en 1867, imprimé
en 1879 et commercialisé par Dan Beach Bradley qui était
missionnaire protestant américain … au Siam.
2/ D’une
idéologie à l’autre : lecture ambivalente
a) Lu
Xun contre Hu Shi
Lu Xun (鲁迅)
et Hu Shi (胡适)
ont l’un et l’autre consacré beaucoup de temps à étudier en
profondeur le Shuihuzhuan, avec des résultats contrastés
tenant à leur personnalité autant qu’aux perspectives
historiques auxquelles se rattachent leurs recherches :
distinguant la qualité littéraire du contenu idéologique du
roman, Hu Shi l’a célébré comme un représentant de la
littérature « vernaculaire », dans le contexte de la
valorisation de cette littérature dans le cadre du
Mouvement du 4 mai
dont il
a été une figure de proue, mais il en a rejeté les principaux
aspects idéologiques ; Lu Xun, pour sa part, en a souligné
l’esprit révolutionnaire, son écriture « partant du cœur », mais
en a critiqué la composition et les caractéristiques
« féodales ».
o
Hu
Shi : défense de la langue, méfiance à l’égard des rébellions
Hu Shi avait
commencé sa carrière en écrivant pour le journal « La Jeunesse »
(ou Nouvelle Jeunesse Xīn qīngnián《新青年》)
fondé en septembre 1915 par Chen Duxiu (陈独秀).
C’est dans ce journal que, en janvier 1917, il fait paraître
l’article « Suggestions pour une réforme de la littérature » (《文学改良刍议》) :
véritable manifeste destiné à promouvoir l’utilisation par les
écrivains de la langue vernaculaire (baihua
白话) en
lieu et place du chinois classique. C’est un changement de
langue qui implique l’abandon des traditions lettrées (la
« tyrannie des classiques » selon les termes de John Fairbank)
pour favoriser le développement d’une littérature populaire dans
laquelle s’inscrit, justement, le Shuihuzhuan.
Hu Shi,
cependant, était opposé à la violence et voyait dans l’histoire
des Ming et des Qing les dégâts provoqués par les rébellions
paysannes. Il était favorable au réformisme plutôt qu’à la
révolution, en faveur d’une réforme libérale, constitutionnelle
et légale pour transformer la société. On l’a taxé de
« réformiste bourgeois ».
o
Lu
Xun : défense de l’esprit révolutionnaire et influence sur les
romans de wuxia
Lu Xun, pour
sa part, a écrit de nombreux articles sur le Shuihuzhuan,
et lui a consacré tout un chapitre de sa « Brève histoire du
roman chinois » (zhōngguó xiǎoshuō shǐluè《中国小说史略》),
parue en 1930 et compilée à partir de ses cours à l’université
de Pékin. C’est le chapitre 15 (La tradition des récits
historiques sous les Yuan et les Ming II
元明傳來之講史(下))
qui suit celui consacré aux « Trois Royaumes ». Il en parcourt
les origines, à partir des Song du Sud, et les différentes
versions et éditions, où il voit une évolution s’adaptant aux
goûts du public et à l’époque, citant d’ailleurs Hu Shi pour
justifier les coupes opérées par Jin Shengtan (金聖嘆/金圣叹),
sous les Qing : « Jin Shengtan vivait à une époque où le
banditisme était courant ;
il avait encore sous les yeux les méfaits provoqués par les
brigands comme Zhang Xianzhong (张献忠)
et Li Zicheng (李自成),
il ne pensait pas que les hors-la-loi fussent dignes d’être
célébrés, mais qu’il fallait au contraire les combattre. » Ces
deux « bandits » ont en effet contribué à la chute des Ming.
Sous les Qing se sont multipliés les ouvrages « postérieurs » où
sont mises en avant la soumission des bandits à la cour des Song
et la pacification des révoltes effectuée pour le compte de
l’empereur.
Lu Xun
rattache au Shuihuzhuan les récits, sous les Qing, « des
glorieux héros de la dynastie des Ming », mais aussi de toutes
les révoltes et actes de rébellion, comme celle de Tang Sai’er (唐赛儿),
rebelle de la secte du Lotus blanc (白莲教)
en 1420, dont il cite « L’histoire officieuse d’une immortelle »
(《女仙外史》),
datant du début du 18e siècle et attribuée à un
certain Lü Xiong (吕熊).
Cette Tang Sai’er, alias « Àme de pierre » (石头魂),
est un personnage d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’une
émule féminine de Song Jiang (宋江) :
comme lui, elle aurait reçu un livre céleste de la divinité
(taoïste) Jiutian Xuannü (九天玄女)
qui l’aurait aidée et sauvée dans les périodes les plus
critiques, de même qu’elle intervient au chapitre XLII du
Shuihuzhuan pour venir en aide à Song Jiang. Cette divinité
aurait été la préceptrice de l’empereur Jaune (Huangdi
黃帝) et
l’aurait aidé dans sa lutte contre Chiyou (蚩尤),
d’où son association à l’art de la guerre, art martial recourant
à la magie.
| |
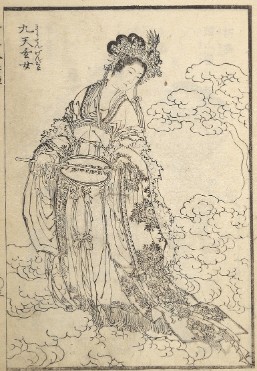
Jiutian Xuannü, illustration d’une édition
japonaise de 1829 du
Shuihuzhuan |
|
Tang Sai’er
apparaît dans l’histoire officielle où elle est en général
qualifiée de sorcière et entourée d’une aura maléfique. Dans le
livre de Lü Xiong, au contraire, elle est présentée comme une
réincarnation de la divinité de la lune, Chang’e (嫦娥).
Comme le souligne l’auteur dans son autobiographie, l’ouvrage
est en fait une dénonciation de l’usurpation du trône, à la mort
de l’empereur Taizu, par le prince Zhudi (明朱棣),
mais il se présente comme un roman de
wuxia
(武侠小说)
avec les éléments de fantastique liés à ce genre. À la fin du
livre, Tang Sai’er met fin à sa rébellion, démantèle ses troupes
et « la paix revient sous le ciel », comme à la fin de la
révolte des bandits du Liangshan.
Dans sa
« Brève histoire », Lu Xun note encore l’influence du
Shuihuzhuan sur les romans de wuxia de la dynastie
des Qing (chapitre 27 : « Les romans de chevalerie et d’enquêtes
de la dynastie des Qing » Qīng zhī xiáyì xiǎoshuō jí
gōng'àn 清之俠義小說及公案).
C’est le cas des « Cinq justiciers et trois redresseurs de
torts » (Sanxia wuyi
《三俠五義》/《三侠五义》)
paru en 1879, qui a inspiré un genre en soi, des « Cinq jeunes
justiciers » (Xiao wuyi《小五義》)
et aux « Sept justiciers et cinq redresseurs de torts » (Qixia
wuyi《七俠五義》) qui
croisent tradition du wuxia et tradition du
Shuihuzhuan ; les redresseurs de tort ont même leurs propres
sobriquets, comme dans le Shuihuzhuan : Renard noir,
petit Zhuge Liang, etc. Mais tous ces romans relatent les
prouesses de braves redresseurs de torts se déplaçant de ville
en ville pour y ramener la paix et la prospérité en chassant les
tyrans locaux, remplaçant l’esprit de rébellion par la
générosité et la droiture, dans des actions conformes aux vertus
traditionnelles de loyauté et de justice (忠義/义).
L’accent est mis sur le soutien à la morale et à l’empereur.
Lu Xun, comme
Hu Shi, a également porté une attention particulière aux deux
séquelles du roman original dans lesquelles le récit se poursuit
après la mort de Song Jiang, dans le contexte des événements de
la dynastie des Qing : on voit donc la narration de Shi Nai’an
et Luo Guanzhong infléchie et reconfigurée selon un thème
central qui n’est plus celui de bandits d’honneur devenus tels
par la force des choses et les injustices commises à leur égard
par une bande de ministres félon, mais celui de la figure
emblématique de l’empereur, avec la nécessité de lutter contre
les révoltes paysannes qui menacent l’intégrité de l’empire
comme elles ont contribué à la chute des Ming.
Cette
ambiguïté fondamentale sur la manière de lire et de comprendre
le Shuihuzhuan se retrouve dans toutes les analyses et
critiques ultérieures, au-delà de l’aspect purement littéraire.
b) Les
ambivalences de Mao
On retrouve
cette même double vision du roman et des bandits chez Mao
lui-même. Au début, de même que Lu Xun et les auteurs de la
mouvance de la Ligue de gauche, il considère les bandits du
Liangshan comme un modèle de force révolutionnaire en lutte
contre la féodalité et l’oppression de classe, contre
l’exploitation dont ils sont victimes et qui ne peut être
renversée que par la subversion. Dans ce contexte, les bandits
du Liangshan peuvent affirmer agir au nom du ciel, comme le fait
Song Jiang. Ce sont des héros des classes opprimées et
marginalisées qui justifient l’action révolutionnaire. Mao voit
même dans l’épisode des « Trois attaques contre le manoir des
Zhu » un excellent exemple de matérialisme dialectique.
Cependant,
quand les bandits se rendent et acceptent l’amnistie, Mao les
considèrent comme des « capitulards ». Et le renversement dans
son appréciation du roman intervient à la toute fin de la
Révolution culturelle, quand, affaibli, il tente lui-même de
consolider son pouvoir. On peut suivre les attaques menées
contre le roman à travers les affiches de propagande de l’époque.
| |
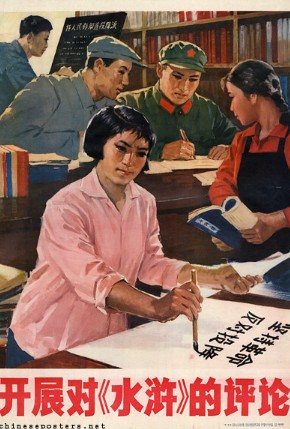
Septembre 1975 : Commencer la critique
de
« Shuihu »
开展对《水浒》的评论 |
|
| |

Novembre 1975 :
Utiliser « Shuihu » comme exemple négatif
pour enseigner
au
peuple à reconnaître les capitulards
利用《水浒》做反面教材使人民都知道投降派 |
|
| |
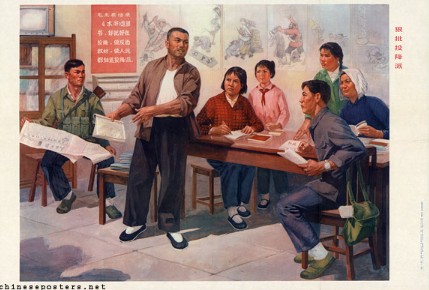
Septembre 1976 : Résolument critiquer
la
clique des capitulards
狠批投降派 |
|
3/ D’un
motif à l’autre : images récurrentes en littérature et au cinéma
a) Le
Jianghu
o
Un
concept ambigu
Le terme
jianghu (江湖),
littéralement les « rivières et lacs », désigne par métonymie
une vaste région lacustre et sauvage en opposition aux régions
« civilisées » dans l’orbite et sous le contrôle de la cour et
de son administration. Le jianghu, dans le Shuihuzhuan,
c’est la zone des marais du Liangshan (Liángshān shuǐbó梁山水泊),
zone marécageuse existant depuis la préhistoire, mais dont la
superficie a été affectée au cours du temps par les errances du
cours du fleuve Jaune. C’est un espace de liberté réputé
inaccessible, refuge idéal pour ceux fuyant les poursuites de la
justice et réduits à se faire bandits, par la force des choses.
Mais le
jianghu n’est donc pas pur banditisme, comme le souligne le
roman à de nombreuses reprises en opposant l’entourage de Song
Jiang aux bandits vivant de vols et de rapines, et qu’il finit
d’ailleurs le plus souvent à gagner à sa cause et attirer dans
son repaire. Le jianghu est un espace social organisé,
structuré et hiérarchisé, avec ses règles et ses codes éthiques,
qui s’oppose à la corruption du pouvoir politique de la cour,
symbolisé par la capitale de l’Est, Kaifeng.
Le terme est
ainsi utilisé dans la littérature chinoise sous cette double
acception, et souvent avec valeur adjectivale : pour désigner un
rebelle à l’ordre établi, relevant de l’esprit du bandit (qiángdào
强盗),
mais aussi de valeureux héros, défenseurs de la justice et des
opprimés (hǎohàn
好汉).
o
Jianghu dans la littérature contemporaine chinoise
« Jianghu »
est devenu un terme courant en littérature et extrêmement
difficile à traduire sans note en bas de page car il peut
recouvrir, justement, des significations totalement différentes,
entre revendication libertaire (souvent pour des artistes) et
même, contrairement aux idées reçues mais avec un clin d’œil
ironique, société organisée selon un mode hiérarchique, comme
dans les assemblées des bandits dans le repaire du Liangshan.
a) On trouve
même les deux sens dans deux récits de
Cao Kou (曹寇)
publiés dans le recueil « Continue à creuser, au bout c'est
l'Amérique » (《挖下去就是美国》) :
- Dans
le premier récit du recueil, « Continue à creuser, au bout c'est
l'Amérique », il est question d’une école bidon d’arts martiaux
dont l’un des adeptes est qualifié, sourire en coin comme de
coutume chez Cao Kou, de « vieil habitué du jianghu » (他…是个“老江湖”,).
- Dans
le troisième récit, « Zhao Qinghe » (《赵清河》),
l’expression est utilisée à propos de femmes qui voyagent en bus
et profitent d’un arrêt pour aller se soulager derrière un
muret tandis que les hommes restent uriner sur le bord de la
route :
没有男人去墙后尿,也没有女人在路边草丛里解决问题,大家似乎早已接到排泄通知,通知上白纸黑字地指明了各自的排泄场所。我不由地想到了一句:人在江湖。
Aucun homme
n’allait derrière le mur, aucune femme ne se soulageait sur le
bord de la route, chacun semblait avoir reçu une note
l’informant noir sur blanc de la réglementation et lui notifiant
la place qui lui revenait dans l’organisation. Une idée m’est
instinctivement venue à l’esprit : c’est le jianghu !
b) Mais le
Jianghu est aussi très vivant dans l’esprit de la jeune
génération. On le retrouve dans le titre du recueil des
premières nouvelles publiées par la jeune
Wang Zhanhei (王占黑),
en octobre 2018 : Jiēdào
jiānghú (《街道江湖》),
que l’on pourrait traduire par « Les bas-fonds des rues et
ruelles » ou « La jungle des ruelles ». Cette jungle urbaine,
c’est l’univers du vieux quartier où vit l’écrivaine, à
Shanghai, au fond d’une ruelle où des personnes âgées promènent
leurs petits-enfants, et où du linge sèche sur les balcons au
milieu de fleurs en pots – des balcons qui ressemblent à celui
de
la novella de Ren Xiaowen (任晓雯).
Cet univers est celui des bandits modernes, les nouveaux héros
de la marginalité urbaine. Des héros qui peuvent aussi bien être
gardiens que caissières de supermarché, ou encore ces livreurs
anonymes qui font désormais partie du paysage des villes
chinoises – souvent des ouvriers d’usine licenciés ou des jeunes
diplômés au chômage. Voilà le jianghu moderne.
| |
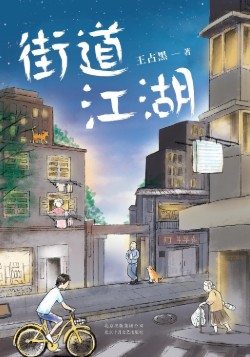
Wang
Zhanhei, Jiedao jianghu,
octobre 2018 |
|
o
Liang Shan Po en Espagne
Dans les
années 1980, des quartiers de villes espagnoles se sont dénommés
Liang Shan Po, appellation qu’ont conservée certains
villages andalous comme le notait encore en juillet 2024 un
article de
l’édition andalouse du Petit Journal.
La dénomination sous-tend les revendications locales comme
symbole de résistance à l’emprise du pouvoir central. Ce qui est
amusant, c’est que le terme est en fait celui apparaissant dans
la série japonaise adaptée du roman, et diffusée en 1978 par la
Televisión Española sous le titre « La frontera azul »
(la frontière bleue). La série était une production de la
Télévision japonaise adaptée de la version japonaise du roman
(le Suikoden) et diffusée à partir d’octobre 1973.
Les
téléspectateurs espagnols ont vu le village de Liang Shan Po
devenu refuge de hors-la-loi luttant contre la tyrannie de
l’empereur et la série a aussitôt eu un immense succès.
Algeciras a illico adopté l’appellation pour le quartier de San
Bernabé pour sa situation à flanc de colline, mais d’autres
villes et villages ont suivi pour des raisons plus politiques,
comme le quartier de pêcheurs d’Estepona à Málaga qui, à la fin
des années 1970, justement, était un lieu de conflits pour la
préservation de ses droits et de la culture locale ; c’est
aujourd’hui une communauté autonome.
b) Les
images pieuses
On trouve une
référence au Shuihuzhuan dans l’une des
nombreuses nouvelles
de
Su Tong (苏童),
« Cavalerie » (《骑兵》),
publiée en août 2004.
| |
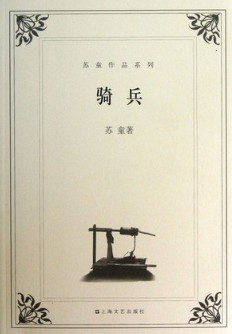
Cavalerie, Su Tong, 2004
|
|
Dans cette
nouvelle, le personnage principal est un enfant qui a les jambes
arquées. Son père est persuadé que l’infirmité de son fils vient
du cheval à bascule qu’il ne quittait jamais quand il était
petit. En grandissant, l’enfant finit par rêver de devenir
soldat, en entrant dans la cavalerie. Pour réaliser tout de
suite son rêve, il essaie de convaincre un camarade de lui
servir de cheval, mais seul un idiot accepte, à une condition :
que l’enfant lui offre sa collection d’images… du Shuihuzhuan.
On apprend
ainsi que c’était dans les années 1970 une collection très
populaire chez les enfants chinois, les images les plus
recherchées étant celles de Lin Chong (林沖),
Lu Zhishen (魯智深)
et Li Kui (李逵).
Elles servaient de monnaie d’échange, pour se « payer » un
protecteur, par exemple, et éviter d’être brimé à l’école.
c) La
fraternité jurée
o
Le
modèle des Trois Royaumes
En même temps,
les bandits du Liangshan, dans le Shuihuzhuan, sont unis
par des liens de « fraternité jurée » (jiéyì
結義/结义)
– littéralement liens de justice et de droiture – dont le
modèle est celui des trois frères jurés Liu Bei (劉備/刘备),
Zhang Fei (張飛/张飞)
et Guan Yu (關羽/关羽),
liés par le « Triple serment du Jardin des Pêchers » (桃园三结义),
dans le chapitre introductif du « Roman des Trois Royaumes » (《三国演义》).
Jin Shengtan
lui-même s’est heurté à l’ambiguïté de cette notion d’ « honneur
juré fraternel » qui était pourtant cruciale pour la
construction et la popularité de l’image du héros dans le
Shuihuzhuan. Leur fraternité est en effet construite selon
un schéma narratif qui implique violence sanguinaire, voire
stratagèmes plus ou moins tordus pour gagner un noble personnage
à sa cause. Les auteurs qui ont écrit des suites au roman ne se
sont pas privés d’élever certains de ces bandits au rang de
martyrs, voire de demi-dieux, dans la tradition populaire de la
divinisation des héros (dont Guan Yu, par exemple, est un
modèle).
o
Le
modèle du héros martial au cinéma
Le
Shuihuzhuan a connu de très nombreuses adaptations au cinéma
et à la télévision, un grand nombre de ces films dans des
productions de la Shaw Brothers à Hong Kong dans la grande
période des films d’arts martiaux, dans les années 1970 et 1980.
Les bandits du
Bord de l’eau ont en particulier directement inspiré le
réalisateur
Chang Cheh (张彻)
quand il a littéralement révolutionné le genre du wuxia à
partir du milieu des années 1960, en mettant l’accent sur les
valeurs masculines et violentes de la tradition héritée du
Shuihuzhuan tandis que
King Hu (胡金铨),
de son côté, préférait continuer à mettre en exergue les
héroïnes martiales remontant aux chuanqi des
Tang. Ainsi
Chang Cheh exalte-t-il les valeurs de fraternité et d’héroïsme
des bandits du Liangshan, avec ses acteurs fétiches face aux
actrices de King Hu, et d’abord Jimmy Wang (Wang Yu
王羽)
qui apparaît pour la première fois dans « The Tiger Boy » (《虎侠歼仇》)
en 1964 ; et même quand, en 1968, Chang Cheh réalise une suite
au grand classique de King Hu « L’hirondelle d’or » (《大醉侠》),
il l’intitule tout simplement « Golden Swallow » (《金燕子》)
comme le titre français, et il reprend l’actrice fétiche de King
Hu qui incarnait l’hirondelle,
Cheng Pei-pei (郑佩佩),
mais c’est le rôle masculin qui a la primeur.
Au début des années 1970, on voit Jimmy Wang céder la place au
duo d’acteurs Ti Lung (狄龙)
/ David Chiang (Chiang Da-wei
姜大卫).
Les femmes disparaissent des films pour laisser la place à la
fraternité masculine, mais aussi à des paroxysmes de violence
dans les vengeances. Ces films culminent en 1972 avec une
adaptation d’un épisode du Shuihuzhuan intitulé « The
Water Margin » (《水浒传》),
comme un dernier hommage avant de passer à un style différent,
mais toujours avec les deux mêmes acteurs, auxquels est joint un
troisième pour parfaire le trio des frères jurés comme dans
« les Trois Royaumes ». On reste dans le même univers de
fraternité jurée.
| |
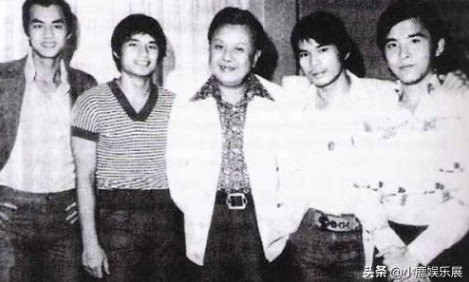
Les acteurs de Chang Cheh autour de
lui : l’esprit du
Shuihuzhuan
Ti Lung et Fu Sheng à g., Chen
Kuan-tai et David Chiang à dr. |
|
Li Han-hsiang (李翰祥)
lui-même tournera un « Tiger Killer » (《武松》),
avec Ti Lung en Wu Song, en 1982. Mais le film a été présenté
comme un « mélodrame conjugal », loin de l’univers masculin de
Chang Cheh et du Shuihuzhuan. Chang Cheh était en fait
très cultivé, fin calligraphe, et il vivait le roman et ses
personnages comme en a témoigné John Woo : « Dès notre
première rencontre je fus très impressionné par l’homme. C’était
un véritable gentleman, toujours très élégant, et surtout un
intellectuel, l’incarnation contemporaine des anciens lettrés
chinois… Le plus frappant, … c’est que sa personnalité
ressemblait à s’y méprendre à celle des personnages de ses
films : un esprit chevaleresque toujours rivé aux notions
d’honneur et de loyauté. »
**
Le repli des
héros du Liangshan à la fin du
Shuihuzhuan pourrait être un autre thème symbolisant
le retrait actuel de beaucoup de jeunes de la société chinoise
et leur marginalisation forcée.
Bibliographie
Bandits in Print, « The Water Margin” and the Transformations of
the Chinese Novel, Scott W. Gregory, Cornell University, 2023.
Table des matières en cinq chapitres,
de l’édition de Guo Xun à celle de Jin Shengtan.
|
|

