|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 15
octobre 2025
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 19 octobre 2025
À la suite de
la
séance de rentrée
du 17 septembre 2025 qui était consacrée au grand classique « Au
bord de l’eau » (Shuihuzhuan
《水浒传》),
cette deuxième séance de l’année
2025-2026
avait pour thème d’autres histoires de bandits, par
Jia Pingwa
(贾平凹) :
- Trois
novellas
de 1990 traduites en français et parues dans un recueil intitulé
« Le porteur de jeunes mariées », trad. Lu Hua, Gao Deku, Zhang
Zhengzhong, Stock, coll. « La bibliothèque cosmopolite »,
1995/1998 :
Le porteur de
jeunes mariées Wǔkuí《五魁》
Le Tout-Blanc
Báilǎng《白朗》
Le géomancien
amoureux Měixuédì
《美穴地》
Avec, en lien,
l’adaptation de « Wǔkuí » par le réalisateur
Huang Jianxin (黄建新) :
« The Wooden Man’s Bride » (《五魁》),
1994.
| |

Bailang
《白朗》,
recueil de 6 novellas,
éd.
2022 |
|
Et en
complément, du même auteur, sur les enlèvements de femmes et le
banditisme moderne, :
-
Broken Wings (Jihua《极花》), trad. Nicky Harman, ACA Publishing, 2019 (Jia
Pingwa 2016).
La séance a
commencé avec en préambule l’annonce de deux événements à venir
en novembre :
- d’une part,
le samedi 8 novembre
à la librairie du Phénix,
la présentation par Brigitte Guilbaud de sa traduction du texte
de
Ye Fu (野夫)
sur sa mère publié en mai 2009 : « « Ma mère emportée par le
fleuve » (《江上的母亲》),
éd. Picquier , oct. 2025.
- d’autre
part, le vendredi 7 novembre à
l’École normale supérieure
(ENS, 45 rue d’Ulm), la première séance du programme
Littérature et cinéma chinois 2025-2026,
séance consacrée au film de 1994 de Wong
Kar-wai (王家卫), « Les
Cendres du temps » (《东邪西毒》).
Le film est inspiré du 3ème roman de
Jing Yong (金庸)
lui-même fortement imprégné de l’atmosphère du
Shuihuzhuan
(《水浒传》),
et même de certains de ses personnages.
Lors de cette
deuxième séance du club, nous avons accueilli une nouvelle
participante, ancienne de l’Inalco passionnée de lecture venue
renforcer les rangs. La séance a été très animée, partagée entre
les rétifs à l’art de Jia Pingwa et les ferventes de l’auteur,
dont celles gardant un souvenir vivace du roman « L’art
perdu des fours anciens » (Gulu《古炉》)
auquel
avait été consacrée la
séance de février 2019
du club
de lecture du temps où il se réunissait encore au Centre
culturel de Chine.
Ø
Giselle,
qui n’avait pu venir, avait envoyé ses notes de lecture par
écrit pour dire tout le plaisir qu’elle avait eu à lire et les
nouvelles et « Jihua », dans sa traduction en anglais.
Les trois
nouvelles
d’abord, où elle a retrouvé les brigands du « Bord de l’eau »,
mais des personnages féminins beaucoup plus sensibles, avec une
nette préférence pour « Le porteur de jeunes mariées », thème
très original en soi. La Montagne, comme dans le roman
classique, est un refuge aussi bien pour les brigands que pour
Wukui et pour la jeune femme, cette dernière ne portant pas de
prénom, c’est elle qui souffre le plus.
Dans la
deuxième nouvelle, elle a retrouvé l’esprit du Bord de l’Eau
avec la citadelle, les batailles autour de l’eau, les marais, la
cruauté des chefs, la femme séductrice, le bonze qui prend les
armes, le thème du tigre, les trahisons… Mais elle a aussi noté
un côté caricatural : comment peut on se trancher soi même la
tête ?
Le Tout- Blanc
est à la fois un héros mais aussi un anti-héros : il est vaincu,
à la merci de son vainqueur, il doit compter sur les femmes pour
s’en sortir et à la fin du roman il est devenu vieux, un
vagabond inconnu qui se fait insulter.
Quant au
géomancien, elle a trouvé le personnage très original, mais là
aussi anti-héros : il trouve des emplacements de sépultures
idéales pour ses clients mais n’est pas capable d’en trouver
pour lui. En outre, c’est l’anti-héros indécis, incapable de se
battre pour la femme qu’il aime. Quand il finit par l’avoir,
elle est défigurée (écho de la première nouvelle où Wukui
obtient la jeune femme quand elle est paralysée).
Elle a noté
que Jia Pingwa apporte des précisions sur la psychologie de ses
personnages, ce qui n’est pas le cas dans « Au bord de l’eau »
où les motivations ne sont indiquées que dans les dialogues. Les
femmes, quant à elles, apportent souffrance et malheur aux
hommes, mais souffrent aussi. Les textes sont teintés d’un
érotisme propre à Jia Pingwa.
Cependant,
bien plus que par les nouvelles, elle a été « emportée » par
« Jihua » (« Broken Wings ») où elle a retrouvé des
échos de « Gulu » (« L’art des fours anciens »)
qu’elle avait adoré quand elle l’avait lu pour la
séance de février 2019
du club
de lecture : la truculence des villageois, leur cruauté mais
aussi leur solidarité lors des catastrophes naturelles.
L’histoire de l’enlèvement lui a rappelé le scandale qui avait
secoué la Chine en 2022 lorsqu’une femme avait été retrouvée, à
demi-folle, attachée comme un chien – la hantise de l’enlèvement
étant toujours une peur latente chez les parents chinois. Elle
garde de sa lecture des souvenirs marquants :
- L’image
ambiguë de la fleur dont la cueillette assure un revenu aux
habitant mais qui épuise les sols (thème écologique).
- Le
choc à la lecture du viol. Les hommes dépeints comme des brutes.
- La
résignation qui s’installe peu à peu chez Butterfly,
pourtant une battante, sa lente adaptation après un refus total.
- Sa
relation avec son fils, qui l’adoucit et produit en elle un peu
de bonheur. Thème éternel de la maternité.
- Très
beau personnage du Grand-père qui incarne le sage auquel on
vient se confier, comme une sorte d’intermédiaire entre le Ciel
et les humains (mage ou devin ?) même si ses paroles ne sont pas
toujours faciles à interpréter. Il semble immortel dans le
roman, même si sa santé se dégrade. Il protège Butterfly.
- Autre
beau personnage, certes un peu fou, la tante, battue par son
mari, mais qui veille sur Butterfly avec ses découpages. Comme
le Grand-père, elle rappelle les personnages hors normes de
Gulu, la grand-mère et ses découpages, et l’enfant qui peut
entendre les animaux parler.
- Thème
astral : Butterfly semble avoir trouvé un apaisement après avoir
compris que les deux étoiles fictives dans le ciel sont en fait
elle et son fils.
- Beau
thème des Mères courages (Brecht) qui se battent, de la Cité
corruptrice (voir Métropolis) C’est la ville qui entraîne les
jeunes garçons et les jeunes filles à quitter le village pour
une vie fantasmée meilleure, mais qui a des répercussions
drastiques sur la natalité dans les villages.
- Butterfly
donne naissance à un garçon, dans la droite ligne du
confucianisme, mais finalement elle contribuent à perpétuer le
problème du manque de femmes dans le village. Il faudra plus
tard trouver une femme à l’enfant. D’ailleurs le destin des
jeunes filles du village est soumis au diktat de la communauté.
Elles doivent rester au village et procréer. Ce qui compte c’est
la survie du village.
- Intérêt
des détails de la vie quotidienne, immuable depuis des siècles
dans les villages. On est loin de la Révolution Culturelle. Les
saisons se suivent, le travail des champs prime sur tout.
- Thème
des communautés rurales oubliées du gouvernement central : les
hommes du village essaient de trouver des solutions à la
dégradation de leur environnement et à l’appauvrissement général
en vendant des oignons rouges, des pommes de terre, des
découpages et des sculptures en pierre. Le marketing et la
distribution entrent au village par ce biais. Mais si les hommes
peuvent en sortir, les femmes en restent prisonnières.
- L’ambiguïté
de la fin : est-elle retournée chez sa mère, l’a-t-elle rêvé, ou
halluciné dans un moment de folie ? Elle est revenue au village
à la fin du livre.
Jia Pingwa
explique que le livre est basé sur une histoire vécue par des
voisins, qui l’a hantée et qu’il a mis dix ans avant de pouvoir
l’écrire. Mais il décrit sans offrir de solutions.
Ø
W.
Lei
a ouvert la séance avec un avis plus critique qu’enthousiaste,
mais ses notes de lecture et commentaires détaillés forment une
entrée en matière où se recoupent divers thèmes qui seront
repris ensuite de diverses manières.
Elle a
commencé sa lecture par « Le
Tout-Blanc », en poursuivant par « Le géomancien amoureux »,
puis « Le porteur de jeunes mariées ». Un choix fait de manière
totalement intuitive, selon les titres, parce que l’adjectif
“bái
白”,
blanc, dans Báilǎng lui a d’abord inspiré une impression
de légèreté et de pureté ; puis, dans Měixuèdì,
l’association entre “ měi
美”
(beauté) et “xué
穴”
(caverne)
,
l’a intriguée par son mystère ; enfin Wǔkuí en dernier,
le “kuí
魁”
signifiant chef (de bandits) mais aussi vigoureux, évoquant
quelque chose de viril et de rude, donc, intuitivement, moins
“beau” à ses yeux que les deux précédents.
| |
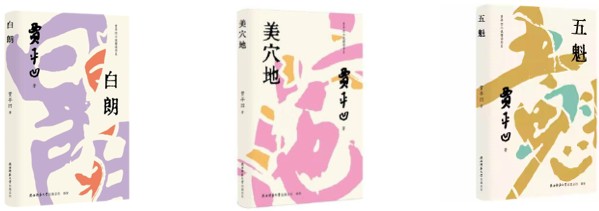 |
|
Dans ces trois
récits, son personnage préféré est Bailang, car il réunit des
contradictions fascinantes : à la fois moine bouddhiste et chef
de bandits, il dégage une aura philosophique. Sa trajectoire, sa
psychologie, son combat intérieur, tout est marqué par ce
contraste saisissant. En revanche, elle a trouvé révoltante
l’histoire du « Géomancien amoureux » : Liu Ziyan (柳子言)
est trop lâche, le patron Yao trop vil, Gou Baidu (苟百都)
trop laid et ignoble, et la Quatrième Concubine terriblement
tragique. Le récit monte en épingle les avares riches
propriétaires et les êtres ignobles des classes inférieures
alors que les gens honnêtes finissent tragiquement détruits.
C’est ce contraste entre la bassesse triomphante et la vertu
broyée qu’elle a trouvé révoltant, mais réaliste.
Cependant,
c’est Wǔkuí qu’elle a trouvé le plus éprouvant : elle
s’est sentie partagée entre l’admiration pour la bonté et la
droiture de Wukui et de la jeune épouse Liu, mais atterrée par
le prix à payer pour cette vertu.
Cette triple
lecture lui a inspiré des réflexions sur plusieurs thèmes
récurrents :
o
Sur les figures féminines
Comme le dit
l’adage chinois : « la beauté est source de malheur » (hóngyán
huòshuǐ 红颜祸水)
.
Les femmes dans ces trois nouvelles sont d’une beauté
exceptionnelle, mais toutes connaissent un destin tragique : la
Quatrième Concubine dans « Le géomancien amoureux », la jeune
épouse Liu dans « Le porteur de jeunes mariées », et l’épouse du
chef des bandits dans « Le Tout-Blanc ». Dans ces mondes
masculins, elles ne sont que des outils, des objets d’échange,
des accessoires de pouvoir. On peut se demander si Jia Pingwa
entend ainsi exprimer sa vision du destin des femmes dans la
société chinoise, ou plus spécifiquement celui des femmes
rurales. Pourtant, ces femmes sont aussi courageuses : la
Quatrième Concubine ose poursuivre l’amour qu’elle désire ; la
jeune Dame Liu tente de s’évader de son sort misérable ; et
l’épouse du chef des bandits, avec sa servante, finit par sauver
Bailang en sacrifiant leur vie.
o
Sur l’amour
Dans ces trois
œuvres, les relations amoureuses sont marquées par une retenue
extrême et se terminent toutes dans la tragédie : ce sont des
amours impossibles, qui excluent de jamais pouvoir posséder.
- Dans
« Le Tout-Blanc », cette retenue est rationnelle : malgré les
avances répétées de l’épouse du chef des bandits, Bailang
résiste, jusqu’à ce qu’il finisse par céder à ses sentiments,
mais c’est alors qu’atteinte de la lèpre elle le repousse de
peur de le contaminer.
- Dans
« Le géomancien amoureux », la retenue est celle de la lâcheté :
Liu Ziyan, paralysé par la peur, laisse passer deux occasions de
sauver sa bien aimée. Il se tait, se retient et s’enfuit. Quand
enfin il agit, il est déjà estropié par la balle de Gou Baidu,
et la femme qu’il voulait sauver est défigurée et souillée.
- Dans
« Le porteur de jeunes mariées », la retenue est tendre : Wukui
croit faire le bien en ramenant la jeune Dame Liu, qu’il a
sauvée des bandits, dans la maison de son mari, pensant qu’elle
y trouvera le bonheur d’une “vie convenable”. Mais cette femme,
enfermée dans un foyer qui l’étouffe, finit brisée corps et âme.
Ce n’est qu’alors que Wukui ose la délivrer, mais un peu trop
tard. Et même dans cet acte d’amour, il ne peut s’empêcher de
décider pour elle, reproduisant la domination masculine dont
elle voulait s’affranchir. Peut-être est-ce cette ultime
dépossession qui la pousse au suicide : elle a compris qu’en ce
monde, elle ne peut choisir de vivre sa propre vie.
o
Sur
le fengshui et les croyances superstitieuses
Dans les trois
nouvelles, la culture du fengshui et des superstitions
populaires est omniprésente.
Dans « Le
géomancien amoureux », il y a des descriptions détaillées du
rituel du tàxué (踏穴),
littéralement le “piétinement des cavités”, rite lié à la
recherche d’un emplacement propice pour une sépulture, dans « Le
Tout-Blanc », le lien entre la tour (ou la pagode) et le destin
de Bailang, ou encore la question du terrain de sel et de son
influence sur la fortune, tout cela témoigne d’une connaissance
très fine de ces croyances. Dans une de ses conférences,
l’auteur a expliqué qu’il avait grandi dans un village où
exerçaient des maîtres de fengshui.
o
Sur
les bandits, le jianghu et les liens avec « Au bord de
l’eau » (Shuihuzhuan)
Qu’il s’agisse
de Bai Lang dans « Le Tout-Blanc », de Gou Baidu dans « Le
géomancien amoureux », ou de Wukui dans « Le porteur de jeunes
mariées », ce sont tous des figures de bandits. De plus, chaque
nouvelle met également en scène un chef de bandits : Tang Jing
dans « Le géomancien amoureux », le chef qui libère la jeune
Dame Liu dans « Le porteur de jeunes mariées », et, bien sûr,
les multiples chefs de bandits de montagne dans « Le
Tout-Blanc », y compris Bailang lui-même.
Cet univers
rappelle fortement celui du Shuihuzhuan : les relations
entre bandits et femmes, les liens fraternels, les scènes de
sauvetage héroïque, tout cela compose une sorte de version
moderne et rurale du jianghu (江湖)
décrit dans le grand roman classique.
D’ailleurs, les trois protagonistes, Bailang, Gou Baidu et
Wukui, quels que soient leurs tempéraments et origines,
deviennent bandits poussés par un destin sans issue, comme ceux
du Liangshan. Mais cela a aussi influé sur sa lecture :
« Ayant
commencé ma lecture par « Le Tout-Blanc », je l’ai comparé
inconsciemment à « Au bord de l’eau ». Le style étant
radicalement différent, les deux premières parties de la
nouvelle ne m’ont pas immédiatement captivée : j’y voyais une
écriture solide, certes, mais sans éclat particulier. Ce n’est
qu’à partir de la troisième partie que j’ai vraiment perçu la
grande maîtrise narrative de l’auteur, notamment lorsqu’il
décrit avec minutie le festin d’accueil que Bailang organise à
son retour : le paysage, l’ambiance, l’état d’esprit des
participants ainsi que les récits racontés. En particulier, les
récits sur ceux qui participent au sauvetage de Bailang révèlent
la richesse et la profondeur de l’art romanesque de Jia
Pingwa ».
o
Sur
les coïncidences entre les trois récits
Au-delà des
similitudes déjà mentionnées, Lei a noté de nombreuses
correspondances entre les trois nouvelles, résultant non tant de
coïncidences que d’un choix délibéré de l’auteur visant à tisser
des liens entre les personnages et les intrigues. Par exemple :
- Dans
« Le porteur de jeunes mariées », la jeune Dame Liu doit servir
un mari impuissant, tout comme la Quatrième Concubine dans « Le
géomancien amoureux ».
- Le
mari Liu, amputé des deux jambes dans « Le porteur de jeunes
mariées », rappelle Liu Ziyan (柳子言),
blessé à la jambe dans « Le géomancien amoureux ».
- Le
chef de bandits s’appelle Tang Jing dans « Le géomancien
amoureux » comme dans « Le porteur de jeunes mariées ».
- Dans
les trois nouvelles, les héroïnes principales ont toutes été
enlevées par des bandits.
- Les
personnages négatifs se ressemblent : Hei Laoqi (黑老七)
dans « Le Tout-Blanc » et Gou Baidu (苟百都)
dans « Le géomancien amoureux » sont tous deux des hommes
grossiers, à la peau sombre, dénués de morale, mais qui ont
connu une gloire passagère.
- Enfin,
le motif de la tour apparaît dans deux récits : la Quatrième
Concubine dans « Le géomancien amoureux » et Bai Lang dans « Le
Tout-Blanc » ont tous deux été enfermés dans une tour isolée du
monde.
[et dans « Bai
Lang », on trouve le motif de la pagode fendue en deux qui
s’effondre à la fin, rappelant la pagode Lei Feng de la
légende du Serpent blanc.]
Ces
similitudes sont si nombreuses qu’elle en est parfois venue à
confondre certains personnages ou épisodes après sa lecture.
o
À
propos des réflexions de Jia Pingwa sur la littérature et la
société chinoise
Dans l’édition
chinoise qu’elle a lue (Shaanxi shifan daxue chubanshe
陝西师范大学出版社,
2024), chaque nouvelle est suivie d’un ou deux textes de Jia
Pingwa : essais littéraires ou transcriptions de conférences.
L’auteur y revient fréquemment sur le destin et l’âme des hommes
dans les œuvres littéraires, sur les problèmes de la société
chinoise contemporaine, ainsi que sur la valeur et les méthodes
de l’écriture littéraire. Ces textes critiques éclairent et
enrichissent la compréhension de son style d’écriture et de ses
pensées. Il explique, par exemple, que le personnage de Bailang
est calqué sur un homme qui a vraiment existé.
[C’est un
double trait caractéristique de Jia Pingwa : son inspiration de
faits et de personnages réels, et les explications données sur
son œuvre. Il a commencé par écrire des nouvelles, son premier
recueil datant de 1977 et son premier succès de 1978 avec la
nouvelle « Pleine lune » (《满月》),
couronnée du prix national de la meilleure nouvelle. C’est à
partir de ce moment-là qu’il prend l’habitude d’ajouter des
préfaces et postfaces à ses récits, pour en indiquer la genèse
et en préciser les modalités d’écriture. Il continue pour ses
romans : le roman « Jihua » (《极花》)
est accompagné d’une postface expliquant que le récit est
inspiré d’une histoire vraie qui lui a été racontée. Ce sont,
effectivement, autant de précieux documents.]
Ø
LLP
revient sur les thèmes récurrents qui l’ont frappée dans les
trois nouvelles car ils en déterminent l’atmosphère, et jusqu’au
fil narratif :
-
les
amours platoniques qui cachent des passions dévorantes, mais
toujours frustrées, toujours refoulées,
- des
anti-héros en marge de la société,
- des
femmes au destin tragique,
- un
érotisme qui tourne carrément à la zoophilie dans trois passages
étonnants,
- un
fond de croyances et de superstitions populaires.
Au-delà du tragique de leur destin, les femmes, en particulier,
ont des traits communs qui se retrouvent d’une nouvelle à
l’autre : elles n’ont pas de nom, ce sont les « épouses de… »,
la « ènième concubine » de…, elles ont les pieds bandés et sont
des objets de désirs, voire de fantasmes sexuels. La violence
est constante, la beauté une véritable malédiction qui attire la
concupiscence masculine et la violence – d’ailleurs combien
d’histoires peut-on lire de femmes qui se sont défigurées pour
échapper à ce sort, voire qui se sont suicidées pour éviter
d’être enlevées et violées dans les pires moments de chaos de
l’histoire chinoise, rébellions, conquêtes, transitions
dynastiques, etc.
Hóngyán
huòshuǐ
红颜祸水,
rappelle Lei… la malédiction de la beauté.
[C’est la
réflexion de Bailang en découvrant que la femme qui vient le
voir dans sa geôle est la « première dame du fort », qui a été
enlevée par Noir le Septième (Hei Laoqi
黑老七),
là encore alors qu’elle allait se marier. Mais il faut préciser
que ce chengyu est normalement utilisé, de manière
caractéristique, dans un sens péjoratif pour les femmes : au
sens où les femmes se servent de leur beauté et de leur charme
pour attirer les hommes et les perdre. Comme d’ailleurs dans le
Shuihuzhuan, où quasiment toutes les femmes sont des
personnages de ce genre.
Quant aux
défigurations et suicides de femmes pour éviter les enlèvements
et viols, là aussi ils sont souvent cités comme des exemples
d’admirable vertu dans la littérature classique, surtout dans
les périodes de retour en force du confucianisme.]
LLP
a elle aussi trouvé de nombreux rapprochements avec le
Shuihuzhuan :
-
le
personnage du bonze-brigand œuvrant pour les pauvres,
-
les
temples en ruine servant de refuge pour les fuyards en butte aux
injustices,
-
les
serments de frères jurés liant les anti-héros des trois récits,
comme sacralisés,
-
outre
le personnage de Bailang qui lui a rappelé celui de Song Jiang.
Et au-delà du
Shuihuzhuan, certains épisodes narratifs lui ont rappelé
des traits récurrents dans la littérature classique : les
attaques de convois de mariage ou les croyances dans la
géomancie pour fonder les pratiques des rituels funéraires, et
en particulier déterminer des emplacements propices pour les
tombes d’une famille - rituels chamaniques qui ont été étudiés
par l’anthropologue Sandrine Chenivesse en lien avec le taoïsme
et les thèmes de la mémoire et de la transmission dans son
ouvrage « La
Forteresse des âmes mortes ».
[ Pour ce qui
est des attaques de convois de jeunes mariées, on pourrait citer
nombre de films, mais surtout le premier film de
Zhang Yimou,
« Le
Sorgho rouge » (《红高粱》),
adapté du « Clan du Sorgho » (《红高粱家族》)
de
Mo Yan -
le film commence par une séquence de ce genre que rappelle celle
du film de
Huang Jianxin (黄建新)
adapté de « Wukui » : « The Wooden Man’s Bride » (《五魁》).]
LLP
a trouvé drôle de retrouver dans « Le porteur de jeunes mariés »
l’histoire de la « princesse au petit pois » qu’adore sa fille,
histoire qui est en fait un
conte d’Andersen.
Mais de
manière générale, elle aurait souvent apprécié d’avoir des notes
en bas de page dans la traduction.
La lecture des
trois nouvelles lui a donné envie de se replonger dans « La
Capitale déchue » (Feidu《废都》)
qu’elle n’avait jamais terminé.
Ø
MRC
revient sur la question des femmes dans l’œuvre de Jia Pingwa :
il dit, sourire en coin, que Jia Pingwa se fait écharper sur les
réseaux sociaux en Chine, et en particulier sur douban, où des
femmes militantes s’emportent contre les « vieux écrivains
macho ». Dont lui : macho donneur de leçon.
Il n’a eu le
temps de lire à fond que « Wukui ». Mais cette lecture
lui a suggéré deux remarques :
-
Il a
d’abord été frappé par la forme narrative et, comme
Giselle, par les nombreuses descriptions psychologiques qui
expliquent le caractère des personnages, leurs actions, leurs
motivations, leurs sentiments à un moment donné de la narration.
[C’est souvent
sous forme de monologue intérieur rappelant Virginia Woolf.
Ainsi lorsque Wukui décide de retrouver la jeune mariée pour la
tirer des griffes des bandits alors que ses frères tentent de
l’en dissuader, il part en courant « en marmonnant » en lui-même
ses raisons d’aller la sauver : « bien sûr ce n’est pas ma
femme… mais je veux qu’elle puisse avoir une vie heureuse chez
les Liu… ne m’a-t-elle pas témoigné une confiance sans borne,
moi, si laid, si pauvre… ne m’a-t-elle pas sauvé d’un coup
d’épée mortel ?... » Suivent ses regrets de ne pas avoir été à
la hauteur, puis la crainte de ne pas faire le poids face aux
bandits… ]
C’est la grande différence avec le
Shuihuzhuan qui ne s’embarrasse pas de psychologie, mais se
concentre sur la description des actions, des évènements, des
combats , une narration animée de conteur captivant son
auditoire, et suscitant ainsi l’émotion comme souligné dans les
commentaires de Jin Shengtan que MRC a cités lors de la
séance précédente :
Du récit
naissent les émotions, des émotions naît le récit
Wén
shēng qíng, qíng shēng wén “文生情,情生文”。
La narration
introspective de Jia Pingwa donne en revanche un sentiment
d’immersion, elle donne de la profondeur aux personnages en
insistant sur les questions d’ordre moral, même si ces
développements ne sont pas toujours très originaux. Ils ont
surtout l’inconvénient de ralentir le rythme de la narration.
-
MRC
a
par ailleurs attendu la chute pendant toute sa lecture en
se demandant comment le récit allait se terminer. Et il a trouvé
que cette chute inattendue donnait de la profondeur au récit en
le replaçant dans une histoire locale à long terme, faisant des
bandits un élément ancré dans la culture et la vie locales.
[Et là on
retrouve l’idée du Shuihuzhuan des bandits malgré eux :
le nom du chef des bandits recherché indiqué sur les affiches et
donné en toute fin, Wukui, montre que l’histoire continue,
qu’elle forme le contexte d’une histoire plus vaste qui se
poursuit dans les autres nouvelles, comme un autre reflet de ce
microcosme social. Jia Pingwa tisse volontairement des liens
entre ses récits pour créer cette symbiose.]
Ø
UB
trouve que Jia Pingwa est un « super écrivain », mais il a été
« horrifié » par ces nouvelles, cette sorte d’obsession
ressentie tout au long de sa lecture, cette frustration
obsessionnelle qui culmine dans le personnage de Bailang. Il n’a
ressenti aucune empathie, même s’il a trouvé un certain humour
dans divers passages.
Il a pourtant
poursuivi par la lecture de « Jihua ». Et il a trouvé le
roman encore « pire ». Pire au sens que Jia Pingwa nous livre là
un récit cauchemardesque qui raconte dans le détail l’enlèvement
d’une femme maintenue prisonnière dans un yaodong,
victime d’un viol quasiment collectif, mais qui finalement se
fait à son sort et qui, une fois revenue chez elle, se retrouve
livrée en pâture à la vindicte publique, dans une situation
tellement infernale qu’elle préfère revenir dans son yaodong.
Malgré tout,
il a quand même été fasciné au point de reprendre la lecture de
« La Capitale déchue » qu’il n’avait jamais terminée, en se
disant que Jia Pingwa est célèbre comme écrivain de la campagne,
et que peut-être sa vision de la ville sauve le reste. Eh bien
non, tout est pire en ville, y compris les superstitions. Il l’a
trouvé tout aussi insoutenable, mais remarquable par une sorte
d’ironie latente. C’est un véritable esclavage mental que décrit
Jia Pingwa, mais exacerbé par cette ironie froide. Ainsi
l’histoire du suicide au pesticide : pesticide pas au point,
dont la femme ne meurt pas, et qui risque de ruiner la
réputation et le commerce de son inventeur… etc.
Finalement,
dit UB, on avait l’impression que Jia Pingwa avait « un
problème », mais en fait c’est la Chine entière qui en a un.
Ceci dit, s’il a pris plaisir à ces lectures, il a de loin
préféré la richesse du
Bailuyuan (《白鹿原》) de
cet autre écrivain du Shaanxi qu’est
Chen Zhongshi (陈忠实).
[roman qui
avait été plébiscité par le club de lecture lors de la
séance du 22 avril 2023]
Ø
Sylvie
et Dorothée,
quant à elles, ont toutes deux gardé un bon souvenir de la
lecture de « L’art
perdu des fours anciens » (《古炉》),
au programme du club
en février 2019,
de même que Giselle qui en est une inconditionnelle,
malgré les quelque 1 200 pages de la traduction française.
Sylvie
avait d’ailleurs lu « Le porteur de jeunes mariées » après « Les
fours anciens » et avait gardé un souvenir très net des
personnages et de l’atmosphère de tragédie. Elle a trouvé que
finalement, dans la première nouvelle, le brigand finissait par
avoir le beau rôle et devenait une sorte de modèle. Le
géomancien était d’ailleurs comme un frère de Wukui, avec la
même attitude envers les femmes, comme Bailang.
Dorothée
a trouvé étonnantes ces trois nouvelles : pour une fois, ce sont
des histoires d’amour, même si ce sont des amours frustrées !
Elle les a lues avec beaucoup de plaisir et d’intérêt, en
faisant des rapprochements avec le Shuihuzhuan :
-
C’est
le célibat qui caractérise les brigands de ce dernier roman, pas
d’amour possible, ni même concevable, chez eux ; ils sont frères
jurés, et ne vivent que pour l’action. Les brigands de Jia
Pingwa ont le même rapport à l’argent et aux richesses que ceux
du « Bord de l’eau » : pas de conflits entre eux, les richesses
sont réparties, sans problèmes d’inégalités de fortune.
-
Elle a
en revanche été frappée par la présence récurrente de l’opium.
L’opium apparaît en fait comme l’équivalent de l’alcool chez les
bandits du Liangshan – on fume une pipe comme on prend un verre,
Il fait partie du contexte local, comme le banditisme. Mais on
n’aurait pas imaginé un bandit toxicomane dans le
Shuihuzhuan ! Dans « Le géomancien amoureux », l’opium est
d’ailleurs expressément lié aux pieds bandés, comme une sorte
d’impureté inacceptable : lorsque Liu Ziyan se présente devant
le riche propriétaire qui l’a fait venir, celui-ci est devant
son plateau d’opium et lui en offre avec un verre d’alcool qu’il
refuse, tout en apercevant sous le rideau de la porte les petits
pieds bandés de sa fille…
[Les pieds
bandés ont longtemps été en Chine un élément de statut social,
que seules les femmes devant travailler dans les champs ne
pouvaient pas se permettre. Ils étaient appréciés par les
lettrés selon les mêmes critères que ceux avec lesquels ils
évaluaient un tableau de shanshui. Le meilleur ouvrage
sur la question reste le roman de Feng
Jicai (冯骥才)
« Le
Lotus d’or de trois pouces » (《三寸金莲》),
véritable docufiction dont il reste incompréhensible qu’il n’ait
jamais été traduit en français.]
-
Dorothée
a aussi été frappée par la réponse donnée au brigand qui veut
partir de la bande : il peut toujours redevenir paysan. Est
ainsi soulignée la profonde unité sociale, le socle commun de la
société chinoise défini comme étant la paysannerie.
Ø
Claire
pour sa part a
privilégié la lecture de « Wukui », en chinois – « Bailang »
lui étant apparu d’une écriture plus difficile. Elle en a adoré
le côté littérature populaire qui lui a rappelé un genre qu’elle
aime beaucoup : les huaben..
[Sortes de de
trames narratives utilisées par les conteurs, les
huaben
(话本)
ont commencé à être imprimés sous les Song en profitant du
développement de la culture urbaine et de l’imprimerie. C’est
d’ailleurs de ces conteurs que se sont inspirés les auteurs du
Shuihuzhuan. ]
La narration
reprend des traits typiques, liés à l’oralité, des huaben,
et en particulier la récurrence de scènes semblables qui se
répètent comme des schémas narratifs sur lesquels pouvaient
broder les conteurs. La chute de la nouvelle est inattendue,
mais en ouvrant sur des questions qui appellent réflexion.
Ø
Laura
s’est concentrée sur la lecture, en chinois, de « Jihua »,
texte difficile dont elle avait eu un premier aperçu lors de ses
études à l’Inalco avec Mme Rabut, car celle-ci avait donné la
première page à traduire comme sujet d’examen.
| |
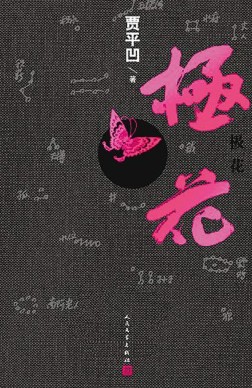
Jihua,
人民文学出版社,
2016 |
|
Inutile de
dire que l’exercice était particulièrement ardu pour qui ne
connaissait pas le terme de yaodong (窑洞)
car le roman commence ainsi, (implicitement) à la première
personne, en ne donnant même pas les deux caractères du terme,
seulement le premier :
那个傍晚 在窑壁上刻了第一白七十八条道二…
« Ce soir-là,
j’ai gravé ma 178e encoche sur le mur du yao(dong). »
La lecture
s’est avérée aussi difficile par la suite, et ce d’autant plus
que l’écriture passe sans transition d’un style à l’autre en
mêlant expressions populaires locales et style soutenu
classique. Elle a demandé l’aide d’un collègue chinois qui a
lui-même des hésitations et doit faire des recherches, y compris
sur l’histoire locale, pour répondre plus précisément à ses
questions.
Il est
fascinant, au-delà du style même, dit Laura, de voir la
dextérité avec laquelle Jia Pingwa dépeint de manière très
vivante, et même visuelle, le village et la vie du village à
partir du regard de la femme enfermée dans le yaodong, et
limitée à l’ouverture exigüe en guise de lucarne qui lui sert à
appréhender le monde autour d’elle. Le texte abonde d’injures,
de gros mots, d’expressions locales qui en font une véritable
vitrine de la culture locale avec ses superstitions et ses
croyances toujours vivaces. Elle trouve Jia Pingwa bien plus
vivant et intéressant que Mo Yan, bien plus divers aussi. Le
texte vire parfois à l’étude anthropologique, mais toujours dans
un étonnant mélange de styles, passant de la violence à des
inflexions humoristiques, et du populaire au classique.
UB
confirme avoir eu la même
impression quant au style
,
dont il a trouvé aussi des avatars dans « La Capitale déchue »
où les monologues de la vache, par exemple, sont utilisés comme
trait narratif récurrent pour scander le récit. Mais tout cela
va avec le sentiment d’étouffement né de l’évidence qui ressort
de « Jihua » comme des autres textes du même auteur :
qu’il est impossible de s’évader d’une société qui n’offre
aucune échappatoire, que ce soit à la ville ou à la campagne.
Il reste à lire
« La capitale déchue » (Feidu《废都》)….
Dans le texte si possible pour mieux l’apprécier. Et là non plus
en lien avec le Shuihuzhuan, mais avec le Hongloumeng…
| |
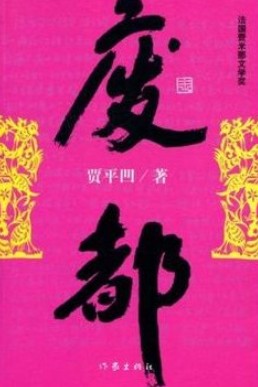
Feidu,
作家出版社,
2009 |
|
Prochaine
séance
Le mercredi
12 novembre 2025
À partir de
cette prochaine séance, nous ferons un détour vers la
littérature de la fin des Qing et des débuts de la période
républicaine, avant de revenir en février à la littérature
contemporaine.
Au programme du
12 novembre :
-
Souvenirs de la chambre de l’ombre du bracelet (《钏影楼回忆录》),
de
Bao Tianxiao (包天笑),
un « roi de la littérature populaire », éd. et trad. Joachim
Boittout, préface de Sebastian Veg, éd. Rue d’Ulm, 2021.
|

