|
|
Brève histoire de la littérature
du Nord-Est : le génie du lieu
par Brigitte
Duzan, 3 août 2025
Depuis les
années 2010, on parle de plus en plus de « littérature du
Nord-Est » (Dongbei wenxue
东北文学),
avec un sens d’identité collective qui n’existe pas, ou pas
autant, dans d’autres régions. On parle même de « renaissance
culturelle du Nord-Est » (Dongbei wenyi fuxing 东北文艺復兴),
expression utilisée pour la première fois en 2019, lors d’un
spectacle, par le rappeur Gem (Dong Baoshi 董宝石).
| |
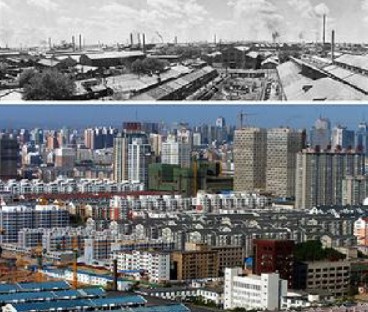
Le
quartier des ouvriers de Shenyang
hier
et aujourd’hui |
|
Si l’on
pouvait parler de renaissance, c’est que la région avait été
sinistrée, à la suite de la politique de réformes drastiques
instaurée par Deng Xiaoping au début des années 1990. Cette
renaissance s’est traduite dans tous les domaines culturels et
artistiques, mais tout particulièrement en littérature
.
Le renouveau littéraire est symbolisé par le trio d’écrivains
Shuang Xuetao (双雪涛),
Ban Yu (班宇)
et
Zheng Zhi (郑执),
baptisés « Les trois mousquetaires de Tiexi » (Tiexi san
jianke铁西三剑客),
ce Tiexi étant le quartier emblématique de Shenyang dont ils
sont originaires, celui-là même filmé par
Wang Bing (王兵)
dans son documentaire de 2003 « À
l’ouest des rails » (《铁西区》).
Témoins
pendant leur jeunesse des fermetures d’usines et des
licenciements massifs dont la génération de leurs pères a été
brutalement victime après avoir été le fleuron de l’industrie
nationale du temps de Mao, les écrivains de la région nés dans
les années 1980 dépeignent dans leurs récits les conséquences
traumatiques de ce désastre économique et social. Il en résulte
toute une littérature, essentiellement constituée de nouvelles
et novellas, dont le style peut être qualifié de
« post-avant-gardiste ». Mais, fermement ancrée dans cette
région spécifique du nord-est, elle est malgré tout
indissociable de la littérature qui l’a précédée, également
marquée par les contingences historiques, et peut-être tout
simplement par l’esprit du lieu, ce genius loci que les
anciens Chinois vénéraient localement sous le nom de tudi
shen (土地神)
ou tudi gong (土地公).
I. Le
contexte historique (19e et 20e siècles)
La
Mandchourie entre Chine, Russie et Japon
Influence
croissante de la Russie…
Au 19e
siècle, le Nord-Est de la Chine qui était jusque-là peuplé de
Mandchous et de quelques autres groupes ethniques non-han
subit une brutale colonisation chinoise, et se sinifia à partir
essentiellement des provinces du Shandong et du Zhili (直隶),
province créée sous les Ming, au 14e siècle, qui
s’étendait grosso modo, pour sa partie nord, sur le territoire
de l’actuelle province du Hebei et fut dissoute en 1928. Pendant
longtemps, comme il était interdit aux femmes de franchir la
Grande Muraille, la population venue s’installer sur les terres
du Nord-Est resta en majeure partie masculine, ce qui favorisa
son assimilation. Au cours du temps, les mode de vie évoluant,
l’administration des Huit Bannières devint obsolète, les
institutions et la culture chinoises se développèrent et la
langue mandchoue disparut peu à peu au profit du chinois.
À la fin du 19e
siècle, cependant, l’influence russe s’accrut sensiblement, la
pression politique exercée sur la Chine par l’Angleterre,
l’Allemagne et le Japon incitant le gouvernement chinoise à
rechercher une alliance avec la Russie. En 1878, toutes les
restrictions à la migration des populations chinoises en
Mandchourie furent supprimées ; puis, en 1896 fut signé un
accord entre la Chine et la Russie pour la construction d’un
chemin de fer transsibérien d’Irkoutsk à Vladivostock, ce qui
entraîna un nouvel essor de la région. La ville de Harbin devint
alors le centre régional de la culture russe. La région devint
une riche zone céréalière, tandis que l’industrie accusait un
certain retard par rapport au reste du pays, le textile et
l’industrie alimentaire étant les principaux secteurs
industriels. Les ouvriers constituaient une faible partie de la
population, et c’étaient surtout des travailleurs saisonniers ou
occasionnels – dont beaucoup de femmes – qui gardaient un lien
avec leur village.
| |

La gare de Harbin vers
1940 : Harbin est
écrit en caractères
russes (Хар бин)
(photo tirée d’un livre japonais sur la Manchourie) |
|
… Puis du
Japon
Cependant, à
la fin du 19e siècle, c’est le Japon qui s’affirme
comme puissance dominante dans toute la région. À l’issue de la
première guerre sino-japonaise, en 1894-1895, le traité de
Shimonoseki (17 avril 1895) consacre la victoire japonaise en
octroyant au Japon la presqu’île du Liaodong, au sud de la
Mandchourie. Mais ce gain territorial doit finalement être
rétrocédé à la Russie qui augmente peu à peu sa présence dans la
région : en 1900, après l’écrasement de la révolte de Boxers,
elle obtient de l’empire chinois un protectorat sur la
Mandchourie et continue de réclamer de nouveaux avantages à la
Chine. Le Japon se lance alors dans un vaste programme
d’armement.
C’est la
question de la Mandchourie qui provoque la guerre de 1904-1905
qui, après une bataille meurtrière en mars 1905 à Mukden
(l’actuelle Shenyang), se conclut par la victoire écrasante du
Japon. Cette victoire (outre la Révolution de 1905 en Russie)
donne un coup de frein à l’expansion russe dans l’Extrême-Orient
sibérien, et dans le Nord-Est chinois : pour ce qui concerne ce
dernier, le traité de Portsmouth accorde au Japon un bail sur la
péninsule du Liaodong, outre le contrôle du chemin de fer de
Mandchourie du sud avec les privilèges que possédait la Russie
dans la région. La Mandchourie était ainsi divisée en deux
sphères d’influence, russe au nord, japonaise au sud ; mais,
durant la Première guerre mondiale, la Russie a été effacée de
la carte régionale par les États-Unis et le Japon.
Après la chute
de l’empire chinois et la fondation de la République de Chine,
de 1912 à 1932, pendant la période dite des Seigneurs de la
guerre, la région est dominée par la faction armée mandchoue
dite Clique du Fengtian (fèngxì jūnfá
奉系军阀),
la province de Fengtian (奉天省)
étant celle de Mukden. Cette « clique » est soutenue par le
Japon, mais elle est vaincue en mai 1928 par les troupes du
Guomingdang à la suite de l’Expédition du nord (běi fá
北伐).
L’invasion
japonaise et le Manchukuo
Le 19
septembre 1931, après « l’incident » de Mukden qui détruit une
partie de la voie ferrée, commence l’invasion japonaise de la
Mandchourie. En mars 1932 est établi l’État fantoche du
Manchukuo (满洲国),
avec à sa tête le dernier empereur de Chine, Puyi (溥仪).
Poursuivant leur politique expansionniste, le Japon déclenche en
1937 la seconde guerre sino-japonaise qui se termine par la
capitulation du Japon en août-septembre 1945.
Cependant,
c’est l’invasion de la Mandchourie par les Soviétiques à partir
du début du mois d’août qui met un terme à l’administration
japonaise sur la région. C’est l’une des plus importantes
opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, tant dans
sa phase de préparation, marquée par le déplacement d’environ un
million d’hommes et des quantités importantes de matériel sur
plus de 9 000 km à travers la Sibérie, que dans sa phase
opérationnelle, le champ de bataille faisant plus de 4 000 km de
large et 800 de profondeur.
Elle se solde par une victoire soviétique contre l'armée
japonaise du Guandong. C’est l’un des principaux évènements qui
ont contribué à pousser à la capitulation japonaise, le 15 août
1945.
La Mandchourie
était alors une région riche. Elle avait une population de 43
millions d’habitants, du charbon et du fer alimentant une
industrie sidérurgique moderne, ainsi que des usines de
caoutchouc synthétique et des arsenaux. Même la nourriture ne
faisait pas défaut : blé, maïs et soja étaient cultivés sur le
sol fertile de la Mandchourie centrale. Mais les troupes
japonaises avaient été redéployées pour défendre les principales
îles japonaises, celles qui restaient étaient de moindre qualité
qu’au début de la guerre.
Lors de la
conférence de Yalta en février 1945, Staline profita de la
situation. Voulant éviter un massacre des troupes américaines
lors de l’invasion du Japon, Roosevelt signa avec lui un accord
secret prévoyant l’entrée en guerre de l’URSS dans les trois
mois suivant la capitulation allemande, et ce en contrepartie de
gains territoriaux, plus une exploitation conjointe avec la
Chine des chemins de fer de l’Est de la Chine et de la
Mandchourie du sud. C’est cependant le bombardement atomique de
Hiroshima qui, surprenant tout le monde, déclencha l’invasion de
la Mandchourie par les troupes soviétiques, ordonnée par Staline
dans la nuit du 8 au 9 août, décision unilatérale sans l’accord
de la Chine. Mais, lorsque le Japon annonça sa capitulation le
14 août, l’URSS continua ses opérations militaires afin
d’étendre au maximum son pouvoir en Asie en détruisant
l’administration japonaise en Mandchourie.
Libération
soviétique, victoire communiste
Bien que
n'ayant pas de troupes en Mandchourie, Tchang Kaï-chek, de son
côté, voulait éviter que les Japonais se retirent trop tôt, et
que la région passe sous le contrôle des communistes. Il fait
donc transmettre aux troupes japonaises restées sur place
l'ordre de ne pas remettre leurs armes aux communistes et
d'attendre l'arrivée des soldats du Guomindang. Il ne peut
cependant empêcher qu'une partie des territoires conquis par
l'armée soviétique en Mandchourie soient investis par les
troupes communistes qui gagnent ainsi de précieuses bases
d'opération tandis que la guérilla communiste locale opère sa
jonction avec les troupes régulières du Parti. Les communistes
chinois installent leur pouvoir à Harbin et de là s'étendent
vers le sud. Les nombreuses familles japonaises qui, sur
incitation du gouvernement japonais, étaient venues coloniser la
région à partir de 1938 sont renvoyées chez elles, dans des
conditions souvent tragiques
.
| |

Expulsion des colons japonais de Mandchourie en 1946 |
|
La conquête de
la Mandchourie par les communistes est définitive à la fin de
1948 ; c’est l'un des faits décisifs marquant la fin de
la guerre civile chinoise. C’est dans le nord-est qu’ont lieu
les premières expériences de Réforme agraire.
C’est aussi, entre autres, du studio japonais du Manchukuo que
provient le plus ancien studio de cinéma chinois, celui de
Changchun (长春电影制片厂) :
il est en effet né de la fusion d’une partie du studio japonais
avec le studio de Yan’an (延安电影制片厂)
évacué à Changchun en 1949 et celui du Nord-Est (东北电影制片厂),
fondé le 1er octobre 1946,
où en 1947 sont réalisés les premiers films d’animation de la
période communiste.
De Mao à
Deng Xiaoping et après : de la gloire au désastre, de la
stabilité à la précarité
Les
communistes s’étaient donc battus pour conquérir cette région
géostratégique du Nord-Est au lourd passé, mais aux riches
ressources. Il fallait commencer par tout reconstruire.
Années
1950 : planification et reconstruction
Alors que le
Dongbei est une région au sol noir fertile qui en fait une riche
zone agricole,
après la fondation de la République populaire, l’accent a été
mis sur son industrialisation : c’est devenu une région
pionnière de l’économie planifiée. Le Dongbei est ainsi devenu
« le fils aîné (de l’industrie) de la République » (gengheguo
(gongye) zhangzi
“共和国工业长子”)
selon le titre honorifique que lui a décerné le président Mao.
Une
industrie sur le mode soviétique
Les débuts de
l’industrie y datent cependant de l’occupation japonaise. Dans
les années 1930, quand le Japon a envahi la Chine, il a
construit un immense complexe militaro-industriel au sud de
Shenyang (alors Mukden), dans la zone de Tiexi (铁西区).
C’était alors l’avant-garde industrielle. À la fin de la guerre,
en 1945, la production industrielle de Mandchourie dépassait
celle du Japon lui-même, ce qui valut à Tiexi le surnom de
« Ruhr de l’Orient » (“东方鲁尔”).
Après la
fondation de la République populaire, le premier plan
quinquennal a été lancé en 1953, sur le mode soviétique et avec
l’assistance soviétique. La zone de Tiexi reconstruite est
devenue le moteur de la modernisation du pays. Le « village des
ouvriers » (《工人村》)
où a grandi
Ban Yu
et qui
est le titre de son premier recueil d’essais a été inauguré en
septembre 1952 : les 72 bâtiments de trois étages avaient été
conçus par des experts soviétiques et incarnaient en Chine le
rêve d’une belle vie avec l’électricité et le téléphone à tous
les étages. Les premiers occupants étaient pour la plupart des
dirigeants d’entreprise, des travailleurs modèles, des membres
des professions intellectuelles supérieures ou des techniciens
qualifiés. Le quartier était la fierté des ouvriers, par
ailleurs glorifiés pour leur rôle central dans l’économie du
pays. Dans les années 1960 et 1970, Shenyang était une ville
moderne, dont l’urbanisation avait commencé très tôt.
| |

Un
hôtel luxueux de Shenyang en 1982 :
l’hôtel Huibin sur la rue Changjiang (长江街) |
|
Une vie
autour de l’usine
Selon, entre
autres, les souvenirs de cet enfant du pays qu’est
Ban Yu,
la vie des ouvriers tournait entièrement autour de l’usine, y
compris la vie culturelle, dans un système parfaitement intégré
qui assurait une grande stabilité. Quand tombait le salaire, à
la fin du mois, la fiche de paie comportait certaines sommes
allouées à des dépenses spécifiques : quelques yuans pour le
coiffeur ou le bain, et une allocation mensuelle pour la
lecture, livres et journaux. Toutes les familles allaient
régulièrement à la bibliothèque de l’usine pour emprunter des
livres, surtout des romans d’aventures et de wuxia et les
grands classiques comme « Au
bord de l’eau » (《水浒传》).
Ils aimaient la danse et la musique ; beaucoup jouaient d’un
instrument, comme on le voit dans les films comme « The
Piano in a Factory » (《钢的琴》)
de
Zhang Meng (张猛)
– autre enfant du pays, né dans le nord du Liaoning.
| |

Les
ouvriers regardant les nouvelles à la télévision à
10 heures
du
matin, à un comptoir du Centre commercial Zhongxing |
|
Comme le fait
remarquer Ban Yu, la vie de l’ouvrier lui laissait, après sa
journée de travail, un temps de loisirs qui lui permettait de
pratiquer un art ou un autre, rejoignant la thèse développée par
Jacques Rancière (publiée en 1981) : « La Nuit des prolétaires.
Archives du rêve ouvrier » ; selon lui, au cœur de de
l’émancipation ouvrière est la rupture du temps répétitif qui
enferme l’ouvrier dans le cycle sans fin du travail et du repos,
avec une dimension intellectuelle et esthétique.
| |
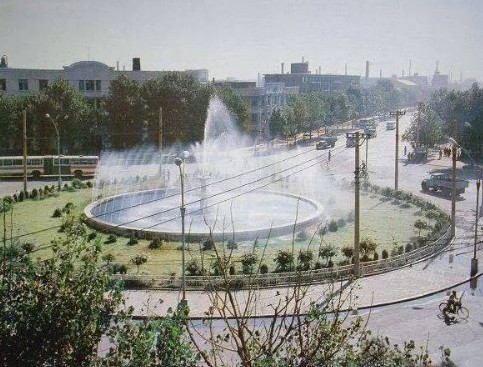
La
place de Tiexi en 1989 |
|
C’est cette
remarquable stabilité qui a soudain volé en éclats lorsque Deng
Xiaoping a lancé sa politique de réformes au début des années
1980. La première faillite d’une entreprise d’Etat depuis la
fondation de la République populaire a été déclarée le 3 août
1986 ; elle faisait des pertes depuis plus de dix ans mais
n’avait qu’une centaine d’employés. Les faillites et fermetures
d’usines se sont multipliées quand Deng Xiaoping a relancé et
amplifié son programme de réformes après son « voyage dans le
sud » (Nan xun
南巡)
,
au printemps 1992.
Années
1990 : réformes
Tandis que
priorité était donnée au développement de certaines zones
côtières de l’est et du sud, le Dongbei a subi de plein fouet
les mesures d’assainissement des industries d’État obsolètes et
déficitaires. Les usines ont fermé et les ouvriers se sont
brusquement retrouvés au chômage, avec quelques centaines de
yuans pour seule rétribution de dizaines d’années de labeur.
C’était un effondrement brutal de leur statut, et un changement
tout aussi brutal de leur mode de vie. La désillusion a été
d’autant plus grande.
Dans un
contexte de développement économique accéléré du reste du pays,
le Nord-Est est devenu le « Rust Belt » de la Chine, avec toute
une population au chômage ayant perdu ses repères et, sans
espoir pour l’avenir, plongeant dans l’alcool, la violence et la
délinquance. Au début des années 2000, le district de Tiexi
offrait le spectacle de désolation et l’atmosphère de désespoir
que montre le
documentaire de Wang Bing
tourné là entre 1999 et 2001. Près de 150 000 ouvriers avaient
perdu leur emploi ; plus de mille grandes et moyennes
entreprises publiques étaient surendettées.
| |
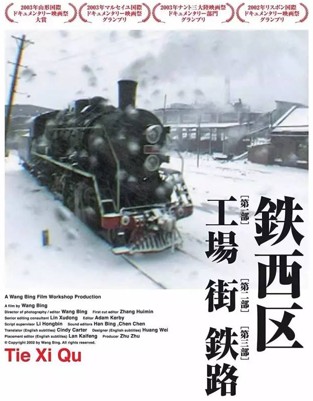
À
l’ouest des rails Tiexi qu |
|
2003 :
plan de revitalisation
C’est dans ce
contexte socio-économique très sombre qu’en 2003 a été adopté
le « plan de revitalisation du Nord-Est » (振兴东北老工业基地),
sous l’égide du nouveau président Hu Jintao (胡锦涛)
et de son premier ministre Wen Jiabao (温家宝).
Un nouveau district de Tiexi a été créé, avec autonomie de
gestion, la vente des terrains offrant une manne inespérée, même
si c’étaient des terrains pollués qui ne valaient pas
grand-chose. Le déménagement des entreprises a dégagé des
recettes dont une partie a permis de rembourser les dettes des
entreprises, et une autre partie à payer des dédommagements aux
anciens salariés licenciés. Des quartiers insalubres ont été
réhabilités ; les ouvriers ont dû payer cher leur nouvel
appartement, mais ont récupéré leur mise ensuite quand les prix
de l’immobilier se sont envolés.
Mais tout le
monde n’en a pas profité, et les anciens licenciés ont longtemps
continué à être une population à bas revenus et faible
protection sociale, en outre désorientés par la faillite de
leurs usines et leur perte consécutive de repères. Il aura fallu
encore une vingtaine d’années pour que la région cesse d’être
considérée comme sinistrée.
Aujourd’hui,
le Dongbei est entré dans l’ère des industries tertiaires. Elles
ont représenté 62 % des revenus de Shenyang en 2019.
Tiexi, en particulier, est devenu une plateforme touristique
utilisant les structures et architectures originales d’anciennes
usines pour promouvoir des « industries culturelles » autour de
bureaux, studios, expositions et « parcs culturels ».
L’industrie
est devenue une attraction. En 2013 a été ouvert au public, dans
le quartier même de Tiexi, le plus grand Musée industriel de
Chine, qui couvre 80 000 m2 et permet de « revivre »
l’expérience des ouvriers de la fonderie et des autres usines
d’autrefois.
| |

Le
Musée industriel de Chine de Shenyang |
|
Cependant,
c’est un musée en hommage à la gloire passée de Tiexi, on n’y
trouvera rien du déclin dramatique de la zone et du sort des
ouvriers et de leurs familles. Mais leur histoire continue
pourtant de hanter les vivants, selon l’idée de Marx qui voyait
l’ombre des générations disparues peser comme un cauchemar sur
les esprits des vivants, dans la lignée de la théorie d’Engels
selon laquelle la tradition est une force d’inertie. Walter
Benjamin a proposé pour sa part une vision plus dialectique des
choses, qui rejoint la muséification de l’histoire industrielle
de Shenyang : selon lui,
le processus traumatique de l’histoire constitue une source de
trésors culturels qui a tendance à effacer la violence et la
souffrance.
Le passé
traumatique, tel qu’il survit dans les esprits, comme « trésor
culturel », se retrouve dans la littérature et parallèlement au
cinéma.
II. La littérature du Nord-Est.
III. La littérature du Nord-Est et le
cinéma.
|
|

