|
|
Brève histoire de la littérature
du Nord-Est : le génie du lieu (II)
par Brigitte
Duzan, 8 août 2025
Depuis les
années 2010, on parle de « littérature du Nord-Est » (Dongbei
wenxue
东北文学),
avec un sens d’identité collective qui n’existe pas de la même
manière dans d’autres régions de Chine, même si la littérature
chinoise de ce début de 21e siècle a tendance à se
décliner en termes régionaux
.
Dans le Nord-Est, on parle de « renaissance culturelle » (Dongbei
wenyi fuxing 东北文艺復兴),
selon un terme que l’on doit au rappeur Gem (Dong Baoshi 董宝石).
Cette renaissance a une signification historique, le Dongbei
ayant été la région la plus massivement frappée par la vague de
fermetures d’usines et de licenciements des années 1990.
Voir :
Brève histoire de la littérature du Nord-Est : I. Contexte
historique
Cette
renaissance passe par toutes les domaines artistiques, mais la
littérature y tient une place prépondérante, associée au cinéma.
II. La
littérature du Nord-Est
Si cette
littérature connaît aujourd’hui un regain inédit, sous la plume
d’écrivains nés pour la plupart dans les années 1980, il ne faut
pas en oublier pour autant leurs prédécesseurs qui ont eux aussi
connu leur gloire en leur temps et occupent une place importante
dans l’histoire de la littérature chinoise. Pour s’en tenir au
20e siècle, on peut distinguer trois périodes de
développement de la littérature du Nord-Est, à commencer par les
années 1930, au moment où sévissait ailleurs la controverse
haipai-jingpai (voir note 1) ; on a d’ailleurs souvent rangé
les écrivains du Nord-Est de cette période dans le courant de la
« littérature du terroir » (xiangtu
wenxue
乡土文学)
prônée par
Shen Congwen (沈从文).
Première
période : les années de guerre (1930-1945)
Les
écrivains d’opposition pendant l’occupation japonaise
Dans le
contexte de l’occupation de la région par le Japon, les jeunes
auteurs du Nord-Est, nés pour la plupart dans les années 1910,
se sont efforcés de trouver les moyens de publier alors que le
nombre de périodiques avait été considérablement réduit et que
les publications étaient soumises à la censure japonaise et à de
sévères contrôles. Certains ont quitté la Mandchourie, mais
leurs écrits ne sont pas seulement anti-japonais ; ils ont
commencé par décrire la situation dans les campagnes, avec une
fraîcheur de ton et une identité propres, souvent pour dénoncer
la pauvreté, mais surtout des mentalités et modes de vie
retardataires.
Les trois
auteurs les plus célèbres de la période sont l’écrivaine
Xiao Hong
(萧红)
et ses amis Xiao Jun (萧军)
et Duanmu Hongliang (端木蕻良),
auxquels il faut ajouter des auteurs un peu moins connus tels
que Shu Qun (舒群),
Luo Feng (羅烽)
et l’écrivaine Bai Lang (白朗),
ou encore Luo Binji (骆宾基)
et Li Huiying (李輝英).
C’est le premier groupe des écrivains du Nord-Est identifiés
comme tels (东北作家群)
.
Née en 1912
dans une famille de propriétaires terriens du Heilongjiang,
Xiao Hong est représentative, avec Xiao Jun et Duanmu
Hongliang qui seront ses époux successifs, de ce courant
littéraire des années 1930 très marqué par la campagne. En juin
1934, alors avec Xiao Jun, Xiao Hong déménage à Qingdao pour
fuir l’occupation japonaise et, trois mois plus tard, publie son
premier chef-d’œuvre, « Terre de vie et de mort »
(《生死场》)
:
un tableau en deux parties de la vie des femmes à l’époque,
marquée par le cycle immuable des saisons et celui tout aussi
immuable des maladies, famines et autres crises ; la deuxième
partie débute avec l’invasion japonaise, et le bref espoir des
paysans d’un changement dynastique, vite réduit en poussière,
mais sans entamer leur fatalisme. C’est cette même mentalité
fataliste et passive débouchant sur une société bloquée que l’on
retrouve dans les œuvres suivantes de Xiao Hong, constat que
l’on retrouve à la même époque dans l’œuvre de
Lu Xun
qui,
enthousiaste, fit publier son œuvre après avoir rencontré
l’écrivaine arrivée à Shanghai en octobre 1934. Elle poursuit
ensuite sa réflexion sur les conséquences de la guerre sur la
vie des femmes, mais revient à son inspiration première en 1940
avec son recueil inspiré de souvenirs d’enfance : « Contes de
la rivière Hulan » (《呼兰河传》)
– recueil pour lequel Mao
Dun
a écrit une préface.
| |
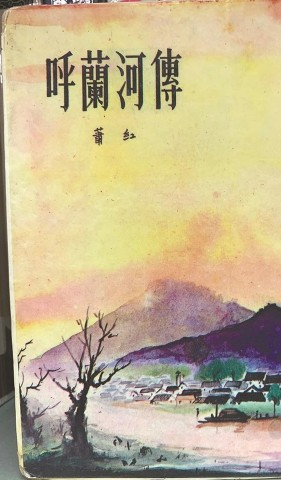
Les
Contes de la rivière Hulan
édités à Hong Kong en 1988 |
|
De
son côté, Xiao Jun est célèbre pour « Le Village en août » (《八月的乡村》),
publié en 1934 et traduit en anglais par Edgar Snow en 1942 ;
mais il a été persécuté après 1949 et emprisonné pendant la
Révolution culturelle. Quant à Duanmu Hongliang, originaire du
Liaoning, il est connu pour une œuvre dont les thèmes
principaux, proches de ceux de
Shen Congwen,
sont la terre et les valeurs qui y sont ancrées, dont « La
prairie de la Bannière de Khorchin » (《科尔沁旗草原》).
Mais il
est peut-être plus connu encore pour ses illustrations, pour ses
propres ouvrages et pour le recueil de nouvelles de Xiao Hong
« Mars dans une petite ville » (《小城三月》),
réalisées en juin 1941, alors qu’ils étaient à Hong Kong.
| |
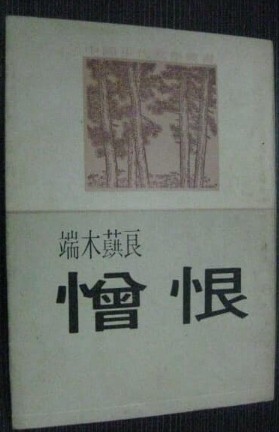
Haine
《憎恨》de
Duanmu Hongliang,
avec
illustrations de l’auteur |
|
| |
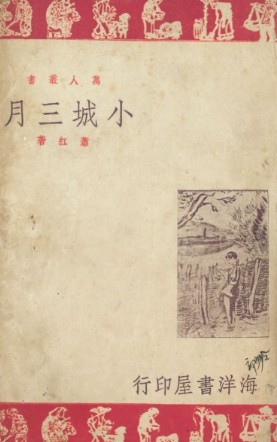
Mars
dans une petite ville, de Xiao Hong,
illustré par Duanmu Hongliang |
|
Ce groupe des
années 1930 de la littérature du Nord-Est comprend bien d’autres
auteurs dont les noms ont tendance à se perdre dans l’oubli.
Ainsi Shu Qun (舒群),
Mandchou originaire de Harbin, proche de Xiao Jun, parti à
Shanghai en 1935 où il a rejoint la Ligue des écrivains de
gauche (Zuo lian
左联) et
a travaillé comme secrétaire du général Zhu De (朱德) ;
on le retrouve à Yan’an où il a été à la tête de l’Académie Lu
Xun tout en étant le rédacteur en chef du supplément littéraire
du « Quotidien de la libération » (《解放日報》) ;
il a continué sa carrière après 1949, mais on peine à citer de
lui des œuvres représentatives.
| |
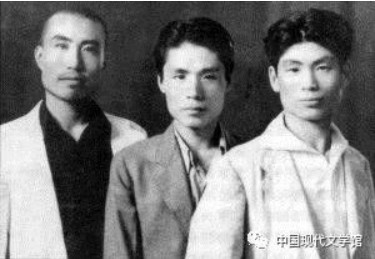
Shu
Qun (à g.) avec Xiao Jun (à dr.) et
Luo
Feng (au centre) à Shanghai en 1936. |
|
Quant à Luo
Feng (羅烽),
il est originaire de ce qui était alors (en 1909) Fengtian (奉天),
c’est-à-dire aujourd’hui Shenyang (沈阳).
Il entre dans les rangs du Parti communiste en 1929 ; la même
année, il épouse l’écrivaine
Bai Lang
(白朗),
originaire elle aussi de Fengtian, qui n’avait alors que 17 ans.
Après l’occupation de Shenyang en 1931, ils vont tous deux vivre
à Harbin et rejoignent la ligne anti-japonaise.
Bai Lang est
le type de l’écrivaine engagée dont la vie et l’œuvre ont été
entièrement déterminées par la guerre. À partir de 1933, elle
publie des reportages dans un journal de Harbin, mais aussi des
articles dans le journal « Night Watch » (Ye shao《夜哨》)
édité par Luo Feng, jusqu’à ce que le journal soit fermé fin
1933 (pour avoir publié des articles sur les atrocités commises
par les Japonais à la campagne). Bai Lang était une amie de Xiao
Hong qui a également participé à la création du journal « Night
Watch » - c’est elle qui lui aurait donné ce nom. Xiao Hong a
ensuite soutenu Bai Lang lorsqu’elle a fondé l’hebdomadaire
« Lettres et Arts » (《文艺》).
Et c’est chez Xiao Hong et Xiao Jun que Bai Lang a trouvé refuge
avec Luo Feng lorsqu’ils sont partis à Shanghai en juillet 1935.
Elle publie « La punition des femmes » (《女人的惩罚》)
et « Avant et après l’occupation » (《沦陷前后》)
qui représentent deux des principaux thèmes de son œuvre.
| |

Bai
Lang (à g.) avec Xiao Hong (à dr.) et au centre
une
journaliste de l’International Herald,
en 1933 |
|
En 1937, le
couple part à Wuhan puis à Chongqing. Bai Lang continue son
engagement. Elle participe avec d’autres écrivains à une visite
de champs de bataille organisée par la Fédération des cercles
littéraires et artistiques et écrit un reportage en forme de
journal, « Nous les quatorze » (《我们十四个》).
En juillet 1940, elle écrit la novella « Le vieux couple » (《老夫妻》)
sur des écrivains dans la guerre ainsi que des souvenirs du
Nord-Est (《忆故乡》).
En 1941, elle part avec Luo Feng à Yan’an qu’ils quittent pour
revenir dans le Nord-Est après la capitulation du Japon, et à
Shenyang en 1948 après la prise de la ville par l’Armée de
Libération. Après 1949, elle poursuit une double activité
journalistique et politique.
Dans ses
récits, elle dépeint l’oppression des femmes et le désastre de
la guerre, mais sans la profondeur tragique de l’œuvre de Xiao
Hong, marquée par les traumatismes de l’enfance et les errances
de liaisons malheureuses. Xiao Hong l’a donc éclipsée dans
l’histoire littéraire, mais le parcours de Bai Lang est
représentatif de l’histoire du Nord-Est pendant la période de
l’occupation japonaise.
La
littérature chinoise du Mandchukuo
Cependant, ces
écrivains en lutte contre la puissance coloniale japonaise ne
doivent pas faire oublier qu’il existait parallèlement tout un
groupe d’écrivains chinois, et d’écrivaines, qui publiaient sous
les auspices des institutions japonaises. Ces écrivaines sont
essentiellement sept, nées dans les années 1910 ou au début des
années 1920, qui ont connu leur heure de gloire dans les années
1930 et au début des années 1940 puis ont été effacées de
l’histoire littéraire par le pouvoir communiste – ce sont « les
oubliées du Manchukuo » :
Dan Di (但娣),
Lan Ling (蓝苓),
Wu Ying (吴瑛),
Yang Xu (杨絮),
Zhu Ti (朱媞),
Zuo Di (左蒂)
et surtout la plus célèbre, Mei
Niang (梅娘).
Elle avait un
lourd passé : sa mère était une concubine forcée au suicide par
son père, homme d’affaires mort ruiné en 1936. Sur quoi la
famille l’a envoyée faire des études au Japon. C’est là qu’elle
découvre la littérature occidentale, et l’œuvre de Xiao Hong, là
aussi qu’elle fait la connaissance d’un étudiant chinois qui
travaille dans une librairie et qu’elle épouse contre l’avis de
sa famille. Elle est alors farouchement opposée au pouvoir
colonial japonais qui ne fait, à ses yeux, que renforcer le
système patriarcal chinois. Son œuvre est influencée par les
idées du
mouvement du 4 mai.
Malgré
l’opposition des conservateurs japonais, ses nouvelles sont
couronnées de prix prestigieux, dont le prix du Grand Est
asiatique (“大东亚文学赏”的“副赏”) en
1943, décerné à Nankin en 1944. Elle est à l’apogée de sa
carrière littéraire, rédactrice à Pékin de la Revue des
femmes (Funü zazhi《妇女杂志》)
tandis que son mari travaille au Journal chinois d’Osaka (《华文大阪每日》).
Elle partage la célébrité de
Zhang Ailing (张爱玲),
l’une
régnant sur Shanghai, l’autre sur le Nord-Est : on disait « il y
a Ling au sud et Mei au nord » (“南玲北梅”).
| |
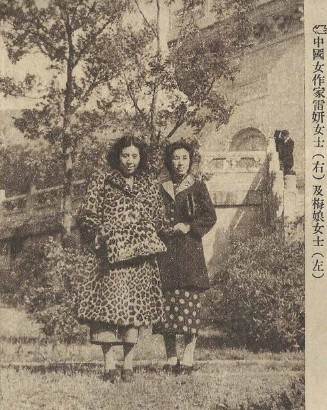
Mei
Niang (à g.) au congrès de Nankin en 1944
|
|
Mais tout cela
a volé en éclat après 1950 : comme les autres écrivaines ayant
écrit et publié dans le Mandchukuo sous occupation japonaise,
elle est condamnée comme traître à la patrie (hanjian 汉奸)
et, en 1957, comme droitiste. Elle est envoyée en rééducation
dans une ferme près de Pékin. Elle sera réhabilitée en 1978,
mais il faudra attendre les années 2000 pour que son œuvre soit
redécouverte, avec tout ce qu’elle avait de vivant et de
critique
.
Après la
capitulation du Japon
Après la
guerre, les écrivains et écrivaines du Mandchukuo ont subi la
censure du Guomingdang, puis des Communistes, après avoir subi
celle des Japonais. Les contrôles opérés par les Japonais se
sont renforcés après l’attaque de Pearl Harbour le 8 décembre
1941 ; accompagné d’une centralisation des médias, le
renforcement s’est traduit par des poursuites contre les œuvres
jugées anti-japonaises. Une écrivaine comme Dan Di (但娣)
a été emprisonnée deux fois, tandis que Zuo Di (左蒂)
était condamnée à deux ans de prison pour avoir tenté de fuir le
Mandchukuo, mais libérée quelques mois plus tard en raison de
problèmes de santé. Outre ses propres écrits, Zuo Di avait
participé à l’automne 1943 à la publication du roman « la Vallée
verte » (《绿色的谷》)
de son mari Liang Shanding (梁山丁).
Il fut aussitôt censuré, mais Liang Shanding parvint à s’enfuir
à Pékin
.
La répression
entraîna en effet un exode d’écrivains, dont Mei Niang et son
mari qui allèrent s’installer eux aussi à Pékin, qui était
également sous occupation japonaise, mais sans contrôles aussi
sévères. Ces transfuges fondèrent en juin 1942 l’Association des
écrivains du Nord de la Chine et du Mandchukuo (Huabei
Manzhou xiehui 华北满州协会)
qui parvinrent à maintenir un style différent du reste de la
Chine en gardant le contact avec les écrivains restés au
Mandchukuo.
Après la fin
de la guerre, la vie littéraire reprend sur ces bases. En
octobre 1945 est créée la revue « Littérature du Nord-Est » ( Dongbei
Wenxue《东北文学》),
par le groupe des écrivains de Changchun.
| |
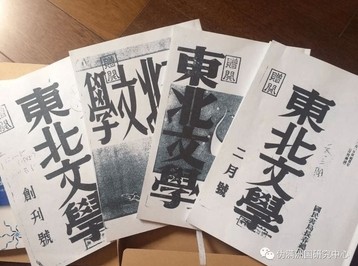
La
revue Dongbei Wenxue |
|
La revue a
édité six numéros et publié une vingtaine d’auteurs avant de
cesser sa publication en raison de l’arrestation par le
Guomingdang de son rédacteur en chef, Li Zhengzhong (李正中),
et de sa condamnation à six mois de prison. Li Zhengzhong était
célèbre pour ses œuvres de calligraphie, ses poèmes et ses
recueils de nouvelles ; il était le mari d’une autre écrivaine
du Mandchukuo, Zhu Ti (朱媞),
nom de plume de Zhang Xingjuan (张杏娟),
qu’il a épousée en 1943. Il a encore été condamné à la prison
par les Communistes pour sa carrière sous le Mandchukuo, a cessé
d’écrire en 1955, a été condamné comme contre-révolutionnaire en
1969 et envoyé aux fins fonds du Liaoning avec Zhu Ti et leurs
trois enfants. C’est le lot commun de tous ces écrivains qui
sont passés d’un régime à un autre, d’une censure à une autre.
| |
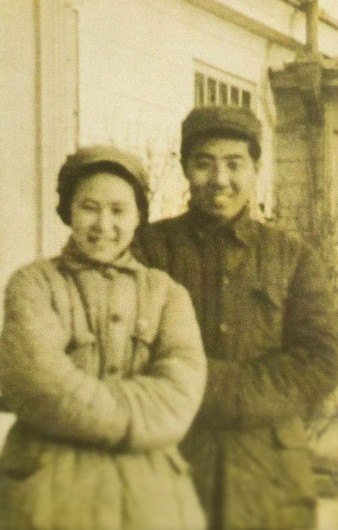
Li
Zhenzhong et Zhu Ti à Harbin en 1946, devant
le
département politique de l’Armée du Nord-Est |
|
Deuxième
période : la mémoire de Harbin
Cette deuxième
période de la littérature du Nord-Est est celle des écrivains
nés cinquante ans plus tard que les précédents : dans les années
1960
.
C’est
l’écrivaine
Chi Zijian (迟子建)
qui est représentative de cette période. Née en 1964 dans le
nord du Heilongjiang, elle a fait ses études à Xi’an puis à
Pékin, et elle est ensuite revenue vivre dans le Heilongjiang,
mais à Harbin. Toute son œuvre est consacrée à l’étude des
complexités et de la diversité de l’histoire et de la culture
régionales, à commencer par le « Conte d’un village du Grand
Nord » (《北极村童话》),
publié en 1986 et rappelant les histoires que lui contait sa
grand-mère quand elle était petite.
Son nom,
cependant, est intimement lié au roman qui l’a consacrée, « La
rive droite de l’Argun » (《额尔古纳河右岸》),
en raison à la fois du succès de ses traductions,
mais aussi parce qu’il a été l’un des lauréats du prix Mao Dun
en 2008. Ce succès a fait de Chi Zijian le chantre du peuple des
Ewenki, de leur mode de vie, de leurs croyances et de leurs
coutumes, toute une culture en voie de disparition dont elle a
fait, avec beaucoup de poésie, une tragédie des temps modernes,
contée à la première personne par une vieille shamane au soir de
sa vie. On a ainsi l’impression d’une immersion dans la vie d’un
village qui se meurt avec elle, doublée de l’intérêt
ethnologique du sujet.
| |
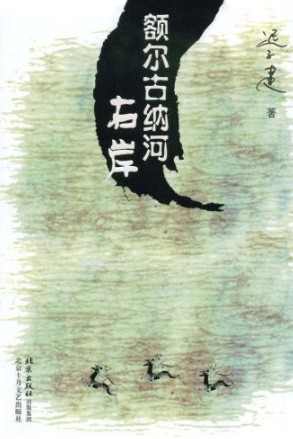
La
rive droite de l’Argun, éd. 2005,
北京十月文艺出版社 |
|
Mais c’était
là le cinquième roman de Chi Zijian, le premier, étant paru en
1991. Le troisième, commencé à la fin de 1990, a été le fruit de
longues recherches sur l’histoire du Nord-Est sous occupation
japonaise : c’est « Mandchukuo » (《伪满洲国》),
publié en 2000 (et réédité en 2004). Elle est revenue sur
l’histoire de la Manchourie avec le roman « Corbeaux dans la
neige » (《白雪乌鸦》),
en 2010. Sur la base de documents et rapports non officiels, Chi
Zijian décrit l’épidémie dévastatrice de peste pulmonaire à
Harbin dans les années 1910-1911, en imaginant comme à son
habitude des histoires d’amour et de rancœurs sur fond de
pandémie, mais en centrant son récit sur le légendaire médecin
Wu Liande (伍连德)
qui a contribué à faire avancer les connaissances médicales sur
la lutte contre cette maladie, et les épidémies en général. Le
roman a suscité une nouvel intérêt au moment de l’épidémie de
Covid-19.
C’est encore
l’histoire de Harbin, histoire spirituelle et biographie urbaine
d’aujourd’hui, qui est le sujet du roman « Des feux d’artifice
sans fin » (《烟火漫卷》)
initialement publié en août 2020. C’est un tableau vivant de la
ville au quotidien, achevé juste avant l’épidémie de Covid-19,
où tous les personnages semblent avoir pour caractéristique
commune d’être à la recherche de quelqu’un…
Mais ce n’est
là que la partie émergée de l’iceberg : depuis les années 1990,
la majeure partie de l’œuvre de Chi Zijian est constituée de
nouvelles et novellas qui offrent un tableau beaucoup plus
diversifié des divers aspects de l’histoire, de la vie et de la
culture du Nord-Est, en particulier à Harbin et dans sa région.
C’est toute la mémoire du lieu qui se déroule au fil des pages,
à la campagne, reflétant ses souvenirs d’enfance, mais aussi à
la ville : ainsi, dans « Bonsoir
la rose » (《晚安玫瑰》)
où, derrière la poésie et l’émotion à fleur de peau, perce le
reflet de l’empreinte russe sur la ville de Harbin.
Beaucoup de
ces nouvelles ont été primées, à commencer par trois prix Lu Xun
en 1998, 2001 et 2007. Cette dernière nouvelle primée, « Toutes
les nuits du monde » (《世界上所有的夜晚》),
est particulièrement réussie dans sa peinture de l’univers d’une
petite ville minière où arrive une femme qui vient de perdre son
mari mineur ; elle se retrouve en symbiose avec les autres
habitants, qui ont eux aussi, pour la plupart, perdu un être
cher dans un accident de la mine, mais sa douleur est également
en symbiose avec celle de l’écrivaine qui venait de perdre son
mari dans un accident de voiture.
On a là un
exemple de la tendance croissante de Chi Zijian à replacer ses
récits dans un contexte actuel. Ainsi, le recueil « Histoires
du Nord-Est » (《东北故事集》)
paru en juin 2024 poursuit la narration de la mémoire du Dongbei
avec toujours le même accent émotionnel et personnel, mais avec
aussi un net effort de se replacer dans un contexte de
littérature mondiale. En même temps, la narration est de plus en
plus sophistiquée, et renvoie souvent à des récits antérieurs.
Ainsi la nouvelle de 2021 « Le bruit de la soupe que l’on
mange » (《喝汤的声音》)
mêle réflexion historique sur fond de mémoire sonore, à travers
une narration fragmentée qui rappelle la nouvelle de 1996
« L’enclos du bétail dans la brume et la lumière de la lune » (《雾月牛栏》).
L’œuvre de Chi Zijian forme ainsi un univers personnel qui
s’enrichit par strates successives en reprenant des éléments
narratifs et surtout stylistiques communs.
| |
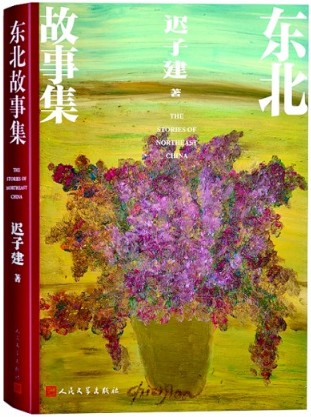
Histoires du Nord-Est 《东北故事集》
juin
2024,
人民文学出版社 |
|
On a là un
monument littéraire centré sur le Heilongjian et Harbin qui tend
à monopoliser la mémoire et la littérature du Nord-Est
.
En même temps, ces « Histoires du Nord-Est » représentent des
« images géographiques » selon le terme de l’historien d’art et
ethnographe culturel russe D.N. Zamyatin, images qui incarnent
dans un certain espace et un certain temps l’esprit du lieu.
Il faut
attendre ensuite la fin des années 2010 pour qu’ émerge un
groupe d’écrivains qui sont, eux, nés à Shenyang et représentent
une autre image et une autre mémoire du Nord-Est : mémoire du
passé douloureux de la génération sacrifiée par les réformes
brutales des années 1990.
Troisième période : la mémoire de Shenyang et la renaissance du
Nord-Est
Dans les
années 1930, les Japonais avaient construit au sud de Shenyang,
dans le quartier de Tiexi (铁西区)
un immense complexe militaro-industriel d’avant-garde. Puis,
dans les années 1950, toute la zone a été reconstruite avec
l’aide et selon le modèle soviétique, faisant de Shenyang « la
Ruhr de l’Orient » (“东方鲁尔”)
.
Toute la vie des ouvriers était prise en charge par l’usine, et
intégrée dans celle de l’usine.
Ce système
parfaitement intégré et offrant aux ouvriers une grande
stabilité a été remis en question au début des années 1980
lorsque Deng Xiaoping a lancé sa politique de réformes, et a
volé en éclats quand il a intensifié son programme de réformes
après son « voyage dans le sud » (Nan xun 南巡),
au printemps 1992. Les usines avaient commencé à se déclarer en
faillite à la fin des années 1980 ; les fermetures se sont
multipliées dans les années 1990, accompagnées de licenciements
brutaux. De « la Ruhr de l’Orient », Shenyang est devenue la
« Rust Belt » de la Chine, avec toute une population au chômage
plongeant dans l’alcool, la violence et la délinquance.
C’est de ce
contexte traumatique qu’est née une nouvelle littérature du
Nord-Est centrée sur Shenyang et portée par « le groupe des
nouveaux écrivains du Nord-Est » (新东北作家群).
Les
trois mousquetaires de Tiexi
Ces nouveaux
écrivains sont d’abord un groupe de trois, nés à Tiexi dans les
années 1980 :
Shuang Xuetao (双雪涛), Ban
Yu (班宇)
et Zheng
Zhi (郑执),
baptisés « Les trois mousquetaires de Tiexi » (Tiexi san
jianke铁西三剑客).
Nés entre 1983 et 1987, ils ont vécu dans leur enfance les
fermetures d’usine et le licenciement brutal de leurs parents et
de leurs proches, et ont grandi dans l’atmosphère de désolation
qui en a résulté. Leur œuvre en est le reflet et la mémoire et
participent à ce qu’on a appelé « la Renaissance culturelle du
Dongbei » (东北“文艺复兴” ).
On leur
adjoint parfois un quatrième écrivain,
Jia Hangjia (賈行家),
né à Harbin en 1978 : avec les trois précédents, il forme ce
qu’on a appelé « les 4F du Dongbei » (东北F4),
c’est-à-dire les 4 fleurs du Nord-Est. Mais il est surtout
essayiste, et donc beaucoup moins connu que les trois autres.
1/ L’œuvre
représentative de cette nouvelle littérature, celle aussi qui en
a été le premier grand succès et a contribué à lui donner une
identité propre, c’est la novella de
Shuang Xuetao (双雪涛), « Moïse
dans la plaine » (《平原上的摩西》),
publiée sous ce même titre en juin 2016 dans un recueil de dix
nouvelles courtes et moyennes. La novella relate l’histoire d’un
jeune policier qui reprend une enquête sur une affaire de
meurtres de chauffeurs de taxis qui a eu lieu douze ans
auparavant ; il a grandi dans le quartier où ces meurtres ont eu
lieu et se sent impliqué, en particulier parce que l’une de ses
anciennes voisines, un temps très proche de sa famille, semble
impliquée dans cette histoire.
| |
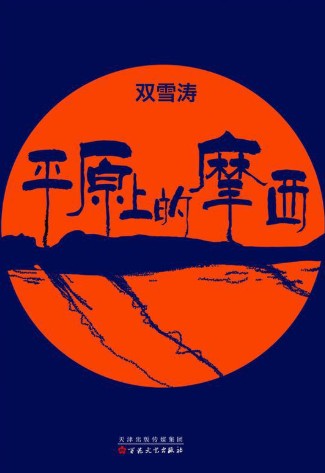
Moïse dans la plaine《平原上的摩西》
juillet 2016,
百花文艺出版社 |
|
Le récit vaut par sa construction originale et son art narratif
dont le caractère novateur a été souligné pour en faire
ressortir l’esthétique
,
mais aussi parce que, à travers cette histoire faussement
policière, c’est toute la vie des gens ordinaires du quartier
qui est évoquée, leur lutte pour trouver un emploi de
substitution, leur misère spirituelle, le profond désespoir
générant toutes les dérives, alcool et violence. Le désarroi, le
mal-être des jeunes découlent directement ou indirectement du
traumatisme subi par la brutale mise au chômage des parents,
comme un relais d’une génération à l’autre.
Shuang Xuetao a multiplié ensuite les publications sur des
thèmes proches, culminant dans un roman au titre révélateur
publié en 2020 : « L’Époque des sourds-muets » (《聋哑时代》).
Exprimant toute la frustration, mais aussi la nostalgie, du
passé récent, le roman témoigne de la violence née de la
décadence urbaine, de l’agonie d’une région liée à la fin
programmée d’une ère industrielle, et le désir d’en préserver la
mémoire dans les trous de l’histoire officielle. Car tout est
fait aujourd’hui, comme toujours, pour effacer cette mémoire de
l’histoire, dans une ville modernisée où cette mémoire est
embaumée dans un Musée de l’industrie qui est en fait un
monument en hommage à la gloire passée de Tiexi, gloire dont est
effacée toute trace de violence et de souffrance pour en faire
une attraction populaire.
2/ Shuang Xuetao fait ainsi figure d’aîné et de père fondateur.
Il a été relayé par
Ban Yu (班宇) qui
a publié plusieurs recueils de nouvelles à partir de 2018. C’est
le « Village des ouvriers » (工人村)
de Tiexi où il a grandi qui lui a fourni le sujet de ses
premières nouvelles reflétant la lente agonie d’une population
au bord de la survie, avec des éclats de violence traduisant le
désespoir et les frustrations. Mais c’est la nouvelle «
Baignade hivernale » (Dōng yǒng《冬泳》)
du recueil éponyme publié en septembre 2018 qui marque vraiment
une écriture et une inspiration originales : comme les six
autres nouvelles du recueil, mais plus encore, elle est d’abord
marquée par un univers glacial qui semble comme anesthésier tout
sentiment, avec, planant sur les personnages, le mystère d’une
mort resté irrésolu, et une fin énigmatique qui pourrait être
expiatoire, mais dont la réalité reste évanescente.
| |
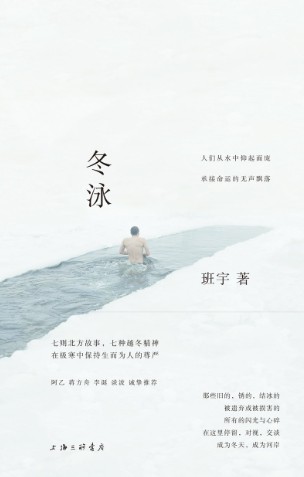
Baignade hivernale
Dōng yǒng《冬泳》
sept. 2018
上海三联书店 |
|
Ban Yu a dépassé là le souvenir du passé industriel de Shenyang
et de ses conséquences. Ce qui prime ici, c’est le froid, la
neige, ce qui rend la vie naturellement difficile dans ce
Nord-Est aux hivers glacés. Et si le deuxième recueil de Ban Yu,
paru en mai 2020, semble annoncer un tournant avec un titre plus
optimiste, « Jours d’insouciance » (Xiāoyáo yóu《逍遥游》),
il n’en est rien : ces sept nouveaux récits poursuivent les
mêmes thèmes, froid glacial et lumière hivernale avec noyés et
disparus dans un paysage comme noyé dans le brouillard, le tout
exprimé dans une écriture tout aussi allusive mêlant rêves et
métaphores.
Avec un troisième recueil deux ans plus tard, il a complété ce
qui apparaît comme une trilogie, en affirmant une réflexion sur
le présent, éloignée du passé, et en poursuivant ses recherches
sur le style et le pouvoir de l’imagination. Son Nord-Est, dès
lors, ressemble de plus en plus au reste de la Chine, et c’est
ce qui donne d’autant plus d’attrait et de poids à cette
littérature.
Avec leur ancrage dans l’agonie industrielle du Nord-Est, les
nouvelles de Shuang Xuetao trouvent des échos dans la génération
actuelle des jeunes qui ont de plus en plus de mal à trouver des
emplois. Les récits de Ban Yu, quant à eux, diffusent une
atmosphère d’inquiétude latente qui engendre aussi un sentiment
de symbiose chez les lecteurs d’aujourd’hui.
3/ Zheng
Zhi (郑执),
pour sa part, est lui aussi le fils d’un ancien ouvrier d’usine
de Shenyang. Il est revenu là à sa mort, en 2006, après être
parti faire des études à Hong Kong. Né en 1987, c’est le plus
jeune des trois, mais il a un ton caustique dès ses débuts. Ses
premiers récits sont peuplés de paumés qui valent les liumang
(流氓),
voire les pizi (痞子)
de
Wang Shuo (王朔) :
un voleur repenti, une ancienne actrice et un ex-maniaque sexuel
qui, dans son deuxième roman, unissent leurs efforts pour tenter
de construire une école dans un coin perdu avec l’argent qu’ils
ont gagné… à la loterie. Le coin perdu s’appelle « le bourg de
la pierre qui pleure » (泣石镇) ;
les pierres, se mettent, paraît-il, à pleurer à la fin de l’été,
quand chacun a perdu ses illusions.
C’est le ton général des premiers écrits de Zheng Zhi, à la fois
ironique et désespéré. Puis, en 2017, il est passé à une
écriture différente avec « Avaler cru » (《生吞》) :
un roman noir à suspense, dont l’histoire est contée dans une
double perspective, par un narrateur à la première personne, et
par un policier à la troisième personne. La recherche
stylistique est intéressante, mais Zheng Zhi rejoint là un
courant de romans à suspense comme ceux de
Xu Yigua (须一瓜),
mais aussi dans la ligne de « Moïse dans la plaine », ce qui le
rattache au courant du Nord-Est.
Cependant, ce qui l’a fait connaître, c’est la nouvelle qu’il a
écrite aussitôt après ce roman : « Le syndrome de l’immortel »
(Xiān zhèng《仙症》),
initialement publiée fin juillet 2018 sur le site internet
Tencent. Dajia (《腾讯·大家》)
et tout de suite remarquée. Elle a en novembre remporté le
premier prix du « Projet Écrivain anonyme » (“匿名作家计划”)
de Zhang
Yueran (张悦然).
| |
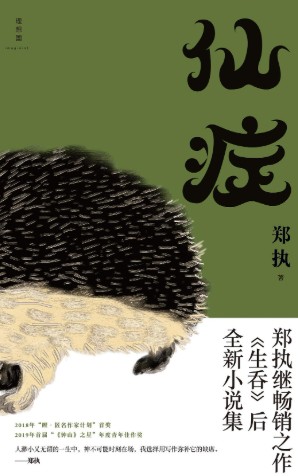
Le syndrome de l’immortel
《仙症》
oct. 2020
北京日报出版社 |
|
Cependant, si la nouvelle l’a rendu célèbre, c’est en grande
partie grâce à l’adaptation cinématographique qui en a été
réalisée, par
Gu Changwei (顾长卫),
sous le titre « The Hedgehog » (《刺猬》),
avec
Ge You (葛优)
dans le rôle principal. En compétition au 26e festival
de Shanghai en juin 2024, le film y a décroché le prix du
meilleur scénario.
4/ Outre ce
trio, on peut aussi noter l’émergence d’une jeune écrivaine née
en 1994 à Qiqihar, dans le Heilongjiang (黑龙江齐齐哈尔),
où elle a passé son enfance et son adolescence :
Yang Zhihan (杨知寒).
En octobre
2023, elle a décroché le premier prix de la 6ème édition
du prix Blancpain-Imaginist pour son recueil de nouvelles « Un
solide bloc de glace » (Yituan jianbing《一团坚冰》)
publié en juillet 2022 : neuf nouvelles, courtes et moyennes,
relatant des histoires un tantinet déprimantes de personnages
vivant dans le Nord-Est. Affirmant avoir le sentiment profond
d’écrire « en étant plongée dans l’histoire » (自己处于历史中), et
de « grandir dans une ère en voie de disparition qu’il importait
donc d’enregistrer. » (我深刻的感受到自己的成长伴随一个时代的离场,尝试有所记录。),
elle a tout de suite été classée parmi les auteurs
représentatifs de la renaissance littéraire du Nord-Est.
Elle a publié
un autre recueil de nouvelles en juillet 2023 : « Après la
tombée du jour » (Huánghūn hòu《黄昏后》).
Ce sont dix récits qui continuent sa chronique de la vie dans
une petite ville de son Dongbei natal, avec des rebondissements
inattendus, un semblant d’humour et une fugace lueur d’espoir au
fond du tunnel. La dernière nouvelle du recueil, « La piscine de
Haishan » (《海山游泳馆》)
est représentative d’une émotion subtile née de l‘évocation
nostalgique d’un passé révolu
.
| |
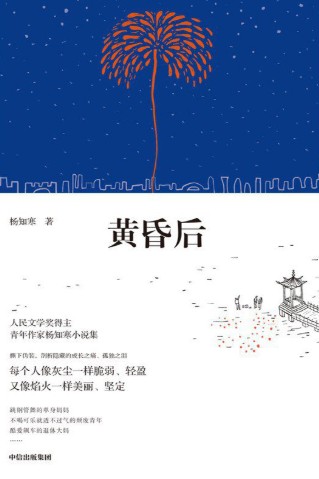
Après la tombée du jour 《黄昏后》
juillet 2023 中信出版社 |
|
Il lui manque
encore la maturité des trois autres
écrivains du groupe du Nord-Est, et la
caractéristique qui leur est
commune : l’importance du cinéma pour le développement de leur
carrière et leur notoriété.
III. La littérature du Nord-Est et le
cinéma.
Engagement politique y compris, au moment de la guerre
de Corée, dans le mouvement pacifiste féministe dans le
cadre de la Fédération démocratique internationale des
femmes (DFIF) fondée en 1945 lors d’un congrès à la
Maison de la Mutualité à Paris.
Mais,
avec Luo Feng, elle est prise en 1955 dans la tourmente
du mouvement anti-Hu Feng et, en 1957, ils sont déclarés
droitistes. Bai Lang est envoyée travailler dans la mine
de charbon de Fuxin (阜新),
dans le Liaoning. Il sont tous les deux persécutés
pendant la Révolution culturelle. Luo Feng revient à
Shenyang en 1969 avec Bai Lang dont la santé est
gravement atteinte…
|
|

