|
|
La
littérature féminine en Chine continentale, d’hier à
aujourd’hui (1919-2019)
III. La
littérature féminine chinoise au XXIe siècle
par Brigitte Duzan, 10 février
2019
Les grandes tendances
Le tournant du millénaire est une période où apparaît sur le
devant de la scène une nouvelle génération, dite
post-70 : née dans les années 1970, c’est-à-dire la dernière
moitié de la Révolution culturelle, elle avait été « zappée »
jusqu’ici car prise entre deux générations qui lui avaient fait
de l’ombre : celle des anciens qui continuaient à écrire, et
celle des jeunes nés dans les années 1980, turbulents et
médiatisés, liés aussi à la montée de la littérature sur
internet ; cela a donné quelques bestsellers, et la vague est
retombée.
En même temps, le roman s’essouffle ; la tendance est aux formes
plus courtes, et à un retour vers la nouvelle, mais dans
sa forme dite « moyenne », entre la nouvelle courte
traditionnelle et le roman, qui offre l’avantage à la fois du
style et de contenu.
En outre, la littérature chinoise se diversifie, dans des genres
qui n’étaient pas représentés jusqu’ici, ou très peu, pour des
raisons de tradition, mais aussi de censure. C’est le cas en
particulier du roman policier et de la science-fiction
qui se développent sous l’influence de l’Occident.
Les écrivaines s’inscrivent dans ce paysage littéraire en pleine
mutation et y tiennent bien leur place, au-delà des phénomènes
d’édition et des scandales qui ont marqué les années 1990. De
toute façon, la censure s’est resserrée, surtout à partir des
Jeux olympiques de Pékin en 2008. A côté de « valeurs sûres »,
comme Wang Anyi et Fang Fang, mais dans des écritures
renouvelées, les écrivaines post-70 forment aujourd’hui un
groupe non négligeable. Le problème, pour le lecteur français,
est que les traductions sont encore en nombre limité.
1.
La génération des années 1950-1960
Parmi les « anciennes » de cette génération, Wang Anyi
continue de publier, mais semble s’épuiser quelque peu. Chi
Li bénéficie toujours de la même aura en France et continue
d’attirer des lecteurs, mais en continuant d’écrire dans le même
registre. Il en est d’autres à découvrir ou redécouvrir.
Peinture de femmes entre ville et campagne
Sun Huifen (孙惠芬)
est née en 1961, a commencé à publier qu’en 1982, mais n’a été
admise à l’Association des écrivains qu’en 1991, et ce n’est
encore que plus de dix ans plus tard qu’elle a obtenu le prix Lu
Xun pour une nouvelle « moyenne ». Elle a travaillé à la
campagne et à l’usine avant de pouvoir faire des études, et
c’est toujours un peu sa vie qu’elle nous raconte : à travers
des portraits de femmes modestes de la campagne et de la ville,
inspirées de son expérience personnelle, elle nous offre une
peinture de la condition féminine dans les régions rurales et
les classes défavorisées de la Chine d’aujourd’hui.
Ce ne sont pas que des femmes modestes : l’une, kidnappée par
des bandits au début du 20e siècle, s’est mariée avec
le chef de la bande, devenant bandit elle-même, comme dans le
grand classique du 14e siècle « Au bord de l’eau ».
Mais la plupart n’ont que leur vitalité et leur résilience pour
tout viatique dans la vie, comme celles du recueil de nouvelles
publié en 2012, « Nouvelles de la campagne de Sun Huifen »
(《孙惠芬乡村小说》),
dont est tiré la nouvelle Baomu (《保姆》),
c’est-à-dire La Bonne, mais traduit « Cousine Perle »
dans la traduction en français parue en 2014.
C’est le portrait d’une femme de la campagne venue en ville
s’occuper de l’épouse malade d’un professeur qui se remariera
après la mort de celle-ci, lui enlevant toute illusion quant aux
rapports qu’elle pensait avoir noués avec lui ; elle ira ensuite
de famille en famille, en restant toujours étrangère à la ville,
et aux familles où elle est employée.
On pourrait citer d’autres écrivaines de cette génération dont
on n’a aucune traduction en français, ni même souvent en
anglais, comme
Ye Mi (叶弥), par exemple,
née en 1964, auteure de nouvelles dont une adaptée au cinéma en
2007, ou encore
Fan Xiaoqing (范小青), autre
représentante du courant néo-réaliste des années 1990, mais
aussi de la culture et de l’histoire de Suzhou, donc pendant
féminin mais méconnu de
Lu Wenfu (陆文夫).
Portraits de femmes du Grand Nord
|
Bien que née en 1964,
Chi Zijian (迟子建)
est devenue populaire en même temps que la
génération de la décennie suivante, en ouvrant un
domaine largement inexploré jusqu’alors.
Peintre du Grand Nord, où elle est née, et non de la
réalité urbaine et de ses mutations, le courant
littéraire majeur depuis les années 1990, elle a
longtemps été à l’écart des grands courants
littéraires et des goûts des lecteurs. Pourtant
trois fois lauréate, entre autres, du prix Lu Xun,
elle n’a en effet acquis une réelle notoriété que
lorsqu’elle a décroché le prix Mao Dun en 2008 pour
son roman traduit en français « Le dernier
quartier de lune » (《额尔古纳河右岸》)
.
Il traite
de la longue descente aux enfers des Ewenki, le
peuple de la chaîne du Grand Khingan qui est au cœur
du roman, à un moment où leur histoire devenait par
ailleurs sujet d’étude et de documentaires. C’est
une tragédie des temps modernes, en grande partie
entraînée par les |
|
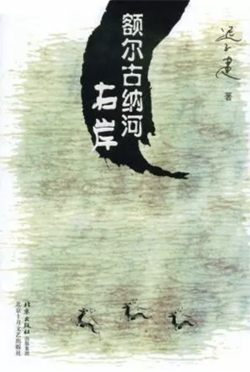
Chi Zijian, Le dernier quartier de
lune |
changements de
modes de vie induits par la politique gouvernementale
d’exploitation de la forêt et de développement sans prise en
compte des contraintes économiques locales, ni des données
environnementales et humaines. Le roman conte la disparition
d’un peuple et de sa culture, narrée à la première personne
par une vieille femme parvenue à ses quatre-vingt-dix ans,
qui assiste à la mort lente – et programmée – du village
entier.
Chi Zijian a expliqué
la longue genèse de son roman : une amie lui avait envoyé un
article paru dans la presse racontant la fin tragique d’une
Ewenki, peintre de talent, qui était partie vivre en ville,
comme les autres, à la suite de la politique de relogement du
début des années 2000 ; déprimée, elle est finalement revenue
dans sa forêt natale pour se jeter dans la rivière… l’amie avait
griffonné en marge de l’article : « écris cette histoire, toi
seule peut le faire comme il faut… ».
C’était le cinquième
roman de Chi Zijian, qui a fait de longues recherches avant de
l’écrire. Ses autres romans sont tous inspirés de faits
historiques, dans le nord-est de la Chine, ce qui était
autrefois la Mandchourie - des événements souvent méconnus,
comme l’épidémie de peste pulmonaire à Harbin dans les années
1910-1911.
Mais elle est aussi
l’auteure d’un grand nombre de recueils de nouvelles, et en
particulier des nouvelles dites « moyennes » où elle excelle et
dont plusieurs ont été traduites en français. On y retrouve
l’univers du Grand Nord, avec les mystères qui lui sont liés
dans l’imaginaire de l’auteure, nourri par les histoires que lui
racontaient sa grand-mère :
- « Toutes les nuits
du monde », publié en Chine en 2007, est un recueil de deux
nouvelles dans la traduction en français,
dont la première est particulièrement touchante et typique du
style de Chi Zijian. Inspirée de souvenirs d’enfance, elle
raconte l’histoire d’une petite fille turbulente et
désobéissante, confiée à sa grand-mère, dont le quotidien est
égayé par la rencontre de la vieille voisine Nainai ; celle-ci
lui apporte à la fois une part de chaleur et une aura de
mystère, comme si, derrière chaque vieille personne du village,
se cachait une histoire secrète.
-
On retrouve un secret de ce genre dans « Bonsoir,
la rose » (《晚安玫瑰》),
initialement publiée dans Littérature du peuple en mars 2013.
Au centre de l’histoire sont deux femmes, l’une jeune et l’autre
déjà âgée, celle-ci hébergeant l’autre qui cherchait une chambre
à louer, dans la ville de Harbin où vit l’auteure. Elles ne
semblent pas faites, a priori, pour s’entendre : la plus jeune
travaille dans une agence de presse, l’autre vit dans son passé,
joue du piano, prie en hébreu… elle est juive d’origine russe,
sa famille a émigré en Chine à la suite de la Révolution
d’octobre.
Toutes deux sont
marquées par leur passé, la plus jeune par les circonstances
tragiques de sa naissance, l’autre par ses origines, aussi, mais
d’une autre manière : elle fait partie des émigrés russes venus
de Sibérie, dans le nord de la Chine ; c’est un personnage
coloré et attachant, cachant un passé douloureux et des trésors
de tendresse refoulée. Ce sont finalement deux solitudes qui
brisent leur isolement, deux être meurtris qui s’épaulent.
L’histoire de Chi Zijian a un aspect de fable intemporelle,
c’est un conte des temps modernes, écrit avec une extrême
sensibilité, et une tension affective profondément émouvante.
Réflexion sur l’histoire
On connaissait
Fang Fang (方方)
pour ses nouvelles néo-réalistes des années 1990. Elle a
beaucoup évolué ensuite pour se tourner vers des recherches sur
la mémoire et l’histoire, et plus particulièrement celle de sa
ville de Wuhan et de sa région. En 2007, son roman « Le
printemps
est arrivé jusqu’à Tan Hualin » est représentatif de cette
nouvelle étape dans son écriture : le contexte historique
prend une place importante, le reste de la vieille muraille de
la ville dans l’arrière-cour d’une maison imposant la présence
de l’histoire de la ville en arrière-plan du récit. Un an plus
tard, elle a achevé un roman sur la forme locale d’opéra,
incarné par un personnage féminin fictif, fille d’un riche
propriétaire abandonnée et élevée par un couple de pauvres
acteurs ; la vie en a fait
une rebelle, emblème de la rébellion de femmes qui y sont
acculées par l’oppression et les discriminations dont elles ont
été victimes.
|
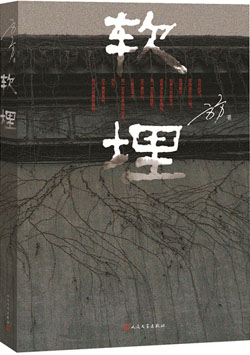
Fang Fang, Funérailles molles |
|
Fang Fang a poursuivi avec une série de romans sur
l’histoire de Wuhan, et c’est dans ce contexte
qu’elle a publié en août 2016 le roman «
Funérailles molles » (《软埋》),
dont le contexte est un épisode historique des
débuts de la période maoïste, la Réforme agraire
promulguée en1950, loi
fondamentale du nouveau régime car elle a bouleversé
les bases de la société chinoise,
mais épisode sanglant, donc sujet tabou. Fang Fang
n’en a pas fait pas directement son sujet, le roman
est beaucoup plus subtil.
Le
personnage principal est une vieille femme qui fut
l’épouse d’un riche propriétaire terrien de l’est du
Sichuan à la fin des années 1940 et a été témoin des
terribles événements qui ont accompagné la
redistribution des terres aux paysans : tous les
membres de la famille de son mari, et son mari
lui-même, ont préféré se donner la mort plutôt que
de subir les persécutions auxquels ont été soumis
les |
« propriétaires
terriens ». Elle a été désignée pour leur survivre, et les
enterrer, à la va-vite, à même la terre, avant de s’enfuir
avec son bébé, seul descendant de la famille.
La vieille dame en a
perdu la mémoire, mais a gardé au fond d’elle-même le souvenir
de ces événements qui ne cessent de la hanter. Elle en fait des
cauchemars, et exprime en particulier sa terreur d’être enterrée
elle aussi sans cercueil, le corps jeté à même la terre selon la
coutume des « funérailles molles », car, selon les croyances
locales, cela empêche le défunt de pouvoir renaître…
|
Son fils
fait des recherches pour mieux comprendre et
reconstitue des bribes de son histoire, mais décide
d’arrêter : les faits sont trop terribles, et leur
réalité trop insaisissable, il préfère ne pas
savoir. Fang Fang livre donc une réflexion très
profonde sur l’histoire et sa mémoire, et pourquoi
on peut préférer d’oublier. Le livre a été attaqué
par une frange ultra-orthodoxe du parti, et retiré
de la vente un an après sa publication, après avoir
obtenu un prix qui l’avait mis en vedette. Sa
traduction en français est aussi un hommage à une
écrivaine qui fait elle-même un remarquable travail
de mémoire
.
Littérature de l’exil
Née en 1958
à Shanghai dans une famille d’intellectuels et
d’écrivains,
Yan Geling (严歌苓)
a dit qu’elle a commencé à écrire parce que ses
gênes l’y prédisposaient. Mais un tel |
|
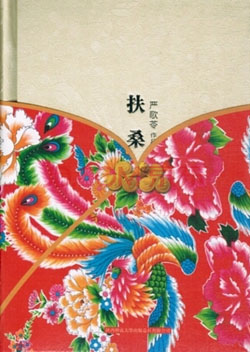
Yan Geling,
Fusang |
héritage
prédisposait aussi à ne pas avoir la vie facile dans la
Chine de Mao. Un critique a dit que sa vie n’avait rien à
envier à ses romans. Empreints de nostalgie et de chaleur
humaine, ceux-ci sont pour la plupart fondés sur des
recherches sur des personnages plus ou moins historiques :
d’une prostituée de haut vol, kidnappée et, échouée en
Amérique, devenue une célébrité dans la Californie de la
ruée vers l’or (Fusang《扶桑》)
à l’un de ses oncles, « Le criminel Lü Yanshi » (《陆犯焉识》),
publié en 2011.
2.
Les écrivaines post-70 et assimilées
Plusieurs personnalités se dégagent, pour l’originalité de leur
écriture, reconnue en particulier par la reconnaissance de la
critique et les prix obtenus :
1/
Lu Min (魯敏)
est l’une des
romancières typiques de cette génération née dans les années
1970, dans son cas en 1973. Elle est aujourd’hui acclamée et
bardée de prix littéraires, mais sa notoriété ne date en fait
que de 2012, année où elle a été choisie à la fois par le
magazine Littérature du peuple en Chine continentale et
par la revue Unitas à Taiwan pour figurer parmi leurs
listes respectives des vingt écrivains de langue chinoise de
moins de quarante ans les plus prometteurs du moment. Dans la
liste d’Unitas, elle arrivait même en cinquième position
derrière quatre écrivains taiwanais….
Pourtant, comme une
grande partie de sa génération, elle n’avait pas fait d’études,
à cause de la Révolution culturelle. Cas typique, son père est
mort en 1989, sa mère a dû élever seule ses deux filles. Mais
elle enseignait le chinois et rapportait chez elle des journaux
pour enfants. Lu Min a ainsi développé l’amour de la lecture,
mais sans jamais songer à devenir écrivain : elle est d’abord,
comme les autres, passée par toute une série de petits boulots
et c’est le hasard qui lui a donné soudain l’envie d’écrire :
parce que, un jour d’avril 1993, alors qu’elle travaillait dans
un bureau de poste, elle a vu le grand écrivain Su Tong venu lui
acheter des timbres… Il lui faudra encore cinq ans pour passer à
l’acte, mais c’est presque un conte de fées.
Elle commença, bien
sûr, par des nouvelles, avec le dessein de décrire les milliers
d’existences anonymes autour d’elle, comme la sienne, avec leurs
rêves qui ne se réaliseraient sans doute jamais, mais qui
valaient la peine d’être dits. Sa première nouvelle a été
publiée au début de 2001. Il lui faudra encore attendre sept ans
avant d’être reconnue, mais elle a toujours souligné
l’importance du soutien que lui ont apporté les critiques et les
autres écrivains, se sentant un peu comme l’enfant prodigue
accueillie dans le cercle de famille.
Elle est aujourd’hui
établie à Nankin, la ville de son adolescence, celle où son père
était ouvrier. C’était
un monde où chacun faisait front pour arriver à vivre, où les
difficultés n’affleuraient guère à la surface du quotidien, mais
où elle arrive à trouver un sens profond en creusant un peu.
Derrière la façade, elle fait ressortir les maladies
« honteuses » de chacun, c’est d’ailleurs ainsi qu’elle a
intitulé l’une de ses nouvelles, « Les maladies cachées » (《暗疾》) :
ce sont les manies, les phobies, les vertiges et les angoisses
nés de rêves irréalisables et de dilemmes insolubles.
|
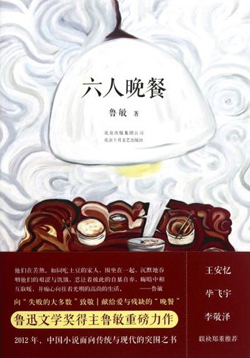
Lu Min, Dîner pour six |
|
Son univers est celui de la Comédie humaine vue au
ras du sol. En juin 2012, elle a publié un roman qui
se passe dans une zone industrielle à l’air
totalement pollué ; tous les samedis soir, six
personnages se retrouvent pour partager leur dîner :
le roman s’appelle « Dîner pour six »
《六人晚餐》).
Tous les six sont obsédés par leurs rêves de progrès
et cultivent le souvenir d’amours tout aussi
illusoires. La forme est aussi intéressante que le
fond : c’est une histoire éclatée en multiples
flashbacks à partir de l’explosion d’une usine
chimique, et divisée en six chapitres donnant les
points de vue des six personnages. Lu Min a réussi à
donner dans la forme même de sa narration une image
de l’éclatement de la société chinoise moderne, où
le « progrès » n’affecte qu’une frange de la
population.
Il est aussi dommage qu’étonnant que l’on n’ait
aucune traduction en français de Lu Min. La même
remarque vaut pour Ren Xiaowen. |
2/ Née en 1978 à Shanghai,
Ren Xiaowen (任晓雯)
a un temps été présentée comme étant « presque post-80 », ce qui
traduit bien le phénomène éditorial qui montait en épingle cette
génération. Depuis lors, l’engouement est retombé, et Ren
Xiaowen a trouvé sa place dans la génération qui est la sienne.
Mais elle aussi a mis du temps à le faire, avec une écriture
originale qui rejoint la recherche de formes différentes, issues
de la nouvelle, ou plutôt de la déconstruction du roman.
Son premier roman publié, « Elles » (《她们》),
est caractéristique.
Sorti en juin 2008,
c’est en fait une suite de portraits féminins : il est structuré
en 33 chapitres qui retracent les histoires de huit femmes dans
la Shanghai des années 1980 et après, de leur jeunesse à leur
maturité. Ce n’est cependant pas une simple galerie de
portraits : ces vies se recoupent, s’opposent, et finissent par
dresser un tableau de la ville de Shanghai où l’Histoire est en
filigrane, tableau beaucoup moins reluisant que l’image dorée
généralement associée à la ville. L’univers de Ren Xiaowen est
cruel, mais son style est incisif et poétique.
Tout au long des années
2010, elle a publié dans la presse une série de portraits
féminins dont vingt-deux ont fini par être publiés au début de
2017 sous le titre « Vies fugitives » (《浮生》)
– personnages qui s’inscrivent dans la grande tradition
chinoise, celle des « Gens de Pékin » de
Lao
She ou des petites gens de Tianjin par
Feng Jicai, mais tradition revisitée par une
écrivaine de Shanghai du 21e siècle qui est aussi une
héritière de
Zhang Ailing : narration épurée, mais réalité
tout aussi sombre, pour les femmes.
|
En 2017,
elle a développé l’un de ces portraits pour en faire
un roman, au style tout aussi incisif : « Song
Meiyong, une femme bien » (《好人宋没用》).
Le roman raconte, sur un ton neutre typique de
l’auteure, la vie de cette femme, originaire du nord
du Jiangsu où elle est née en 1921 ; parce que
c’était une petite fille, sa mère l’a appelée
« Inutile » (Meiyong), Inutile s’occupe de
ses vieux parents jusqu’à leur mort, vient en aide à
son bon à rien de frère et élève cinq enfants, le
tout en traversant la guerre, la famine et les
troubles politiques de tous ordres. Un destin
typique de femme dans la Chine du 20e
siècle. Remarqué en particulier pour son style, le
roman a obtenu une kyrielle de prix, mais attend
toujours qu’un éditeur français décide d’en publier
la traduction.
3/ Née en 1973 dans un petit village du Hunan,
Sheng Keyi (盛可以)
a fait irruption sur la scène littéraire en 2004
avec |
|
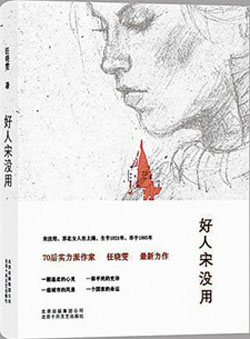
Ren Xiaowen, Song Meiyong |
son premier roman, « Filles du Nord » (《北妹》),
qui a eu un tel impact qu’il a été traduit depuis lors en
une demi-douzaine de langues. Ce roman traitait d’un sujet
inédit, sur un ton très libre, et d’autant plus prenant que
c’était un peu la propre histoire de l’auteure : celles de
jeunes campagnardes fuyant leur condition misérable pour
aller travailler en ville, dans le Sud du miracle
économique, d’où le titre « les petites sœurs du Nord ». Le
roman
décrit la lutte pour trouver des emplois, tous précaires, et
l’inévitable écueil, au bout du compte, pour ces mingong au
féminin : le corps comme ultime atout dans la course à la
réussite économique et à l’ascension sociale, avec les
dérives liées, les avortements à répétition en particulier.
Ce premier roman a été écrit avec une fougue « de cheval fou »,
a dit l’auteure. Elle a quitté Shenzhen en 2001, vit maintenant
à Pékin, mais voyage beaucoup à l’étranger et a accumulé romans
et nouvelles. Les uns continuent de défendre la cause féminine
et de critiquer la société chinoise corsetée par un régime de
plus en plus autoritaire ; les autres alternent sujets urbains
et sujets ruraux, histoires d’amour ratées et d’« infimes
existences » qui sont le pendant des « vies fugitives » de Ren
Xiaowen ; à celles-ci il faut ajouter des histoires d’enfants
peu ordinaires qui sont, dans un style poétique, sans doute les
plus réussies.
|
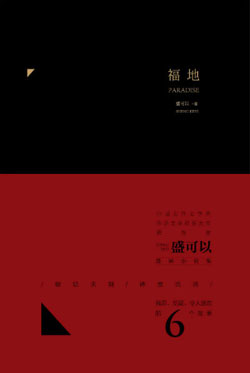
Sheng Keyi, Paradis |
|
Entre les deux, une nouvelle « moyenne »,
initialement publiée en mars 2016 dans la revue
Shouhuo,
est une satire sociale pleine à la fois d’une douce
poésie et d’un humour décapant, et intitulée
« Un
Paradis » (《福地》).
Ce Paradis
est en fait
une clinique pour mères porteuses, organisée et
gérée comme un centre de détention bien chinois, où
les femmes, dotées à leur arrivée de numéros mais
baptisées de noms de fruits par leurs consœurs,
viennent gagner un peu d’argent pour subvenir aux
besoins de leur famille et payer les études de leurs
propres enfants. Le récit est conté par une « jeune
idiote », muette de surcroit, qui a été ramassée
dans la rue, et qui mêle à ses observations de la
clinique ses souvenirs d’enfance, et en particulier
de sa mère, souvenirs qu’elle ne distingue pas très
bien de la réalité, ou plutôt qui s’y substituent.
La nouvelle a été traduite en français, et la
traduction est illustrée d’aquarelles inédites de
l’auteur, car Shang Keyi est aussi peintre
. |
Poursuivant dans la dénonciation des injustices que continuent
de subir les femmes en Chine, opprimées jusque dans leur corps,
Sheng Keyi a annoncé une « trilogie de l’utérus » dont le titre
est déjà une provocation et dont elle a écrit les deux premiers
volets, publiés à Taiwan. Elle prépare en complément l’histoire
d’une femme qu’on lui a racontée dans son Hunan natal.
A ces écrivaines on peut en ajouter deux autres que l’on peut
rattacher à la même génération : Li Juan et Yan Ge.
4/ Si Chi Zijian vient du Grand Nord,
Li
Juan (李娟) habite les franges nord-ouest du pays,
en pays kazakh, dans la province du Xinjiang. Née en 1979, elle
doit sa reconnaissance à
Wang
Anyi
qui a remarqué son écriture originale et l’a fait connaître
auprès de ses pairs. Elle vit solitaire, en écrivant. Sa mère
était couturière et elles tenaient un petit magasin dont les
clients étaient les nomades de la région. Elle a arrêté ses
études à la fin du secondaire pour aller travailler à Urumqi, la
capitale de la province. Mais la seule chose qui l’intéressait,
le seul domaine où elle était bonne à l’école, c’est l’écriture,
et elle a beaucoup lu. Elle a écrit un premier texte en 1990,
qui a été publié neuf ans plus tard. Sa carrière a donc débuté
au début du millénaire.
Ses récits, très brefs au début,
mêlent souvenirs, témoignage et réflexion, et parlent de l’Altaï
et de sa vie, parce que, dit-elle, c’est ce dont elle peut le
mieux parler.
Ses récits ont parfois des allures de contes fantastiques ou de
poèmes en prose, où les forêts sont peuplées d’esprits, et
d’animaux qui en sont peut-être, et où le désert recèle des
sources cachées. Elle a partagé un hiver la vie d’une famille de
nomades et en a tiré le livre « Pâturages d’hiver » (《冬牧场》),
publié en 2012, complété de deux autres, printemps-été,
regroupés dans une trilogie « de la voie du mouton » (“羊道”三部曲).
|
5/ Quant à
Yan Ge (颜歌),
née en 1984, elle fait théoriquement partie de la
génération des post-80, mais elle-même le récuse.
Elle a été découverte avec cette génération lors
d’un concours de nouveaux talents littéraires
organisé par une revue de Shanghai en 1998. Cela
faisait quatre ans qu’elle écrivait, mais elle a
commencé à publier sur internet et a mis encore une
dizaine d’années à peaufiner son écriture : elle été
mise à l’honneur à la Foire du livre de Pékin en
2011. Le roman qu’elle a publié juste avant la
Foire, « La Symphonie des sons » (《声音乐团》),
a la musique pour fil directeur : il conte
l’histoire d’une jeune fille, Rongrong, dont la vie
a été plus ou moins déterminée par des musiciens, à
commencer par son père ; le roman est en deux
parties, la première étant le journal inachevé de
Rongrong trouvé après sa mort, qu’une cousine
éditrice cherche à compléter et élucider, dans la
deuxième partie. |
|
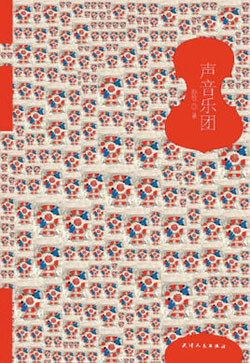
Yan Ge, La symphonie des sons |
Yan Ge est représentative d’une manière nouvelle d’écrire des
romans qui sont en fait construits sur des séries de nouvelles
liées par un thème commun. C’est le cas de trois de ses
dernières publications, de 2007 à 2015, liées par un lieu
commun, une petite ville (fictive mais à peine) de son Sichuan
natal. Le roman de 2013 a fait l’objet d’une traduction en
français, un peu passée inaperçue et c’est bien dommage. Il
s’agit de l’histoire pleine d’humour de sa famille et, à travers
elle, de sa petite ville natale.
3.
Littérature policière et science-fiction
Des écrivaines ont investi la littérature policière et la
science-fiction, genres nouveaux dans la littérature chinoise,
développés sur le modèle des romans policiers occidentaux et
surtout par des plumes masculines ; les femmes sont encore peu
connues dans ce domaine en plein devenir.
La littérature policière au féminin
Nouveaux en Chine, bien qu’étant liés à un genre populaire au 19e
siècle, les romans policiers sont souvent prétextes à une
peinture noire de la société, comme dans le cas de l’un des
principaux représentants du genre,
A Yi (阿乙).
Xu Yigua (须一瓜) en est une représentante féminine,
classée dans la génération post-70 bien qu’elle soit née à la
fin des années 1960. Elle a commencé à travailler très tôt,
comme les jeunes de sa génération, a écrit quelques nouvelles
très courtes dans les années 1990, puis a cessé jusqu’au
tournant du millénaire. A partir de 2002, elle a publié dans les
grandes revues littéraires des nouvelles inspirées de son
travail de chroniqueuse judiciaire d’un journal de Xiamen, où
elle habite toujours.
En 2003, elle obtient le prix des médias de littérature en
langue chinoise, avec le commentaire suivant : « Sous
l’acuité de son regard, la vie humaine ne peut cacher ni sa
détresse ni ses souffrances. Avec Xu Yigua, l’écriture en
revient à l’art de l’enquête, mais elle nous dit en même temps
que l’existence ne supporte pas l’enquête… »
|
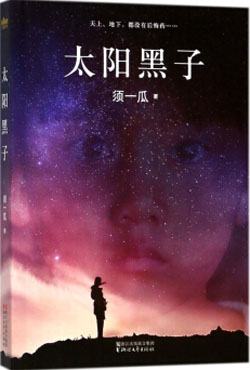
Xu Yigua, Taches solaires |
|
Après une série de recueils de nouvelles, elle
publie en 2010 un premier roman, « Taches
solaires » (《太阳黑子》),
qui a été adapté au cinéma. C’est une histoire
inspirée d’un fait divers, une affaire de meurtre
doublé de viol, dans laquelle cinq personnes d’une
famille ont été tuées sans que les trois meurtriers
aient été arrêtés. Le roman reprend leur histoire
dix ans plus tard. Comme l’un des trois est devenu
l’adjoint du chef de la police locale, qu’ils ont
adopté une petite fille atteinte d’une maladie
cardiaque et vivent ensemble en économisant l’argent
pour lui payer une opération, le roman est d’une
lecture aussi éprouvante que captivante. Le récit
repose tout entier sur de subtils ressorts
psychologiques.
Son troisième roman, « Masques blancs » (《白口罩》) est
une intrigue pseudo-policière et une fausse histoire
d ‘amour qui distille la terreur au compte-goutte.
Mais, entre les deux, elle a publié l’histoire de
cinq personnages féminins qui font penser à Genet :
le roman s’appelle |
« Les Bonnes » (《保姆大人》).
On retrouve comme chez Ren Xiaowen une galerie de
personnages féminins formant une tranche de la société.
La science-fiction au féminin
La science-fiction chinoise est quasiment monopolisée par les
bestsellers de
Liu
Cixin (刘慈欣)
dont la médiatisation est au détriment des autres auteurs, et en
particulier des auteures dont l’œuvre est encore en devenir, ne
serait-ce que parce qu’elles écrivent surtout des nouvelles. On
peut en citer deux :
1/ Auteure de nouvelle,
Xia Jia (夏笳) est née en
1984, a fait des études de physique, puis, en 2002, de cinéma en
terminant par une thèse sur les personnages féminins dans les
films de science-fiction, après quoi elle s’est orientée vers
des études littéraires à l’université de Pékin en terminant son
doctorat en 2014 par une thèse de littérature comparée sur la
science-fiction dans la culture de la Chine contemporaine.
C’est dire qu’elle a un bon bagage universitaire. Elle a aussi
une conception très personnelle de la science-fiction qu’elle
veut écrire :
une science-fiction très « soft », avec une coloration
littéraire rattachant ses récits aux histoires de fantômes
chinois qui forment tout un pan de la littérature et de la
culture chinoises ; mais sa formation littéraire lui permet
aussi bien de puiser son inspiration dans la littérature
étrangère, Italo Calvino, par exemple. Sa première nouvelle a
été publiée en 2004.
Sa « Parade nocturne des cent fantômes », datant de 2010, a été
publiée dans le
3ème
numéro de la revue Jentayu,
traduite par le traducteur de
Liu
Cixin,
Gwennaël Gaffric.
|
2/
Hao Jingfang (郝景芳)
est née la même année que Xia Jia, Elle a fait des
études de physique elle aussi, puis d’économie et de
gestion, mais pas d’études littéraires. Après avoir
commencé à écrire au début des années 2000, elle a
remporté un premier prix en 2002. Entre 2011 et
2016, elle a publié trois romans, dont le premier
définit son univers romanesque sous les auspices de
Jules Vernes et « De la Terre à La lune », mais en
développant une réflexion sur le choc de deux
mondes. Son style est en fait plus proche du roman
d’anticipation que du roman de science-fiction à
proprement parler.
C’est le cas aussi de la nouvelle qui lui a valu en
août 2016 le prix de science-fiction le plus prisé
du monde, le prix Hugo : « Folding Beijing » (《北京折叠》),
dans une traduction en anglais de Ken Liu, le
traducteur de
Liu Cixin et auteur
de science-fiction lui-même. Hao Jingfang y décrit
un monde en stagnation économique dominé par la
|
|

Hao Jingfang, Folding Beijiing |
robotisation du travail et divisé par les inégalités
sociales au point d’être formé de sphères fonctionnant comme
des ghettos, des « plis » de l’espace urbain définis en
fonction du statut social, sans communication entre eux. La
nouvelle a été publiée avec dix autres dans un recueil
intitulé « L'insondable
profondeur de la solitude »
(《孤独深处》) qui
a été
traduit en français
.
Un cas à part
Ce cas à part est celui de
Zhang Yihe (章诒和), née en 1942, pendant la
guerre ; seconde fille d’un célèbre défenseur de la démocratie
arrêté et condamné en 1957, puis mort d’un cancer en 1969,
elle-même a passé neuf ans de sa vie dans un camp pour avoir
critiqué l’épouse de Mao dans son journal intime et avoir été
dénoncée ; c’était en 1970, elle ne sera libérée et réhabilitée
qu’en 1979. Elle reprend alors ses recherches sur l’opéra
chinois au sein de l’Institut de recherche rattaché à l’Institut
des Beaux-Arts.
|

Zhang Yihe, Madame Zou |
|
Ce n’est qu’à sa retraite, en 2001, qu’elle écrit
les souvenirs et les témoignages sur son père et ses
amis.
Initialement publié en Chine dans la presse en 2002,
le livre est publié en 2004, avec quelques coupes,
sous le titre « Un passé qui ne part pas en fumée »
(《往事并不如烟》),
puis dans sa version intégrale à Hong Kong
.
Zhang Yihe entreprend alors d’écrire ses souvenirs
de camp, mais sous forme fictionnelle. C’est une
série de quatre courts romans, dont trois ont été
traduits en français
.
Le premier, publié en mai 2O11 aux éditions du
Guangxi, a étonnamment été tiré à 300 000
exemplaires, mais bientôt interdit. Intitulé « Madame
Liu » (《刘氏女》), il
a pour personnage principal une femme condamnée pour
avoir tué froidement son mari dont elle ne
supportait pas les crises d’épilepsie, et l’avoir
dépecé et conservé dans une jarre comme de la viande
salée.
|
Le troisième roman est l’histoire encore plus étonnante, dans le
contexte chinois, d’une histoire d’amour entre deux femmes, dans
le camp : c’est « Madame Zou » (《邹氏女》),
récit écrit d’une plume légère, avec chaleur et naturel, et des
touches d’humour.
Ce genre d’histoire est tellement rare dans la littérature
chinoise qu’il est intéressant de se demander pourquoi et quels
autres exemples on peut en trouver.
Son recueil de textes « Mon Altaï » (《我的阿勒泰》),
publié en Chine en 2010, est paru en traduction
française en 2017 : Sous le ciel de l’Altaï,
tr. Stéphane Lévêque, Philippe Picquier 2017.
|
|

